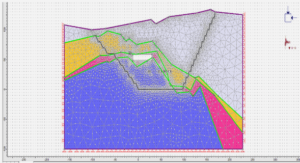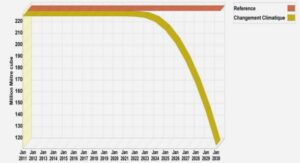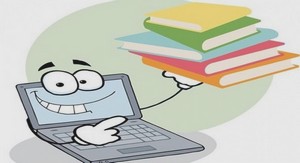L’apparition des regroupements de magasins pour former des centres commerciaux à grandes superficies et la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux établie en 1990, ont eu des répercussions sur les heures d’ouverture des commerces et les besoins en ressources humaines. En fait, toutes les entreprises commerciales assujetties à cette loi devaient trouver une nouvelle main-d’œuvre peu coûteuse disponible au travail. Plusieurs ont alors opté pour un groupe d’âge de travailleurs dont la faiblesse de la rémunération et la disponibilité étaient un atout pour leur développement commercial et social. Une partie de cette main-d’œuvre a été trouvée dans les écoles puisque, pour les employeurs, cette main d’œuvre n’avait pas nécessairement besoin de connaissances techniques particulières. Du deuxième cycle secondaire au niveau universitaire en passant par le collégial, les jeunes âgés de 16 et 25 ans sont maintenant une main-d’œuvre recherchée pour combler ce vide.
Par ailleurs, les développements sociétaux, technologiques et de biens consommables ont créé de nouveaux besoins (cellulaire, ordinateur, voiture, etc.). Pour les étudiants, la nécessité d’acquérir ces biens de consommation pour améliorer leurs conditions de vie s’est manifestée. Cependant, ils se sont rendu compte qu’un emploi à temps partiel pouvait leur procurer les revenus nécessaires à l’acquisition de ces biens de consommation.
Ces changements dans les habitudes des étudiants ont engendré des répercussions sur le temps réservé aux apprentissages scolaires en salle de classe et à la maison ainsi que sur le temps pour réussir un programme d’études. En effet, la première répercussion renvoie à la diminution du temps normalement réservé à l’étude et aux travaux scolaires à la maison, pourtant les travaux scolaires sont essentiels à la formation des étudiants puisqu’ils sont complémentaires aux apprentissages réalisés en classe (MEQ, 2002). La deuxième répercussion renvoie au prolongement dans le temps de la réalisation d’un programme de formation ; un diplôme prend plus de temps à obtenir que dans les normes prescrites par les institutions d’enseignement (Villeneuve, 1992 ; Roy, 2006). Nous devons donc interroger ces répercussions affectant le travail de l’enseignant et ce choix des étudiants de travailler pendant leurs études. Est-ce que les enseignants doivent adapter ou transformer leur pratique pour accommoder les étudiants qui choisissent de travailler pendant leurs études ? Est-ce que ces adaptations concernent la tâche de travail des enseignants du collégial et l’application des politiques des régimes d’études en vigueur ? Estce que ces enseignants doivent appliquer rigoureusement les politiques visant les absences aux cours et accepter ces nouvelles conditions d’études ? Est-il possible de conjuguer le travail et les études sans diminuer ni les contenus ni les exigences pour l’atteinte des compétences et l’acquisition d’un diplôme ?
Depuis la fin des années 60, un nouveau type d’étudiant est apparu dans les écoles du Québec et d’Amérique du Nord. Il s’agit des étudiants qui travaillent pendant les études et que nous nommerons « étudiants-travailleurs » dans le cadre de cette étude. Ces étudiants, qu’ils soient au secondaire, au collégial ou à l’université, jumèlent un travail à temps partiel ou à temps complet avec des études. Dans cette première partie du mémoire, un portrait de cette situation évolutive depuis les années 70 sera tracé et permettra de constater l’ampleur de la situation au Québec et ailleurs dans le monde. Pour ce faire, notre attention portera principalement sur le pourcentage d’étudiants qui travaillent pendant les études, les raisons qui les motivent à exercer un emploi tout en étudiant, le temps alloué pour les études et la réussite scolaire.
Les transformations sociales, économiques, culturelles et institutionnelles des dernières décennies au Québec ont eu de fortes répercussions sur l’ampleur de la situation travail-études. Un besoin de main-d’œuvre à bon marché s’est fait sentir dans le sillage de la construction de centres commerciaux (Le Laurier à Québec en 1961 et à Montréal Place Versailles en 1963 furent les premiers grands centres commerciaux couverts au Québec) et à l’augmentation de la surface de vente. À titre d’exemple, le Laurier à Québec est passé de 50 magasins en 1961 à plus de 300 en 2014. En ce qui concerne Place Versailles à Montréal, il compte maintenant plus de 225 magasins (sites internet : Le Laurier, 2014; Place Versailles, 2014). Le commerce de détail étant devenu plus concurrentiel (Clarkson, Gordon, Caron, Bélanger, Woods, Gordon, 1989), avec la mondialisation des échanges commerciaux, les entreprises ont rapidement réalisé que les jeunes travailleurs pouvaient constituer cette source de main-d’œuvre et ceci à bon marché (Clarkson et al., 1989; DesRoberts, 1989).
Par la suite, les jeunes travailleurs ayant des revenus plus substantiels provenant de ces nouveaux emplois ont été ciblés par les marchés de consommation. L’explosion de l’offre de produits de consommation (iPhone, iPad, cellulaires, voitures, etc.) contribue aussi à cette situation, car ce sont des biens facilement accessibles et à prix abordables pour les étudiants. Cet engrenage concurrentiel et commercial a également créé une pression sur les heures d’ouverture des commerçants. Ces derniers devaient augmenter le temps d’ouverture des locaux commerciaux occasionnant par le fait même l’augmentation de l’offre de travail aux jeunes adultes étudiants, car une forte proportion des emplois dans ce secteur sont des emplois qui s’adressent principalement aux jeunes adultes étudiants étant donné les horaires scolaires flexibles et les faibles revenus de chacun. Pourtant, Lepage (1990) soutient que le travail à temps partiel est idéal pour les étudiants, mais ce travail reste faiblement rémunéré. Ceux-ci représentent une bonne main-d’œuvre pour le temps partiel. Ils sont vaillants, peu revendicateurs, le salaire ne sert pas à assurer les besoins de base et ils se contentent d’un salaire peu élevé.
Cependant, le niveau de scolarité requis pour obtenir un emploi de qualité est également à la hausse. L’exemple de Bell Canada le montre bien. Dans les années 60-70, cette compagnie recrutait des personnes avec un diplôme d’études secondaires (Vigneault, 1993), maintenant, en 2011, ce sont des finissants du collégial qui sont embauchés.
Dans les années 80, travailler pendant les études est relativement nouveau. Cette main-d’œuvre de jeunes étudiants qui conciliaient travail et études s’intégrait relativement bien dans ce système qui tendait à fractionner les postes de travail d’une part et qui d’autre part, recrutait sur une base de travail temporaire. Aujourd’hui, en 2013, les étudiants sont ainsi attirés par le gain d’une certaine autonomie vis-à-vis de leurs parents. Par contre, déjà en 1990, une étude de Gareau met en évidence que certains enseignants émettent des mises en garde au sujet des échecs scolaires, de la conciliation travail-études et ils craignent les effets à long terme sur la persévérance scolaire .
Vigneault (1993) est l’un des chercheurs qui a beaucoup travaillé sur l’objet d’étude. Ses recherches ont porté sur la situation du travail étudiant à partir de diverses variables telles que le temps d’études, le temps de travail, les résultats académiques, le taux de décrochage scolaire. Ses travaux ont permis de décrire les effets du travail à temps partiel pendant les études et les effets sur la réussite scolaire. Ils confirment d’ailleurs une étude de Gareau (1987) sur la situation des étudiants-travailleurs. Ainsi, travailler pendant les études est devenu la norme, et ce, dès le deuxième cycle du secondaire. Le tout est principalement dû aux transformations sociales énoncées précédemment qui s’opéraient à cette époque et se sont actualisées et banalisées. Selon Roy (2008a), nous sommes en plein changement paradigmatique : le travail, pendant les études, est devenu une norme sociale incontournable pour les étudiants des différents niveaux scolaires.
Introduction |