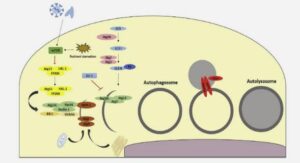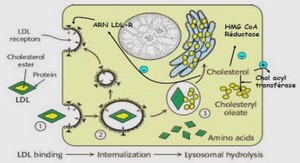Les plantes face aux stress causés par leur environnement
Généralités sur le stress
Tout organisme vivant est en interaction permanente avec son environnement. Ces interactions peuvent être dues à des paramètres biotiques ou abiotiques, nommés généralement facteur écologique (Ramade, 2009). Parmi les organismes vivants, les plantes, du fait de leur immobilité, sont les plus confrontées aux variations environnementales et souvent à plusieurs facteurs simultanés. De par leur caractère fluctuant, ces facteurs environnementaux peuvent, lorsqu’ils deviennent non favorables au développement du végétal, devenir des facteurs de stress. Pour la plante, l’initiation du stress se traduit par la déstabilisation d’un état standard (Lichtenthaler, 1998) (Figure 1). La plante peut alors soit faire face au stress grâce à la mise en place de mécanismes cellulaires de réparation ou de protection menant à une acclimatation et une résistance, soit dans le cas où le stress est trop important, être dépassée et subir des dommages menant à la mort cellulaire. Le stress peut avoir un impact plus ou moins important en fonction de sa fréquence et de son intensité, i.e. l’impact est « dose-dépendant » (Lichtenthaler, 1998).Au début de l’exposition, lors de la phase de détection, un déclin de certaines fonctions physiologiques comme la perte de photosynthèse ou de transport de métabolites peut être observé. Ces modifications entraînent une perturbation de l’homéostasie, une déviation de l’équilibre standard physiologique. Si la plante est faiblement tolérante ou si le stress est trop important, on parle de stress aigu (« acute stress»), qui peut entraîner rapidement une sénescence et des dommages irréversibles. Dans le cas d’un stress chronique ne dépassant pas les capacités de réponse de la plante, des processus sont mis en place pour lui faire face, comme la régulation des flux métaboliques et l’activation de processus de réparation, ou des adaptations morphologiques à la contrainte. Ces réponses vont permettre la résistance au stress. Leur mise en place progressive correspond au phénomène d’acclimatation. De nouveau, selon la durée de la contrainte et l’intensité du stress engendré, deux cas de figure sont possibles : soit la plante atteint un nouveau standard, c’est-à-dire un nouvel équilibre, soit l’accumulation des dégâts dépasse les capacités de réparation de la plante, entraînant la mort cellulaire. Ces dommages peuvent être observés en stress aigu court ou en stress chronique long. Un enjeu majeur de l’étude des stress abiotiques est de mettre en évidence les mécanismes clés de défense permettant la sélection de plantes tolérantes. Cependant, la sélection de variétés végétales prend en compte comme premiers critères de sélection le rendement agricole ou forestier. La notion de tolérance vs sensibilité des plantes est un concept ambigu. D’un point de vue économique, et notamment dans un contexte de sélection de variétés végétales, une plante tolérante à un facteur de stress est une plante qui va maintenir une forte productivité (croissance importante, bonne qualité du bois, production de fruits…), tandis qu’une plante sensible montrera des dégâts importants et une forte diminution de la croissance. Néanmoins, du point de vue du physiologiste végétal, le concept de tolérance peut simplement correspondre à la survie de la plante sous stress. En effet, certains mécanismes d’évitement permettent la survie de la plante au détriment de la productivité. De plus, les mécanismes ayant trait à la défense des plantes sont multiples et dépendent fortement des conditions données liées à la culture des plantes, de l’intensité et de la fréquence du stress (Tardieu, 2012). Dans le cadre de mes travaux de thèse, nous nous intéresserons aux réponses de la plante face au stress oxydant engendré particulièrement par deux facteurs environnementaux : l’ozone troposphérique (O3) et la sécheresse édaphique, autrement nommée déficit hydrique du sol.
Augmentation des épisodes de sécheresse : conséquence directe du réchauffement climatique
Définition de la sécheresse étudiée
La notion de sécheresse est relative au sujet d’étude (hydrologie, météorologie, pédologie). Globalement, cette notion caractérise un manque d’eau occasionnel et circonscrit dans le temps contrairement à l’aridité qui caractérise une pénurie d’eau structurelle. Une sécheresse édaphique ou déficit hydrique du sol résulte d’un déficit de précipitations pendant la saison de végétation (au printemps et en été) et d’un manque d’eau disponible dans le sol pour les plantes. Les sécheresses de 2003 et 2011 étaient de parfaits exemples de sécheresse édaphique. Elle se distingue donc de la sécheresse hydrologique, qui survient lorsque les précipitations hivernales sont insuffisantes pour permettre la reconstitution des réserves (nappes, barrages) et de la sécheresse météorologique, qui caractérise une période de déficit de précipitations. Dans le cadre de l’étude des mécanismes de réponse des plantes en réponse au déficit hydrique du sol, si le contraire de la sécheresse se définit par une disponibilité en eau optimale pour le fonctionnement de la plante, alors celle-ci peut être considérée en condition de sécheresse dès que la quantité d’eau disponible est limitante pour la photosynthèse, entraînant ainsi une réponse cellulaire (fermeture stomatique, régulation homéostatique).
Prédiction d’évolution de l’exposition à la sécheresse
L’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre a été identifiée par le Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) comme la cause du réchauffement climatique, réchauffement qui devrait, selon les modèles, être de l’ordre de 3 à 8°C supplémentaires sur la température moyenne d’ici la fin du siècle (GIEC 4e , Solomon, 2007). D’après le quatrième rapport du GIEC, cette hausse de la température aura pour conséquence l’augmentation des épisodes climatiques extrêmes, la diminution de la pluviométrie et l’augmentation des phases de sécheresse. Le cinquième rapport indique un manque d’observations pour affirmer l’augmentation des sécheresses à un niveau global, mais précise que cela pourrait masquer un impact à l’échelle régionale, notamment en région méditerranéenne avec une augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses (Lehner et al., 2006 ; GIEC 5e , 2014). Aux États-Unis, les modèles basés sur la diminution de la pluviométrie en hiver et l’augmentation de la température maximale et du déficit de pression à la vapeur d’eau (VPD) en été prédisent une augmentation de la mortalité des forêts couplée à des épisodes de sécheresse (Park Williams et al., 2013). Au-delà de ces prédictions, la mortalité accrue de peuplements forestiers ayant pour cause la sécheresse et l’augmentation de température est déjà un fait, le risque étant d’observer à plus long terme une multiplication des dépérissements de forêts (Allen et al., 2010). De plus, un affaiblissement de certains peuplements forestiers européens dû à la forte sécheresse de 2003 a été observé, ce qui a conduit à une augmentation de la mortalité des peuplements lors des épisodes moins importants qui ont suivi, en 2004 et 2005 (Bréda et al., 2006). Au niveau du sol, la sécheresse se traduit par une diminution du contenu en eau, caractérisé par un pourcentage d’humidité volumique. L’intensité de la sécheresse perçue par les plantes est directement liée à la teneur du sol en eau et souvent exprimée par un contenu d’eau extractible par la plante (REW, relative extractible water) (Bogeat-Triboulot et al., 2007). Il est couramment admis qu’une plante subit un déficit hydrique lorsque le REW est inférieur à 40 %, seuil à partir duquel la conductance stomatique et donc la transpiration diminuent graduellement (Granier et al., 1999). La limitation de la disponibilité en eau va entraîner des modifications physiologiques significatives liées à l’importance de l’eau pour le bon fonctionnement du végétal. Parmi ces modifications, il faut citer entre autres, sans ordre ici : (i) le ralentissement voir l’arrêt de la croissance (Granier et al., 1999), (ii) l’ajustement osmotique pour le maintien de l’homéostasie cellulaire (Buckley & Mott, 2002; Marron et al., 2003), (iii) les modifications des échanges gazeux, la fermeture des stomates et la diminution de l’assimilation (manque de CO2 et d’eau) (Bogeat-Triboulot et al., 2007; Granier et al., 1999) et (iv) la mise en place d’une cascade de signalisation impliquant notamment l’acide abscissique (Daszkowska-Golec & Szarejko, 2013; Sussmilch et al., 2017). Si la sécheresse se prolonge dans le temps, la fermeture des stomates peut ne pas être suffisante pour limiter la diminution de la pression hydrique dans le xylème, ce qui peut conduire au phénomène de cavitation : la formation de bulle d’air qui conduit à une rupture hydraulique du continuum sol-plante-atmosphère. Dans ce cas, si la plante ne retourne pas en condition normale, elle se dessèche jusqu’à éventuellement mourir (Choat et al., 2012).
Ozone troposphérique
Formation de l’ozone troposphérique
Les premières références littéraires à l’O3 remontent à l’histoire grecque, dans l’Iliade et l’Odyssée (VIIIe siècle av. J.-C) plus précisément, où les marins décrivent une odeur particulière après un orage. En 1785, le chimiste Van Marum génère de l’O3 en laboratoire en faisant passer un arc électrique dans du dioxygène (O2). C’est seulement en 1839 que cette odeur fut attribuée à une forme allotropique de l’oxygène (trioxygène) par C. Schönbein.Il nommera cette substance « ozein », qui signifie « exhaler une odeur » en grec. Les recherches de la fin du XIXe se concentrent ensuite sur les propriétés chimiques de l’O3. À partir des années 1920, le spectromètre de G. Dobson, physicien à l’université d’Oxford, permet la mesure de l’O3 dans l’atmosphère et la découverte des fluctuations journalières et saisonnières de ses concentrations. Le XXe siècle permettra de découvrir la répartition de l’O3 dans l’atmosphère et le rôle protecteur de la couche d’O3 stratosphérique. En effet, le gaz est majoritairement présent dans la stratosphère où il forme une barrière aux ultraviolets : la couche d’O3 (concentration d’environ 10 ppm). Il est également présent dans la troposphère (18 à 15 premiers kilomètres d’atmosphère) à des concentrations annuelles moyennes très faibles, de l’ordre de 10 à 50 ppb. En 1970, un nouveau paradigme émerge : la production d’O3 est équilibrée par des pertes dues à des réactions catalytiques avec les oxydes d’azote (NOx) et le radical hydroxyle (HO), mais les activités humaines peuvent influencer la balance (production/perte). La formation d’O3 dans la troposphère (Figure 2) peut être brièvement résumée comme étant l’oxydation par HO du monoxyde de carbone (CO), du méthane (CH4) ou de composés organiques volatils (COV) en présence de NOx (Monks et al., 2015). En somme, l’O3 est un polluant secondaire instable avec un fort pouvoir oxydant qui est formé à partir de précurseurs lors de réactions photochimiques. Durant la même période, les grandes villes voient apparaitre le développement d’un brouillard de pollution appelé « SMOG » (combinaison de « smoke » et « fog »). Les premiers symptômes dus au SMOG sur les plantes sont signalés par Middleton et al. (1950) à Los Angeles. Ce sont cependant les travaux de Haagen-Smit et al. (1952) qui permettront d’attribuer définitivement ces symptômes à l’O3 grâce à la recréation en laboratoire de SMOG artificiel par combustion de pétrole en présence d’O3.
Passé, présent et futur niveaux d’O3 dans la troposphère
Les premières mesures de l’O3 troposphérique commencent au milieu du XIXe siècle. Environ 300 stations de mesure sont recensées, réparties principalement aux États-Unis et en Europe. Néanmoins, peu de stations mesurent les concentrations de manière continue (Vingarzan, 2004). La première mesure quantitative de l’O3 de surface réalisée en continu a lieu à l’observatoire météorologique du Montsouris (Paris), pour des valeurs comprises entre 6 et 15 ppb entre 1876 et 1910 (Volz & Kley, 1988). Jusqu’aux années 80-90, le développement des stations de mesures stagne. Du milieu du XIXe à la fin du XXe , les concentrations globales d’O3 sont donc estimées à partir des valeurs de quelques stations de mesure seulement. Or, la concentration d’O3 pour une zone géographique donnée dépend d’une combinaison de facteurs