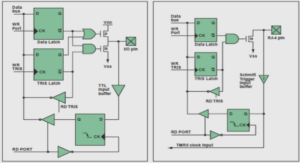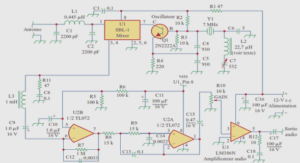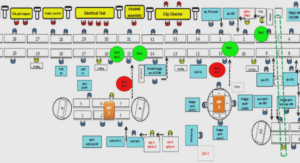LES PESTICIDES
Le terme pesticide désigne toute substance ou mélange servant à empêcher, détruire, repousser des organismes indésirables pour l’agriculture ou l’hygiène publique. Il s’agit d’un terme général englobant une grande variété de produits : herbicides, fongicides, insecticides. Un pesticide peut être une substance chimique, un agent biologique (tel qu’un virus ou une bactérie), un désinfectant ou tout autre produit luttant contre des « nuisibles » tels que les insectes, les mauvaises herbes, ou les microbes. Les pesticides peuvent être classés en fonction de leurs familles chimiques. Selon l’OMS, les pesticides sont des produits chimiques utilisés en agriculture pour détruire les ravageurs, les plantes adventices et les agents phytopathogènes. Ces produits peuvent être extraits de végétaux ou obtenus par synthèse. Dans le présent travail, on s’intéresse aux pesticides chimiques de synthèse qui présentent un risque pour l’environnement et la santé publique. Selon la FAO (1986 a), un pesticide est une substance ou un mélange de substances, utilisé pour empêcher d’agir, détruire ou neutraliser un ravageur, un vecteur de maladie humaine ou animale, une espèce végétale ou animale nocives ou gênantes au cours de la production, de la transformation, de l’entreposage, du transport ou de la commercialisation de denrées alimentaires, de produits agricoles. Le terme de pesticide désigne aussi des produits utilisables comme régulateurs de la croissance végétale, défoliants, dessicants, agents d’éclaircissage contre la chute prématurée des fruits ou encore des produits appliqués avant la récolte pour empêcher la détérioration des denrées en cours d’entreposage ou de transport.
Classification
Les pesticides disponibles aujourd’hui sur le marché sont caractérises par une telle variété de structures chimiques, de groupes fonctionnels et d’activités que leur classification est complexe. Devant le nombre considérable de pesticides (plus de 1000 matières actives différentes dans près de 7000 formulation commerciales), ( Kesraoui+, 2008). D’une manière générale, les substances actives peuvent être classées soit en fonction de la nature de l’espèce à combattre (1er système de classification), soit en fonction de la nature chimique (2ème système de classification) .
Premier système de classification
Le premier système de classification repose sur le type de parasites à contrôler. Il existe principalement trois grandes familles d’activités que sont les herbicides, les fongicides et les insecticides. – Les insecticides : La lutte contre les ravageurs est indispensable. Les insectes nuisiblessont en effet responsables des pertes de rendement et d’une baisse de qualité de la production viticole (Kreiter etal., 2008). Les insecticides sont destinés à détruire les insectes nuisibles ; ils se répartissent en trois grands groupes selon leur nature chimique : substances minérales, molécules organiques d’origine naturelle ou produits organiques de synthèse qui sont de loin les plus utilisés actuellement. Autres que les organochlorés (DDT, dialdrin, …) qui sont bannis actuellement dans la plupart des pays du nord, les insecticides appartiennent à trois grandes familles chimiques : les organophosphorés (diméthoate, malathion, …), les carbamates (aldicarbe, carbofuran, …) et les pyréthrinoides de synthèse (bifenthrine, perméthrine, …) – Les fongicides : Les fongicides servent à combattre la prolifération des champignons phytopathogènes. Ils permettent de lutter contre les maladies cryptogamiques qui causent de graves dommages aux végétaux cultivés. Le mildiou de la pomme de terre, celui de la vigne, les charbons et les rouilles des céréales, représentait autrefois de véritables fléaux. Ces affections sont provoquées par l’invasion des divers tissus des plantes par le mycélium de champignons microscopiques. Les plus anciens fongicides connus sont des sels cupriques, le soufre et certaines de ses dérivés minéraux. Les composés organiques représentent la part la plus importante: carbamates (carbendazine, mancozèbe, …), triazoles (bromuconazole, triticonazole,…), dérivés du benzène (chlorothalonil, quintozène), dicarboximides(flopel, iprodione,…). Il est intéressant de signaler que le soufre et le cuivre demeurent d’excellents fongicides utilisés jusqu’à nos jours (Calvet et al., 2005). – Les herbicides : Ce sontles plus utilisés des pesticides, ils permettent d’éliminer les mauvaisesherbes adventices des cultures. Ils appartiennent à plus de 35 familles chimiques différentes.Les plus représentées sont les carbamates (chlorprophame, triallate,…), les urées substituées (diuron, chlortoluron,…), les triazines (atrazine, simazine,…), les chlorophenoxyalcanoiqueS (MCPA,…), les amides (alachlore, propyzamide,…).
Deuxième système de classification
Un produit phytosanitaire tel qu’il est présenté, est une spécialité formulée homologuée pour le traitement d’une culture précise (maïs, blé, tomate, pomme de terre, pois, fraise, etc…). La spécialité formulée est composée d’une ou plusieurs matières actives et d’un ou plusieurs additifs. Le deuxième système de classification tient compte de la nature chimique de la substance active qui compose majoritairement les produits phytosanitaires. Compte tenu de la variété des propriétés physico-chimiques des pesticides disponibles sur le marché, il existe un très grand nombre de familles chimiques. Les plus anciens et principaux groupes chimiques sont les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates, les triazines et les urées substituées. Les structures chimiques caractéristiques de certaines de ces familles sont présentées dans le tableau 1.
Principales familles de pesticides
Les organochlorés
Cette famille comprend un grand nombre de composés chimiques contenant du chlore et quelquefois d’autres éléments. Les insecticides les plus puissants et les plus efficaces sont des organochlorés. On trouve dans cette famille le DDT, le chlordane, ou en encore le pentachlorophenol. Ils sont très persistants dans les sols, et ils se concentrent également dans les tissus biologiques. Beaucoup de composés de cette famille sont interdits en raison de leur neurotoxicité.
Les organophosphorés
Les composés organophosphorés se répartissent en différentes classes selon le degré d’oxydation du phosphore et la nature des substituants, notamment la présence d’un atome d’oxygène ou d’un autre chalcogène. Les composés organophosphorés sont rapidement dégradés par le rayonnement solaire, dans l’air, et dans les sols, bien que de petites quantités puissent subsister et se retrouver dans la nourriture et l’eau. Le fait qu’ils se dégradent facilement fait de cette famille une alternative intéressante aux pesticides organochlorés persistants. Cependant, bien que les organophosphorés se dégradent plus rapidement, ils sont plus toxiques, ce qui représente un risque pour les utilisateurs de ces composés.
Les urées
Les urées représentent les molécules renfermant un groupe urée (NH2CONH2).Ce groupe peut se trouver à l’intérieur d’un cycle(Forgacz, 2011). Les atomes d’hydrogène liés aux atomes d’azote peuvent être substitués par d’autres atomes, par des chaînes ou par des cycles où constituer un cycle. Les sulfonylurées répondent également à la définition des urées. Cependant, comme la priorité de ce groupe est supérieure à celle des urées, les molécules répondant aux deux définitions seront classées dans les sulfonylurées.
Les carbamates
Les carbamates présentent les mêmes caractéristiques que les organophosphorés, mais avec une toxicité moins importante. Ces composés constituent une famille de pesticides agissant sur l’enzyme acétylcholinestérase (la famille des carbamates agit également sur cette enzyme mais selon un mécanisme différent) (Anne-Antonella, 2015). Ils opèrent en bloquant irréversiblement l’acétylcholinestérase, essentielle aux transferts nerveux chez les insectes, les humains, ainsi que chez la plupart des animaux. La capacité à bloquer l’acétylcholinestérase (et donc la toxicité) peut varier de façon importante d’un composé à l’autre. Par exemple, le parathion, un des premiers organophosphorés, est beaucoup plus puissant que le malathion, un insecticide utilisé pour combattre la mouche du fruit méditerranéenne et les moustiques dans la vallée du Nil.