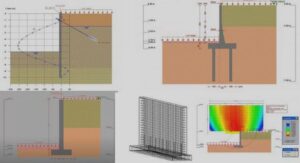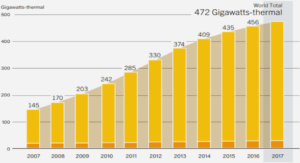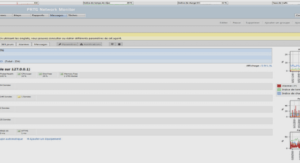Les nombreuses juridictions
« Justiciables du Châtelet pour leurs affaires civiles, les écoliers l’étaient de l’official pour les crimes et délits, du recteur pour leurs différends universitaires et, pour les affaires bénéficiales, d’un vice-gérant des conservateurs des privilèges apostoliques, lesquels étaient trois évêques désignés par le pape » 708 Comme l’a bien exprimé Jean Favier ci-dessus, les juges qui étaient amenés à s’occuper des étudiants étaient multiples, d’autant qu’en plus, le Parlement pouvait intervenir également, soit comme cour d’appel des sentences prononcées en première instance, soit afin de régler les nombreux conflits de juridiction. Et les contestations furent nombreuses, en raison du fait, d’une part que la frontière était souvent ténue entre faute grave relevant de l’évêque, voire du roi pour les crimes de lèse-majesté, et délit plus mineur pouvant être réprimé à l’intérieur de l’université elle-même, et d’autre part, qu’un étudiant pouvait en même temps être moine ou chapelain par exemple, et à ce titre, dépendre également du supérieur de sa congrégation.
Les officialités « Qui est à entendre à la court de l’eglise »
Au début de notre période, les universitaires furent, en tant que clercs, naturellement rattachés au tribunal des officialités ecclésiastiques, c’est-à-dire à l’évêque. Cette situation était la continuation logique des anciens studium qui dépendaient de l’église cathédrale, comme pour Paris, celle de Notre-Dame. Mais assez rapidement dans le courant du XIIIe siècle, l’autonomie grandissante des universités se traduisit par la constitution, au sein même de l’institution, d’un tribunal dirigé par le recteur, ainsi que par l’attribution à la prévôté, qui dépendait directement du roi, d’un rôle de protection des privilèges universitaires.
Tout ceci contribua à générer de nombreuses ambiguïtés et de multiples conflits entre ces différentes instances judiciaires. Ceci étant, l’évêque conservait son droit de justice sur les étudiants qui se rendaient coupables de délits majeurs, lorsque cette culpabilité était clairement avérée. En cas de doute, il ne devait pas emprisonner le jeune homme mais pouvait cependant exiger le paiement d’une caution jusqu’à ce que son enquête ait apportée ou non les preuves nécessaires710. Par ailleurs, aucune peine d’incarcération ne pouvait être prononcée en cas de dette711, même si cette dernière instruction ne semble pas avoir été toujours respectée, plusieurs lettres d’étudiants à leurs parents les suppliant, des fonds d’une geôle, de leur envoyer de l’argent, afin de pouvoir payer une somme due et être ainsi libérés
Une officialité était une cour de justice qui ne rendait pas ses décisions à la légère ni de manière expéditive mais au contraire de façon très professionnelle, si l’on se réfère à son organisation. Celle de Paris par exemple, était composée de trois chambres, une dirigée par l’official lui-même qui était le second de l’évêque en matière judiciaire et qui traitait toutes les affaires importantes et donc probablement toutes celles concernant les universitaires, les deux autres chambres, dirigées chacune par un auditeur, étant assignées
Le tribunal du recteur « Les recteurs qui seront […] eslus [… pour] ouir plaintes si aucunes se présentent » 725 Dès 1215, un droit de justice avait été accordé par le pape Innocent III aux maîtres de l’université sur leurs élèves726 . Une quinzaine d’années plus tard, c’est Grégoire IX qui avait donné à l’université elle-même, en tant qu’institution désormais, ses premiers pouvoirs de justice sur ses membres, droits limités cependant aux infractions aux règlements internes et pouvant se concrétiser par un simple avertissement, par une amende, voire par une exclusion
. En aucun cas, il n’était question d’emprisonnement ni de punitions corporelles. Les universités allaient cependant assez rapidement se donner les moyens d’un fonctionnement de plus en plus indépendant vis-à-vis des organismes extérieurs, confortée en cela par les reconnaissances papales et royales qu’elles avaient obtenues. Si les premières bulles de fondation définissaient un cadre général, ce sont bien les universitaires eux-mêmes qui allaient imaginer les règles de fonctionnement de leurs établissements, et pas uniquement sur le plan purement scolaire, mais aussi pour l’ensemble des domaines annexes comme l’administration et la justice.
Tout cet échafaudage se mit en place avec une volonté affichée – et même parfois poussée à l’excès – de démocratie. C’est ainsi que le recteur, qui était au sommet de l’édifice, était élu par ses pairs, et ce pour une durée d’un mois au début, puis de trois mois par la suite. Le recteur ne dirigeait jamais seul et toutes les décisions importantes étaient prises par une assemblée qui l’assistait et dont le vote était déterminant. Il en était ainsi dans le domaine judiciaire. Le recteur était la tête dirigeante d’un tribunal qui jugeait, là-aussi de façon collégiale, et qui avait le pouvoir d’enquêter, d’auditionner le prétendu coupable ainsi que des témoins, et cela de façon à prendre les décisions qui lui paraissaient les mieux adaptées.