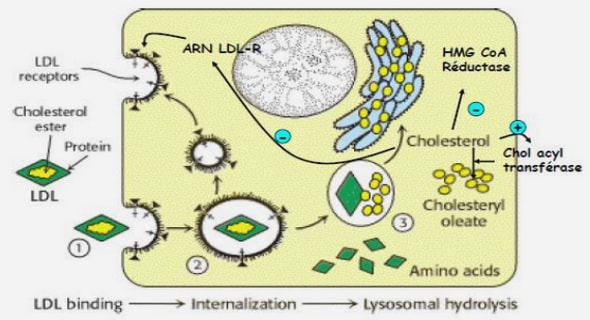Les mouvements de protection et de défense des animaux
En France (et plus généralement, en Europe latine), les mouvements de réflexion et d’action concernant les animaux se sont formés et développés plus tardivement que dans le monde germanique et anglo-saxon. La SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) britannique, née en 1824, devenue “Royal” (RSPCA) en 1840 par décision de la reine Victoria, tient le rôle de précurseur.
Elle eut un écho immédiat outre-Atlantique et c’est sur son modèle que l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) prit forme, mais seulement en 1879, après la défaite des Sudistes et l’abolition de l’esclavage – qui enracina pour longtemps l’analogie constamment répétée entre la libération des animaux et celle des esclaves. En France, la Société pour la Protection des Animaux fut créée en 1845, suivie de peu par l’adoption de la loi Grammont (1850), qui réprimait les mauvais traitements publics et abusifs infligés à des animaux domestiques, et que la toute jeune SPA s’employa à faire appliquer.
Composition sociale et focalisation militante
Depuis le 19ème siècle, les associations d’inspiration semblable se sont multipliées, tout en conservant, à travers leur diversité croissante, un trait constant, qui est leur composition sociale. Leurs adhérents restent majoritairement issus des classes sociales moyennes et supérieures, aisées, lettrées, et urbaines (Beers, 2006; Jamison & Lunch, 1992; Jerolmack, 2003). Ce qui explique sans doute leur intérêt tardif pour les animaux d’élevage, chevaux exceptés.
Les animaux de compagnie, ou au contraire les animaux sauvages (naturels), retenaient plus spontanément leur attention : la SPA créa rapidement le premier asile pour chiens et chats, et la première association protectrice créée après elle fut, en 1912, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (sauvages). Les animaux d’élevage durent, quant à eux, attendre 1961 et la création de l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir (OABA) pour susciter une attention bienveillante, en même temps que se préparait la première grande réorganisation de l’abattage et de la production des viandes.
Diversité des doctrines et des objectifs Une vue panoramique des associations montre une grande diversité dans leurs conceptions de la condition animale et des relations souhaitables entre humains et animaux. Très schématiquement, on peut néanmoins distinguer, comme souvent dans les mouvances militantes, deux types de postures, deux stéréotypes, opposés dans leurs doctrines, leurs objectifs et leurs activités, et entre lesquels se déclinent les nombreuses variantes réelles : • des modérés, réformistes, prioritairement désireux de procurer aux animaux des conditions de vie décentes, ou du moins d’améliorer les conditions dans lesquelles ils se trouvent ; peu enclins aux spéculations ambitieuses, mais dotés d’une solide connaissance des animaux, ils savent identifier ce qui leur convient ou non. En termes d’éleveurs : ‘ils ont l’œil’.
En termes médicaux : ‘l’œil clinique’. Si une connaissance scientifique s’y ajoute, ils se trouveront être d’excellents guides vers les animaux, dans une sociabilité accueillante aux animaux et aux humains (Fraser, 2008; Paul, 1995). • des radicaux, qui se nomment eux-mêmes ‘abolitionnistes’, l’abolition étant celle de toute exploitation des animaux et donc, par précaution, de toute relation avec eux, pour les rendre à une naturalité supposée heureuse, délivrée de l’exploitation par les humains esclavagistes.
Nourris de spéculations, scrupuleusement abstinents de tout produit d’origine animale, ils semblent s’identifier aux animaux qu’ils veulent délivrer, et rester comme en suspens entre une impossible animalité et une humanité refusée – au point de souhaiter sa disparition pour enfin restaurer la pure nature (Hawthorne, 2008; Pivetti, 2005). C’est dans le champ balisé par ces deux figures schématiques que se déploient les diverses tendances et options de la mouvance animaliste, offrant toutes les nuances possibles entre le réformisme avisé et l’extrémisme visionnaire.
Les registres d’action Si les objectifs, les modes d’action et les champs d’influence des nombreuses associations sont très variés, elles ont néanmoins en commun de déployer toujours leurs activités sur trois registres, occupant chacun des degrés variés selon leurs présupposés et leurs moyens : • celui des actions visant à améliorer très concrètement le sort des animaux, en les protégeant, les recueillant, les soignant, etc. (type SPA) ;
• celui de la sensibilisation de l’opinion, par les moyens habituels du militantisme (campagnes d’informations, diffusion de tracts, pétitions, manifestations, déclarations, etc.), ou par la pédagogie (certaines associations sont autorisées dans les établissements scolaires) (Hawthorne, 2008) ; • celui enfin du groupe de pression, le plus souvent par le lobbying auprès des pouvoirs publics, nationaux et européens, par l’activité des réseaux professionnels et relationnels, ou par le recours aux procédures et outils juridiques (Marguénaud, 2009; Pivetti, 2005).