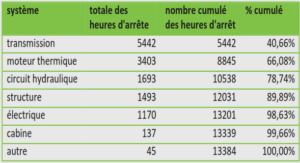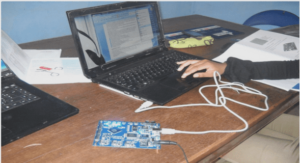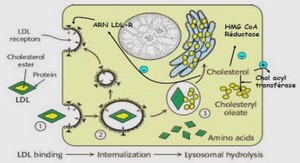Les modes d’association de cultures
L’insertion de couverts de légumineuses dans les rotations de grande culture s’envisage selon deux modalités. Soit, le semis des couverts de légumineuses se fait entre deux cultures de vente, après un ou plusieurs faux semis suivant la récolte de la culture précédente (Løes et al., 2011; Mazzoncini et al., 2011), on parle alors d’interculture. Soit, le couvert de légumineuse est cultivé simultanément à une culture céréalière selon une organisation spatiale et pour une durée qui peuvent varier, on parle alors d’associations de cultures (traduction du terme anglais « intercrop ») (Willey, 1979a).
Les associations de cultures ont été largement étudiées dans les systèmes agricoles tropicaux (Willey, 1979b; Vandermeer, 1989; Connolly et al., 2001; Scholberg et al., 2010). Tout au long du 20ème siècle, la pratique d’association culturale a régressé dans les pays industrialisés où l’agriculture s’est rapidement orientée vers des cultures pures. Le développement dans ces zones géographiques de systèmes de production à bas niveau d’intrant, tels que les systèmes biologiques, provoque un intérêt croissant pour ces associations culturales. Elles reposent en effet sur les caractéristiques naturelles des espèces associées et sur leurs interactions pour gérer les facteurs limitants des systèmes de cultures (Anil et al., 1998; Hartwig and Ammon, 2002; Scholberg et al., 2010; Lithourgidis et al., 2011a). En termes d’organisation spatiale, on distingue 4 modes d’associations de cultures (Vandermeer, 1989; Lithourgidis et al., 2011a) : • Les associations en mélange (Mixed intercropping) :
Les espèces sont totalement mélangées dans l’espace disponible. Il n’y a pas d’arrangement en rangs. C’est le cas des prairies temporaires. • Les associations en rangs (Row intercropping) : L’association en rangs alternés consiste à cultiver les différentes espèces de l’association sur des rangs séparés qui s’alternent dans l’espace. L’association peut aussi se faire sur le rang et consiste à semer les différentes espèces associées en mélange sur chaque rang. • Les associations en bandes (Strip intercropping) : Plusieurs rangs de chaque espèce de l’association s’alternent dans l’espace pour potentiellement permettre la mécanisation des différentes cultures tout en leur permettant d’interagir.
Le fonctionnement des associations culturales
Pour Vandermeer (1989), l’interaction entre plantes associées se fait au travers de leur environnement selon deux processus : Chapitre 1. Étude bibliographique et problématique 10 • La compétition, lorsqu’une espèce altère l’environnement de la seconde espèce et gêne son bon développement. C’est le cas, par exemple, de la consommation d’une ressource trophique par la première espèce qui devient limitante pour la seconde. • La facilitation, lorsque qu’une espèce modifie son environnement de manière favorable pour la seconde espèce.
C’est le cas, par exemple, de la libération d’une ressource dans le milieu par une espèce qui pourra être assimilée par une autre espèce et lui permettre d’avoir de meilleures performances. Le comportement des espèces de l’association dépend de leurs capacités à générer et supporter la compétition (Tosti and Guiducci, 2010) mais également à réagir en situation de facilitation. Ces capacités sont liées au temps de présence simultanée sur la parcelle, aux ressources considérées, à la morphologie et à la physiologie des plantes associées.
Ces interactions évoluent tout au long du cycle de l’association et même après, selon la dynamique de minéralisation de la MO dans le sol et la mise à disposition des nutriments pour les cultures de la rotation suivant la nature des plantes associées. Ces relations peuvent donc se manifester en même temps ou à des périodes distinctes durant l’association. L’efficience dans l’utilisation des ressources trophiques par des plantes associées peut être liée à des caractéristiques intrinsèques de chaque composante de l’association (type de développement racinaire, port aérien, capacité à fixer l’azote atmosphérique), mais également à des adaptations morphologiques des différentes espèces en situation de compétition.
La compétition pour la lumière joue sur la vitesse de croissance et la taille du couvert de légumineuse (Wu et al., 2011) ; la compétition pour les nutriments et l’eau disponibles dans le sol influe sur le développement du système racinaire de chaque espèce (Li et al., 2006) (Fig. 1)
Choix de l’association relais
Dans cette étude, notre choix s’est porté sur l’insertion d’un couvert de légumineuses fourragères de service au début du printemps dans un couvert de blé tendre d’hiver semé à l’automne. Ce choix d’association relais se justifie par les contraintes agronomiques des systèmes de grande culture biologiques identifiées précédemment (infestation par les adventices, déficits chroniques d’azote minéral). Le choix de la culture de blé tendre d’hiver se justifie par l’intérêt économique de cette culture dans les rotations de grande culture biologiques de la région étudiée. Dans les systèmes céréaliers des zones tempérées, les plantes de services sont semées dans les cultures d’automne, généralement au début du printemps, au moment de la reprise de