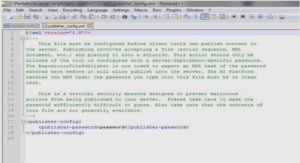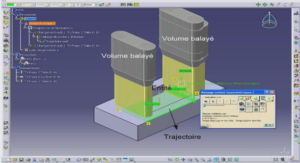Les modèles de pilotage comme objet de recherche
Portée et limites des perspectives gestionnaires existantes pour l’étude des relations entreprises / société
Dans le chapitre 1, nous avons montré comment un champ académique gestionnaire spécifique s’est progressivement élaboré autour de l’étude des relations entre entreprise et société depuis les années 50 aux Etats-Unis. En particulier, nous avons décrit la dynamique d’institutionnalisation engagée à partir de la deuxième moitié des années 60, où les questions de recherche du champ B&S ont bénéficié d’une reconnaissance croissante au sein des business schools et de ses organes de représentation (notamment l’AACSB74). Ce mouvement s’est traduit par la structuration formelle des communautés de recherche (notamment la création de la section Social Issues in Management au sein de l’Academy of Management en 1971), l’autonomisation de ses questions de recherche et la création de journaux académiques dédiés.
Ce mouvement de « disciplinarisation » du domaine Business and Society (B&S) a permis d’affirmer la position du champ au sein des écoles de management américaines. En même temps, cette « institutionnalisation difficilement gagnée » (Wood, 2000 : 364) reste fragile et n’a pas suffi à résoudre les problèmes d’identité plus profonds du champ B&S concernant son cœur théorique, sa spécificité et sa valeur ajoutée (A). Par ailleurs, elle n’a pas su prévenir un processus de décrochage entre théories et pratiques, souvent considéré comme un corollaire de ce mouvement d’académisation (B). Ces différentes difficultés nous amèneront à réinterroger plusieurs hypothèses communes qui ont accompagné le développement du champ, pour en discuter les limites et envisager des voies de dépassement.
A ce titre, deux points nous semblent handicaper l’analyse : la dichotomie entreprise / société (C) et la faible capacité des cadres d’analyse les plus courants à rendre compte des dynamiques d’apprentissage collectif (D). A) Une identité, une position et un cœur théorique incertains « La Responsabilité Sociale de l’Entreprise a une signification, mais celle-ci est variable en fonction des acteurs qui la mobilisent » (Votaw, 1972: 25). Le champ de la RSE « est un champ éclectique avec des frontières lâches, de nombreuses appartenances, et différentes traditions et perspectives académiques ; plutôt large et multidisciplinaire que focalisé ; de portée large ; qui mobilise de nombreux cadres d’analyse » (Carroll, 1999 : 14)
« Le champ de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) ne constitue pas seulement un ensemble de théories, mais aussi une prolifération d’approches qui sont controversées, complexes et floues » (Garriga et Melé, 2004: 51) Le concept de développement durable « est fondamentalement chargé d’objectifs et d’ingrédients multiples, d’interdépendances complexes, et d’une dimension morale très importante. […]
Certains observateurs anticipent que la notion de développement durable restera floue, peu cadrée, contestée et controversée d’un point de vue idéologique pour les années à venir » (Gladwinn & al, 1995 : 876) En tant que champ académique, la communauté B&S semble avoir été confrontée de manière récurrente à des difficultés concernant son identité et sa cohérence. Aujourd’hui, différents constats convergent pour souligner la fragmentation du champ (Wood, 2000; Garriga et Melé, 2004; Waddock, 2004), la difficulté à en tracer le périmètre, et son incapacité à intégrer dans ses cadres théoriques et dans ses communautés des questions relatives aux enjeux environnementaux.
Une analyse historique de la dynamique de construction du champ montre que les débats sur la nature, les spécificités et la valeur du champ ne sont pas nouveaux. Selon Earl Cheit (1991 : 72), le domaine s’est construit, comme la plupart des disciplines émergentes, sur des « restes », que les sciences humaines et les autres disciplines de gestion ont initialethématiques n’a pas nécessairement été favorable au champ B&S (Cheit, 1991; Post, 1991). En se diffusant auprès des praticiens, ces questions ont eu tendance à se banaliser et/ou à être expropriées par d’autres disciplines académiques mieux implantées au sein des Business Schools.
Cette situation est bien décrite par Cheit (1999 : 77), qui souligne « l’extraordinaire ironie d’un champ, qui s’est construit et qui a connu une croissance rapide en prenant en charge les questions laissées de côté par les disciplines, et qui est désormais en décélération car les disciplines ont finalement réincorporé de nombreux éléments cœurs ». Ce constat est partagé par James Post, qui concède que « les chercheurs du champ B&S traversent peut-être une crise d’identité à mesure que leurs questions deviennent légitimes », tout en ajoutant qu’« il est sans doute également vrai que les chercheurs du champ ont été moins habiles pour consolider leur territoire que leurs comparses académiques à le coloniser » .