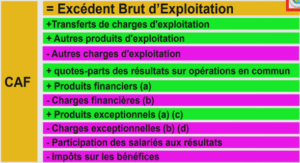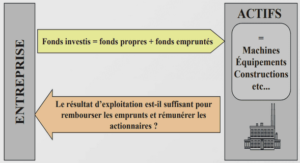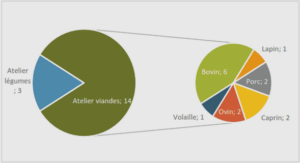L’abandon de la peine
L’abandon de la peine suppose de redéfinir la conception du comportement indésirable. Actuellement désigné comme un crime, Hulsman propose d’y substituer la notion de situationproblème (§1) qui permet de mieux englober la réalité des conflits. Le comportement indésirable peut ainsi être appréhendé différemment (§2). S’il s’agissait de ne retenir qu’un seul point de la pensée abolitionniste, il résiderait ici ; la réponse punitive n’est qu’une parmi tant d’autres. D’autres réactions peuvent émerger face à un événement dommageable. Les politiques pénales sont fallacieuses car elles présentent la punition comme une nécessité ou une fatalité.
Or punir est un choix grave qui doit être fait consciemment.
La notion de situation-problème
Les termes de crimes et criminels « reflètent les a priori du système punitif étatique ».
L’ensemble du vocable pénal est à refondre car il décontextualise la situation et se concentre sur une vision unique de celui-ci. Le dialecte pénal n’est pas neutre. Les mots ont une importance considérable, dès lors il faut parler d’acte regrettable, de personnes impliquées, de situation-problème298. Cela amène à développer une autre mentalité pénale et éviter les préjugés voire les “pré-jugements“ sur une situation.
La définition de la situation-problème : Les situations-problèmes sont définies par Louk Hulsman comme des « événements qui s’écartent négativement de l’ordre à partir duquel nous percevons l’enracinement de nos vies » 299. Pour rappel, ces événements négatifs sont une part impondérable de la vie société. L’objectif abolitionniste est seulement de mieux gérer ces événements et mieux vivre avec eux.
S’ensuit alors une classification tripartite. Certaines situations sont considérées comme problématiques par la totalité des personnes directement concernées par elles. D’autres le sont seulement par une partie des personnes concernées. Enfin, certains événements sont perçus comme problématiques uniquement par des personnes ou des organisations qui ne sont pas concernées300.
Cette définition présente l’avantage d’être uniquement descriptive, elle n’indique en rien comment la situation doit être traitée. Elle rétablit le « pluralisme institutionnel »301 qui comprend le droit au dissensus quant aux solutions à donner à un conflit et le respect de l’expression des minorités. Cela permet la libération des individus qui se sentent lésés ou blessés et qui pourront agir sur leur environnement à tous les niveaux302.
Approche anascopique plutôt que catascopique : L’approche catascopique est celle de l’État, il s’agit de traiter les problèmes du haut vers le bas, de l’État vers les citoyens.
L’État définit les cas où il agit, et les citoyens qui se trouvent dans cette situation le saisissent.
La vision catascopique empêche de problématiser et de rejeter le concept de crime car « “les faits“ tout comme “leur interprétation“ (…) dépendent principalement du cadre institutionnel de la justice pénale »303. Au contraire, la notion de situation problème renvoie à une vision anascopique, c’est-à-dire du bas vers le haut. Ce sont les personnes concernées qui déterminent que le comportement est indésirable, et qui le portent ensuite devant un organe de résolutiondes conflits.
Ainsi, la notion de situation problème est subjective puisqu’il appartient aux individus de déterminer les situations qu’ils estiment problématiques. On peut même parler de « situations problématisées », car les « phénomènes deviennent des problèmes sociaux lorsque des acteurs les définissent comme tels avec succès » 305. De la même façon, Claude Faugeron dans la postface de Peines Perdues306, propose de parler de comportement et de situation problème. Le crime n’existe que parce qu’il est pris en compte par une institution. Mettons un vol, le comportement est le fait de s’approprier la chose d’autrui, il s’agit d’un donné brut, d’un fait, tandis que le terme de situation problème signifie qu’il a été appréhendé par les communautés, le terme de vol signifie qu’il l’a été de même par les institutions pénales.
Les nouvelles conceptions du comportement indésirable
Punir les individus pour les actes problématiques qu’ils peuvent commettre revient à « se rabattre sur un système centralisé capable de mortifier la pléthore de significations et de solutions différentes » 322. Or, « l’idée qu’une solution unique et monolithique telle que celle de la peine puisse s’avérer socialement adéquate pour lutter contre toutes les formes de criminalité »323 doit être remise en cause. Le droit pénal propose une solution exclusive pour régler les conflits ; la punition. Or il existe différentes interprétations d’un fait, qui conduisent à différentes réponses et différentes formes de contrôle social.
Le cadre d’interprétation : Louk Hulsman et Jacqueline Bernat de Célis324 prennent divers exemples pour démontrer que la responsabilité individuelle ne va pas de soi.
Une bombe explose à Belfast et blesse un homme. Celui-ci peut interpréter cela comme une malchance, il perçoit alors l’événement comme un accident, dans un cadre de référence naturel.
La bombe est alors comparable à la foudre. Il peut aussi attribuer l’événement à une cause surnaturelle : Dieu ou le karma. S’il recherche « le “pourquoi“ de la bombe »325, il va se tourner vers un cadre de référence social. Il peut alors attribuer l’événement soit à une structure sociale soit à une personne ou à un groupe de personne. L’explosion peut être due aux tensions politiques et religieuses de l’Irlande du Nord, ou à un groupe de personnes impliquées dans une lutte, ou à la personne précise qui a posé la bombe.
Lorsqu’on pense à un accident de voiture, cela est encore plus parlant. L’individu peut y voir un accident dû au froid, à la collision des voitures, une punition divine, s’en prendre aux constructeurs de voiture ou à la façon dont les routes sont organisées, ou au conducteur de la voiture326. En effet, les conducteurs ont été responsabilisé pour les accidents de la route sans interroger la qualité des véhicules, des routes, le manque de transports publics, or il n’est pas évident que sanctionner les mauvais conducteurs soient le meilleur moyen de faire baisser le nombre d’accidents automobiles. Cela revient par ailleurs à nier que la voiture, en elle-même, est un mode de déplacement dangereux327.
Le lien entre le cadre d’interprétation et ceux à qui ou à quoi l’événement est attribué peut être schématisé tel qu’il suit.
Interprétation structurelle : L’abolitionnisme met l’accent sur l’interprétation structurelle des situations. L’avantage de la notion de situation problème est qu’elle évite d’identifier des coupables et des innocents. En effet, ce sont moins les personnes qui sont dangereuses que les situations. C’est bien une situation qui va faire éclater la dangerosité d’un individu329. Ainsi, le comportement indésirable est l’aboutissement d’un processus complexe qui peut mieux être pris en compte grâce à la notion de situation problème330. Il peut même s’agir de l’expression d’un malaise. Hulsman prend l’exemple de jeunes vandales qui dégradent une école. Après un réel dialogue avec eux, il découvre qu’ils sont jaloux des infrastructures qui y sont mises en place et qui n’existent pas dans leur quartier331. Il ne faut donc pas minimiser l’influence de la situation sur la réalisation d’un acte malfaisant.
Prendre en compte les causes structurelles d’un événement ne signifie pas que plus personne ne sera responsable. Il ne s’agit pas de supprimer la responsabilité, mais au contraire de l’élargir pour qu’elle se rapproche de la réalité, et pour que l’ensemble des participants à la commission d’un comportement indésirable participent également à sa résolution332.
Les styles de contrôle social : Une fois l’événement interprété, différentes réponses sont possibles. Reprenant l’exemple de l’accident de voiture, si l’événement est interprété dans un cadre de référence social, et attribué à une cause structurelle, la victime se rapprochera des organismes d’entretien ou d’organisation des routes. Si l’événement est attribué à une cause individuelle, le responsable serait l’autre conducteur ou lui-même333.
Si la cause de l’événement se trouve dans la structure, il faut mutualiser le problème àl’échelle à laquelle il intervient. La situation doit alors être gérée par la collectivité et lesassurances. Dans ce cas, il n’y aurait plus de coupables334.
Si l’événement est attribué à un individu alors différents styles de réponse sont envisageables. Mettons une colocation composée de cinq étudiants. L’un d’entre eux casse la télévision et des assiettes. Les quatre autres étudiants ne seront pas d’accord sur la marche à suivre ensuite. L’étudiant n°2 veut le mettre dehors. L’étudiant n°3 propose qu’il remplace la télé cassée et les assiettes. L’étudiant n°4 considère qu’il est malade et demande à ce qu’il se fasse soigner. L’étudiant n°5 suggère qu’il doit y avoir un problème dans leur communauté qui justifie cet acte. Le problème nécessite alors un examen de conscience collectif. Il s’agit respectivement des styles punitif, compensatoire, thérapeutique et conciliatoire335.
Ces styles peuvent être combinés et le choix du style à appliquer peut varier selon les événements. Mettons un adolescent qui refuse de venir dîner. Sa famille commencera par le punir. Il va fuguer. Alors elle adoptera un style conciliatoire pour arranger la situation. Dès lors que l’interprétation et le style varient, il est absurde d’avoir un modèle préconçu de réaction aux comportements. La flexibilité est capitale pour apporter une réponse efficace aux actes nuisibles.
Le problème du système pénal est qu’il privilégie majoritairement le style punitif et présente cela comme une nécessité. Le délit présuppose certains positionnements qui ne vont pas de soi : que l’événement soit considéré par les victimes comme indésirable, qu’elles l’attribuent à un individu précis, qu’elles désirent ensuite appréhender l’événement à travers un style punitif, et enfin qu’elles préfèrent que ce style punitif soit appliqué dans le système pénal337. L’apport fondamental des thèses abolitionnistes est de démontrer que punir est un choix et non une nécessité en ce que ce n’est qu’une voie parmi d’autres. Hulsman distingue les modes d’exercice positifs du contrôle social : fournir des moyens, une aide, un conseil, une récompense, et des modes négatifs : créer des obstacles, punir, réprimer, empêcher, diviser. Le style punitif et le style compensatoire vont favoriser des modes de contrôle social négatif, tandis que les styles conciliatoire, thérapeutique, et éducatif sont positifs en ce qu’ils réparent. La compensation doit intervenir en dernier ressort. Concernant la punition, il n’est pas possible de réellement la supprimer, quelques victimes ayant des sentiments rétributifs, la peine doit donc être diluée. Les mesures coercitives doivent cependant être choisies et prononcées par une autorité légitime reconnue des intéressés pour qu’elles soient justes338. Les styles de contrôle social peuvent être classés comme il suit, selon le Professeur McClintock tel que repris par Margaux Coquet339.
La refondation du système
L’abolition suppose la refonte complète du système pénal. Selon Jacqueline Bernat de Célis342, il s’agit surtout de supprimer le lien bureaucratique qui unit les agents du système. Leur rôle doit être profondément modifié (§2). En outre, l’abolitionnisme hulsmanien propose de nombreux modes de résolution des conflits (§1).
Les modes de résolution des conflits
Les situations et les comportements inacceptables sont multiples, complexes, et imprévisibles. Dès lors, il faut disposer d’une « variété de réponses sociales » 343. Le système de justice pénale n’en proposant qu’une, les abolitionnistes ont dû en imaginer de nouvelles. Pour cela, ils ont puisé dans les différentes expérimentations réalisées, ainsi que dans le droit comparé. Il s’agit principalement de mécanismes de justice restaurative définie par Vincenzo Ruggiero comme une justice centrée sur les acteurs et les communautés affectées par une situation, ceux-ci devant décider de la façon dont ils souhaitent traiter un conflit et neutraliser son impact collectif344.
Principes de répartition des conflits : La résolution du conflit réside dans les mains des personnes concernées, auteur, victime, et personnes non concernées, mais qui considèrent l’événement comme indésirable. Selon Bernat de Célis, si la situation est considérée comme problématique par l’ensemble des personnes concernées, il appartient aux groupes naturels ou aux instances conciliatoires d’intervenir. Il en est de même si elle est perçue ainsi par seulement une partie des personnes concernées, cependant l’accord des parties est alors nécessaire. S’il n’existe pas de relations préexistantes entre les personnes concernées, ou que l’une d’entre elles n’est pas d’accord, en un mot que l’intervention des groupes intermédiaires ou d’instances de conciliation n’est pas possible, le système civil peut être choisi345.
Ainsi, le choix du mode de résolution des conflits dépend de la volonté des parties, de leurs relations préexistantes, mais aussi du degré d’infection du conflit. Si le conflit est trop envenimé, l’intervention de la justice civile peut être préférée pour les garanties qu’elle fournit. Il convient d’étudier les différents modes de résolution des conflits.
Résolution grâce à la communauté naturelle : La solution du conflit n’a de légitimité que si l’autorité qui la prononce est reconnue, acceptée. En cas de contestation de l’autorité, il s’agit d’une violence pure et simple. Il est nécessaire que la solution du conflit soit élaborée dans les communautés naturelles des parties346. Les conflits émergent principalement dans les groupes intermédiaires, dès lors les groupes naturels doivent être le niveau auquel les conflits sont réglés, en priorité. Dans une vision anascopique, la société est définie comme un « conglomérat de tribus ». Partir des groupes naturels promeut « une position émancipatrice et libertaire face aux questions de régulation sociale et de contrôle social » 347. Les corps intermédiaires forment une authentique société car il existe en leur sein un consensus cognitif qui n’existe pas en dehors. Dès lors, ce sont les groupes intermédiaires qui doivent être chargés de la régulation des conflits, tant au niveau de la prévention, que de la résolution348. Néanmoins, le retour à des groupes plus restreints et plus proches n’est pas « l’utopie du retour au village », qui n’est qu’une « idée romantique sans espoir »349.
Dans des petits groupes naturels, la négociation, la médiation et la conciliation sont beaucoup plus facilement mis en œuvre qu’à une échelle plus élevée. Revenir à un traitement des conflits communautaires présente un triple intérêt : cela permet d’éviter l’isolement et l’anomie qui sont en général des facteurs de criminalité, les petits groupes ont en général des valeurs et des intérêts communs, et enfin rechercher communément une solution est une activitélibératrice et désaliénante350.
À ce niveau, grâce aux mécanismes développés ci-dessous, le style punitif peut perdurer car l’autorité des communautés naturelles sur les individus se réalise dans la proximité avec celui qui est puni351. Selon Christophe Béal et Luigi Delia352, la réponse punitive se maintiendra, mais elle ne doit plus être infamante et stigmatisante. Elle ne peut être choisie qu’en dernier recours et si la réconciliation n’est ni souhaitable ni possible. Cependant, Hulsman suppose que grâce à ces mécanismes de résolution des conflits, les sentiments rétributifs des victimes disparaitront. Cette disparition se réalisera non seulement à une échelle individuelle pendant la résolution, mais aussi à une échelle globale353.
Thibaut Slingeneyer relève alors que les groupes intermédiaires naturels ont entre eux des positions très variées. Les objectifs d’un village ou d’une entreprise ne sont pas les mêmes. De plus, au sein de ces groupes, il peut y avoir des relations de domination354. Nous ajouterons que la transaction pénale pour l’instant prohibée risquerait d’apparaître, avec les risques d’abus qu’elle peut impliquer. Il s’agirait alors d’appliquer une logique compensatoire aux situations problèmes. Si cela n’est pas problématique dans une logique abolitionniste, il y aura alors un risque que les accords formés soient extrêmement désavantageux pour l’une des parties. Il ne faut pas nier en outre les possibilités de corruption que peuvent entraîner une telle proximité. Néanmoins, les risques d’oppression ou de corruption sont contrés par la possibilité toujours offerte de se rendre devant la justice civile.
Confrontation encadrée : Concernant les affaires de petite importance, sans gravité, une confrontation entre les parties pourra être organisée devant la police, sans que celleci n’intervienne autrement qu’en réunissant les parties355. Celle-ci pourra aussi se faire auprès d’étudiants en droit356. De nombreuses affaires de voisinage, d’insultes, de menaces légères, ou autres incivilités pourraient être réglées par ce biais. Si elles ne sont actuellement pas englobées par le système pénal, nous pensons que favoriser le dialogue entre les individus est nécessaire pour éviter que les situations s’enveniment.
Dans cette optique, les règles posées par Willem De Haan357 relatives au « discours pratique » semblent pertinentes. Le point de départ du discours pratique est de discuter les attentes normatives de chacun, de discuter la morale de chacune des parties « sans recourir à la force, excepté celle du meilleur argument » 358. Le discours pratique suppose l’égalité de tous les participants, à laquelle les policiers doivent veiller. Chacun doit être rassuré en amont sur sa légitimité à participer à un tel débat. Évidemment, se confronter et argumenter n’est pas chose aisée. Puisqu’il ne repose pas sur une définition pénale, sur un concept de ce qui est bien ou mal, le discours pratique peut durer indéfiniment359. Si les parties ne parviennent pas à trouver une solution d’elle-même, il faut recourir à la conciliation du groupe naturel. Community boards : Les community board sont des organes de conciliation communautaires, des « mécanismes locaux de résolution des conflits »360. Ils sont composés d’un grand nombre de conciliateurs bénévoles qui forment des commissions ad hoc. Ils sont issus de la communauté naturelle des parties, ils doivent être représentatifs de celles-ci. Il doit en outre exister une « proximité entre les membres du conseil et les personnes directement impliquées »361. Ainsi, il doit y avoir au moins un membre appartenant au même groupe social ou au même groupe d’intérêts que chacune des parties.
Ils sont formés à ne pas proposer de solutions, mais ils aident les parties en les écoutant. Ils doivent permettre aux protagonistes de reconnaître leur conflit et d’élaborer une solution satisfaisante. D’après Jacqueline Bernat de Célis, les solutions peuvent alors être de type conciliatoire, compensatoires, thérapeutiques, ou encore décider de la séparation des parties.
Cependant, les solutions ne peuvent pas être contraignantes, cet aspect étant réservé au procès civil. Il s’agit de solutions informelles « positives » 362. Ce ne sont pas forcément de meilleures solutions que le droit pénal, mais elles sont « propres à aider chaque individu à mieux maîtriser sa vie ».
Le bénéfice de ces community boards est alors double : ils forment les gens, leur apprennent à être plus conciliants, et ils pourront s’appliquer même dans les communautés les plus marginalisées. Cela permet aux individus de s’auto-responsabiliser364. En outre, les membres des community boards ne le sont que pour deux ans, avec un renouvellement constant, ce qui fait que la société comptera de plus en plus de conciliateurs, et à terme c’est toute la société qui sera plus conciliante.