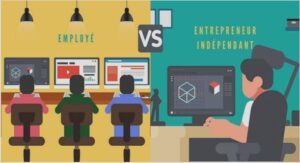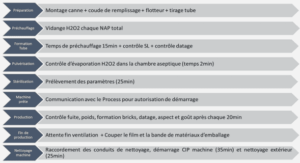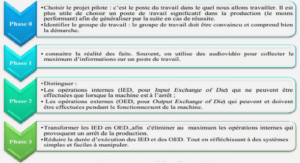LES MATRICES DE L’ENGAGEMENT
Genre et engagement : devenir ”porteur-e de valises” en guerre d’Algérie (1954-1966)
Les porteur∙e∙s de valises : des générations en guerre d’Algérie
S’intéresser aux cadres et lieux de socialisation des militant∙e∙s avant leur entrée dans le soutien nécessite de poser, d’emblée, la question des générations qui s’engagent contre la guerre d’Algérie et qui peuvent influer sur la socialisation politique. Cette première partie entend dès lors questionner les racines de l’engagement contre la politique 53 française en Algérie au prisme du facteur générationnel, c’est-à-dire de l’âge des individu·e·s qui s’engagent dans le soutien aux nationalistes algérien·ne·s. En effet, cette question apparaît primordiale, la politisation n’est en effet pas la même que l’on ait 20, 30 ou 40 ans en 1954 et le capital militant dont chacun∙e dispose à cette date peut différer.
Plusieurs générations de militant∙e∙s du soutien
A propos des générations d’hommes et de femmes qui s’engagent dans le soutien, Jacques Charby fait, dans l’introduction des Porteurs d’espoir, la distinction entre la génération des 40-45 ans, nés entre 1910 et 1915, qu’il décrit comme des « vieux routiers de l’engagement : communistes, trotskistes, socialistes, anarchistes ou autres », et celle des 35-40 ans, nés entre 1920 et 1925, « arrivés à l’âge adulte durant la Seconde Guerre mondiale et dont beaucoup, contrairement aux plus jeunes, étaient encore proches du PCF en 1954-1956 ». Il isole également un troisième groupe, la génération des 20-30 ans, « nés entre 1932 et 1940 », « pour qui la référence à la Résistance et à la lutte antinazie renvoyait plutôt à leurs parents et qui faisaient partie, sauf exception, de la génération des ‘‘appelés’’ […] [dont] beaucoup n’étaient pas du tout politisés [et] s’engageaient sur des bases morales ».
Si cette tentative de définition des générations engagées contre la guerre d’Algérie n’est pas sans intérêt, elle mérite cependant d’être nuancée et complétée. Premièrement, le fait de présenter la plus jeune génération, celle des 20-30 ans, comme la « génération des appelés », entraîne, d’une part, à ne prendre en compte que les hommes et donc de fait à exclure les femmes de l’analyse. Ensuite, une telle catégorisation tend à expliquer l’engagement des plus jeunes dans le soutien en réaction à l’envoi des disponibles, appelés ou rappelés en Algérie. Pourtant, non seulement les femmes sont nombreuses parmi les militant·e·s du soutien à appartenir cette génération, mais l’étude des motifs avancés par ces derniers et dernières pour expliquer leur engagement montre que l’opposition au départ des soldats est loin d’être l’unique facteur d’engagement. Il ne s’agit pas ici de dire que la question du service militaire en Algérie n’a pas pesé : elle a pu être un levier d’engagement, pour les hommes comme pour les femmes. Catherine Cot, par exemple, explique son entrée dans le soutien de cette manière.
Il s’agit plutôt de 1 J. Charby, Les porteurs d’espoir, op. cit., p. 24. 2 Cet exemple est développé dans le chapitre 2, « III.2.a) Le mouvement Jeune Résistance ». 54 souligner la diversité des leviers de mobilisation, qui caractérise cette génération, mais aussi les autres, donc de ne pas réduire a priori la génération des 20-30 ans à cette question du service militaire. Par ailleurs, Jacques Charby décrit cette génération comme non politisée et s’engageant d’abord sur des bases morales. C’est vrai pour certain∙e∙s des militant∙e∙s, comme Anne Ramonède, qui déclare n’avoir eu aucun engagement avant la guerre d’indépendance, que ce soit dans un parti, un syndicat, une association ou un groupe religieux.
Née en 1935, elle a 19 ans lorsque commence la guerre d’indépendance algérienne et travaille dans l’édition. Elle explique sa volonté de s’engager dans le soutien par « l’injustice et la répression, de plus en plus visible à Paris », avant de préciser : « mais c’était tard, environ deux ans avant la fin de la guerre. C’est alors que j’ai cherché les contacts ». La morale est au cœur de son engagement, intrinsèquement liée à la répression que subissent les Algériens, en Algérie mais aussi en France : Je n’ai été motivée que par une notion de justice : ce peuple avait droit à l’indépendance.
On la lui refusait. J’allais contribuer à l’aider. J’ai vu des scènes de répression de civils algériens. La France faisait en mon nom ce que je n’approuvais pas.Pourtant, l’affirmation de Jacques Charby sur la non-politisation est à nuancer, la génération des 20-30 ans se révélant très hétérogène. En outre, il semble faire de l’appartenance à un parti politique le seul vecteur de politisation, tout en opposant morale et politique. Les militant·e·s de cette catégorie, cependant, témoignent de leurs engagements autant que des ancrages politiques de leur réflexion anticoloniale, à divers degrés, sans que ce cela n’exclue les motivations morales.
En effet, nombreux et nombreuses sont les militant·e·s qui sont engagé·e·s dans des mouvements de jeunesse – tels que les Jeunesses Etudiantes Chrétiennes (JEC), l’Union Nationale des Etudiants Français (UNEF), ou l’Union des Etudiants Communistes (UEC) – ou dans des partis politiques, qu’il s’agisse du Parti Communiste Français (PCF) ou des mouvances de la Nouvelle Gauche puis du Parti Socialiste Unifié (PSU), à partir de 1960. Le parcours de Jean Berthinier reflète cette catégorie de jeunes militant∙e∙s pourtant politisés. Né en 1942 d’un père commerçant et d’une mère institutrice, explique que sa conscience politique s’est éveillée vers 1957-1958, sous la double influence de sa famille, catholique de gauche – ses mère et tante militent au Syndicat Général de 1 Questionnaire d’Anne Ramonède, 27 avril 2016. 55 l’Education Nationale-Confédération française démocratique du travail (SGEN-CFDT) – et d’un de ses professeurs, proche du PCF.
Il explique ainsi : « dès cette époque, je pensais politique ». Il rejoint brièvement Voix Ouvrière et distribue des « bulletins ronéotypés très laids […] au tout petit matin à la porte des usines » recevant à cause de cela des « insultes des cégétistes communistes, [et des] coups parfois ». Il déclare cependant avoir été rapidement « rebuté par la mentalité de secte trotskyste assiégée » de Voix Ouvrière, et, un temps, s’être rapproché des Jeunesses Communistes (JC). Pourtant, « le PCF [lui] apparaissait comme trop modéré sur l’Algérie », et, explique-t-il, « nous criions : ‘‘Algérie indépendante’’, et non ‘‘Paix en Algérie’’. ». Il rejoint l’UGS vers 1959, puis le PSU à sa fondation : il milite au sein de la section étudiante de la Fédération du Rhône, avant d’en devenir le secrétaire.
Une connaissance inégale de la situation coloniale
Si les entretiens révèlent une politisation préexistante au déclenchement de la guerre d’indépendance algérienne, la socialisation politique n’est pas forcément anticolonialiste. Dès lors et dans la continuité des questionnements précédents, il importe également d’étudier la connaissance qu’ont les témoins de la situation coloniale algérienne avant 1954, qui peut également dépendre du facteur générationnel. En entretien, trois séries de questions ont concerné la possible sensibilisation aux problèmes posés par la colonisation française et aux différentes revendications d’indépendance antérieures au début de la guerre d’indépendance d’une part, à la perception de la Toussaint 1954 de l’autre.
Pour une minorité des individu∙e∙s interrogé∙e∙s, le 1er novembre 1954 signe clairement le début d’une guerre d’indépendance en Algérie, s’inscrivant dans la continuité des mouvements indépendantistes algériens ou dans le cadre plus large des revendications anticoloniales. A l’inverse, de nombreux entretiens révèlent que la prise de conscience de la guerre d’indépendance s’est faite progressivement, révélant un phénomène de politisation décoloniale diffus, une sensibilisation croissante à la nécessité de soutenir les nationalistes algérien∙ne∙s. Ainsi, Nicole Rein, née en 1935, obtient sa licence de droit en 1956 et commence à exercer comme avocate en 1958. Elle rejoint par la suite le collectif parisien des avocat∙e∙s engagé∙e∙s dans la défense des frontistes1 , et c’est dans le cadre de sa profession qu’elle est amenée à prendre connaissance de la situation algérienne : 1 Voir à ce propos le chapitre 3, II.1. Les avocat e s, un engagement professionnel à la limite de la légalité ?. 59 Je ne connaissais pas beaucoup les horreurs de la colonisation.
On n’en parlait pas dans mes livres d’histoire et c’est en allant voir les Algériens en prison que j’ai connu ce que signifiait pour eux le 8 mai 1945.1 De même, Evelyne Sullerot, née en 1924 dans une famille protestante et qui se définit comme « progressiste » se souvient avoir pris connaissance de la signification du 8 mai 1945 en Algérie après la lecture de Nedjma, de Kateb Yacine, qui paraît en 1956 : Alors, à ce moment-là, moi j’avais lu avec une admiration sans borne, le roman Nedjma, de Kateb Yacine, c’est magnifique. Alors, […] j’avais écrit à son auteur. Et on a passé une soirée de pérégrinations […]. Et il sortait ce qu’il y avait de magique, de cette profondeur, de cette population [algérienne].
Mais en même temps, c’est lui qui m’a parlé du massacre de Sétif. Et curieusement je n’en savais rien. Quand il m’a parlé de ça et du nombre de morts qu’il y avait eu, alors à ce moment-là, les choses ont changé pour moi […]. Sétif, c’est horrible, hein ! Et on n’en savait rien ! Moi je vous dis, c’est Kateb Yacine qui me l’a raconté à sa façon. Bien sûr, lyrique. Parce qu’il était de Sétif. Et ça a tout changé pour moi.2 Les discussions avec des Algérien∙ne∙s apparaissent en effet comme un facteur de sensibilisation à la cause indépendantiste algérienne. C’est le cas, par exemple, de Clara et Henri Benoits, qui travaillent à la Régie Renault depuis 1949 pour la première et 1950 pour le second.
Née en 1930, Clara Hesser-Benoits est la deuxième enfant d’émigré∙e∙s hongrois∙e∙s installé∙e∙s en France dans les années 1920, puis naturalisé∙e∙s dans les années 1930. Son père, acquis aux idées social-démocrates, a toujours été syndiqué et participe à de nombreuses grèves à la régie Renault où il est employé. Si les discussions politiques sont rares dans la sphère familiale, Clara Hesser-Benoits se souvient pourtant avoir participé à un piquet de grève, à la régie Renault, sous le Front populaire. Elle « entre » chez Renault en 1949 comme sténodactylographe grâce à un de ses amis, rencontré aux Auberges de jeunesse dont elle est adhérente. La même année, elle participe au Festival mondial de la jeunesse et adhère au PCF.
Elle se syndique, dès cette année, à la section CGT-EDTA (employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise) de la Régie Renault et déploie une intense activité syndicale. A la suite d’une grève, en 1950, elle est élue déléguée du personnel – et le reste pendant vingt ans – et entretient de nombreux liens avec les employés algériens de la Régie Renault. Anticolonialiste, Clara Benoits déclare avoir été choquée par le communiqué du bureau politique du PCF à la suite de la Toussaint 1954, ses « idées internationalistes » ne cadrant par ailleurs pas avec la ligne communiste1 . Elle partage ces idées « gauchistes » avec Henri Benoits, qu’elle rencontre sur son lieu de travail « lors de la grève de février 1952 et des campagnes de solidarité aux centaines de licenciés de l’usine (février-juin 1952) » 2 . Le couple ne se marie qu’en 1963, refusant de se marier ou d’avoir un enfant dans le contexte de la guerre d’indépendance algérienne.
L’expérience de la situation algérienne in situ a également pu contribuer à la prise de conscience anticoloniale de certain∙e∙s militant∙e∙s du soutien. Ainsi, Gérard Chaliand fait l’expérience de la « situation coloniale » en Algérie où il se rend vers l’âge de 18 ou 19 ans, pour y effectuer des « petits boulots » : En 52-53, je me suis retrouvé dans une situation coloniale. Qui m’a étonné, parce que ce n’est pas ce qu’on nous a raconté à l’école. […] En Algérie, j’ai vu qu’il y avait des colons, qu’il y avait des pieds-noirs, de différentes couches sociales. Que d’une façon générale, les « Arabes », puisque c’est comme ça qu’on les appelait à l’époque, étaient des citoyens de deuxième catégorie et que cette situation ne durerait pas. C’est d’ailleurs ce que m’avait dit un des camionneurs qui m’avait fait monter en stop […].
Au moment où les évènements avaient commencé au Maroc, il m’avait dit : « Bientôt, ce sera notre tour ». Et là, c’était début 1953. Quand ça a démarré en 1954, moi ça ne m’a pas étonné du tout.4 De la même manière, Louis Orhant se souvient du choc qu’a constitué pour lui la découverte, en 1956, des inégalités entre Français∙e∙s d’Algérie et Algérien∙ne∙s, des conditions de vie et du racisme. Né en 1935, issu d’une famille ouvrière dont le père est un communiste convaincu, il milite très tôt dans des organisations de jeunesses communistes. Lorsqu’il perd son emploi d’ouvrier en fonderie chez Citroën peu avant son appel sous les drapeaux, en 1956, il se rend en Algérie pour une période d’un mois. Louis Orhant y est témoin des tensions qui existent sur le territoire et assiste notamment à une embuscade organisée contre des policiers français, au moyen d’un fil de fer tendu au travers de la route. Ce voyage, couplé à ses convictions politiques et à ses contacts avec des Algériens au sein de l’usine Citroën, le convainc de ne pas partir en Algérie.
Liste des dépôts d’archives et abréviations utilisées |