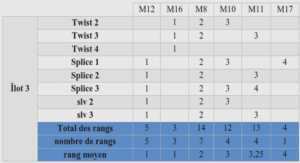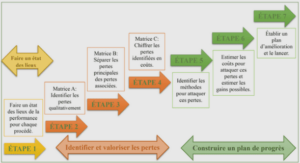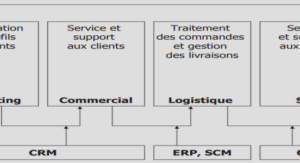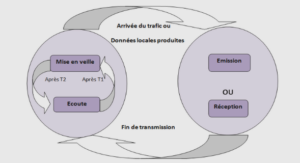SOCIETE CIVILE ET TRANSPARENCE DES TRAITEMENTS ALGORITHMIQUES
La société civile est amenée par son action à jouer un rôle essentiel dans la participation à la transparence des dispositifs numériques, ce qui fait partie intégrante de la démocratie continue1569.
L’objectif est de parvenir à un écosystème encourageant ce principe, notamment car force est de constater que d’une part les institutions relatives à la représentation ne peuvent pas tout, et d’autre part, la société civile participe déjà à la transparence des traitements algorithmiques. Il convient toutefois d’entretenir et d’accélérer ce mouvement.
Naturellement ces acteurs n’ont pas et n’auront pas tous le même point de vue sur la nature et le degré de transparence des programmes, mais la rencontre des intérêts, au sein de la société, fait émerger un débat, qui parfois est tranché par les tribunaux ou repris par le pouvoir politique. En ce sens, ils participent à la transparence des algorithmes, et plus largement au numérique. Cette société civile, dont font partie les corps intermédiaires1570, doit pouvoir s’épanouir dans un cadre juridique établi, ce qui ne l’empêche pas par ailleurs de s’exprimer en faisant peuple par l’intermédiaire de ses représentants1571.
Nous considérons que cette démocratie continue s’exerce au sein de la société civile à la fois de manière institutionnelle (Paragraphe 1) mais aussi non institutionnelle (Paragraphe 2).
La société civile non institutionnelle
Afin de s’assurer d’une participation active de la société civile au principe de transparence, il convient de prendre en considération le rôle joué par les associations en la matière et la manière dont il est nécessaire de favoriser cette action (A). Remarquons également que parmi la société civile non institutionnelle, le régime juridique du lanceur d’alerte doit évoluer, ne serait-ce que parce qu’il est démontré qu’il éclaire sur le fonctionnement de ces programmes (B).
Les associations et autres initiatives
Le rôle des associations est multiple. Elles jouent un rôle d’alerte, y compris en matière de transparence des traitements.
Bien que de nombreux acteurs participent dans une démarche individuelle à la justice, certains groupements comme les associations, dont la mission première est la protection des droits et libertés, œuvrent également au principe étudié. Il peut s’agir d’associations généralistes, car les algorithmes ont fait leur immixtion dans leur domaine, ou spécialisées. Ces dernières vont jouer tout à la fois une mission d’alerte et d’effectivité des droits et libertés, y compris dans l’environnement numérique.
Elles sont susceptibles d’y participer de différentes manières. Leur mission passe notamment par de nombreuses actions en justice pour contester certaines pratiques ou normes étatiques qui iraient à l’encontre des droits et libertés. Comme nous l’avons évoqué, c’est également devant les prétoires que les interprétations du droit s’entrechoquent. La difficulté réside dans le fait que sans procès, les faits juridiques échappent à la justice, ce qui est particulièrement frappant en matière numérique et a pour conséquence de réduire l’effectivité du principe de transparence. En effet, dans l’immense majorité des cas, la justice est rendue parce qu’à l’origine il y a l’initiative d’un requérant, et que par conséquent, ces acteurs y participent. La justice, en tant que corps constitué, incarne le rôle ternaire de l’Etat pour trancher une situation conflictuelle1572. Certaines associations bénéficient d’une importante expertise en matière de numérique, ce qui constitue un contrepouvoir politique et technique, surtout lorsqu’elles agissent en qualité de justiciable.
Nous pouvons en ce sens citer plusieurs exemples de décisions ayant fait évoluer le régime juridique de la transparence des algorithmes sous l’impulsion d’associations. Tel est le cas de l’Association « UNEF » concernant la contestation de la plateforme « Parcoursup »1573, ce qui a notamment abouti à une question prioritaire de constitutionnalité faisant évoluer le régime juridique du droit d’accès à ces algorithmes1574. Des entités plus spécialisées comme l’association « ouvre boîte » ont également participé à l’obtention du code source de logiciels utilisés par l’Etat en intentant un recours en justice devant le Tribunal administratif, et ce dans l’attente d’un avis CADA après le délai de deux mois1575. Plus récemment, elle a par exemple obtenu par ordonnance du Conseil d’Etat que soit enjoint au ministre de la justice l’arrêté prenant « le soin de fixer » pour chacun des ordres judiciaire et administratif et le cas échéant par niveau d’instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la disposition du public »1576. Même si nous avons évoqué notre réticence au regard de l’open data des décisions de justice1577, force est de reconnaître qu’il participe au principe de publicité des décisions des justices1578, et à notre sens, à la potentielle transparence directe des traitements automatisés réutilisant ces données1579.
Dans le cadre de l’urgence sanitaire mise en place lors de la pandémie de la COVID-19, période durant laquelle de nombreux traitements algorithmiques, y compris de données à caractère personnel, ont été déployés en dehors de tout cadre juridique, des associations, comme « La ligue des droits de l’homme » et « La quadrature du net », sont intervenues afin de mettre fin à certaines violations. Tel a été le cas de la surveillance par drone dans le cadre de missions de police administrative par la Préfecture de police de Paris. En effet, l’instruction a révélé que « les appareils en cause qui sont dotés d’un zoom optique et qui peuvent voler à une distance inférieure à celle fixée par la note du 14 mai 2020 sont susceptibles de collecter des données identifiantes et ne comportent aucun dispositif technique de nature à éviter, dans tous les cas, que les informations collectées puissent conduire, au bénéfice d’un autre usage que celui actuellement pratiqué, à rendre les personnes auxquelles elles se rapportent identifiables. Dans ces conditions, les données susceptibles d’être collectées par le traitement litigieux doivent être regardées comme revêtant un caractère personnel »1580.
C’est au vu des caractéristiques techniques de l’appareil qu’il a été permis de s’apercevoir qu’un tel usage n’avait pas encore été encadré par voie réglementaire1581, et donc que le régime juridique applicable était tout autre que celui argué par la Préfecture de Police, puisqu’il s’agissait bien d’une collecte de données personnelles. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence d’autoriser uniquement les vols de surveillance non dotés d’un tel zoom ou progressant à plus haute altitude, et ce afin de ne pas identifier les personnes. Au regard de ces éléments, il est possible de considérer qu’au même titre que les journalistes, les associations jouent un rôle de « chien de garde » de la démocratie1582, y compris concernant l’application des droits et libertés à l’environnement numérique.
Les associations en droit de la consommation n’interviennent pas que judiciairement puisqu’elles sont également très actives par l’intermédiaire d’enquêtes ou de débats publics comme sur l’obsolescence programmée, voire logicielle des objets numériques, et ce afin d’informer le consommateur, mais également de militer en faveur d’un régime juridique plus adéquat1584. En effet, des objets peuvent être rendus inutilisables à cause d’algorithmes, surtout à la suite de mises à jour altérant la jouissance du produit1585.
En matière de données à caractère personnel, les associations peuvent désormais sous condition1586 intenter des actions de groupe de plusieurs personnes physiques devant les juridictions civiles et administratives, dès lors qu’un dommage émane d’une cause commune à la violation de dispositions du RGPD et de la LIL1587, et ce dans le but d’en faire cesser le manquement ou d’obtenir réparation, ce qui inclut le respect du principe de transparence prévu par ce régime juridique1588.
L’agrément est au cœur de la participation à la cause de la transparence, car le plus souvent il permet à ces associations de gagner en visibilité et en efficacité. L’agrément octroyé par l’autorité publique à une association est une reconnaissance engendrant certaines incidences juridiques. Il va lui permettre d’obtenir une visibilité et une plus grande confiance vis-à-vis du public. Et surtout, l’intérêt à agir, nécessaire pour entreprendre des actions en justice pour faire respecter les droits et libertés fondamentales, est facilité, puisqu’il n’est plus besoin de le démontrer. Il existe par ailleurs de nombreuses catégories d’agréments1589 et elles n’emportent pas nécessairement le même régime juridique, raison pour laquelle nous plaidons en faveur d’un agrément qui serait propre à la matière numérique comme cela est aujourd’hui le cas en droit de l’environnement. Cette technique juridique est intéressante. En effet, comme nous l’avons vu, il existe des similitudes entre la matière numérique et environnementale, ne serait-ce que parce qu’elles sont fortement imbriquées. Les associations agréées protection de l’environnement peuvent prendre part aux débats « dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable »1590. Ainsi, cela leur permettrait de siéger dans certains comités décisionnels étatiques, voire de certaines grandes entreprises privées pour les associer à des prises de décision ou a minima à des réunions d’information sur les plus grands projets mettant en œuvre des traitements1591. La démocratie continue ne devrait pas porter que sur les actions des organismes publics. Elle doit aussi être pensée dans les relations avec les acteurs privés, car certaines activités privées sont de fait d’intérêt général, puisqu’elles exercent une incidence sur la société telle qu’il est légitime que les choix numériques ne soient pas uniquement du ressort de ces entités qui régulent par exemple la liberté d’expression. A titre d’exemple, concernant la Cour suprême Facebook, qui est amenée à statuer sur certaines censures, y compris de nature algorithmique, il est souhaitable que les associations disposant de cet agrément puissent également y siéger. Il en est de même dans l’acception et l’acceptabilité de la transparence à retenir dans ces domaines.