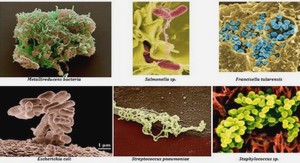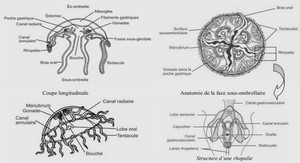Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Histoire de la collecte
Disons d’abord que la recherche documentaire a été multiforme et multidisciplinaire. Multiforme, car beaucoup des informations recueillies ont été prises à partir de documents écrits et chiffrés alors que d’autres données non moins importantes et imposantes , ont été puisées sur Internet.
Multidisciplinaire aussi, parce que des ouvrages sur le thème de l’enseignement supérieur, des actes de séminaires, des périodiques, des rapports de colloques, des ouvrages d’économies ont été effectivement consultés.
Cette recherche documentaire s’est principalement axée au niveau du service commun de la documentation de l’Ucad (la bibliothèque universitaire : BU), qui est interdisciplinaire, nous faisant gagner du coup un temps précieux.
La bibliothèque de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) nous a également servi de cadre de recherche, de même que celle du CREA (Centre de Recherches économiques appliquées).
La recherche documentaire, principalement statistique, a été aussi menée au rectorat de l’Ucad (Direction de la statistique).
Certaines informations ont été recueillies à partir d’autres travaux de mémoires et autres revues.
Ont été également des sources d’informations, le centre de recherche du CODES RIA.
En ce qui concerne l’enquête, elle comprenait les étapes suivantes : la pré enquête, le pré-test et l’enquête proprement dite sur le terrain pour mieux apprécier la scientificité de notre sujet de recherche ou problématique.
La Pré enquête.
L’objectif de cette démarche était d’éviter de soulever de faux problèmes.
Ce travail donc nous aura permis d’étudier les données statistiques existantes sur le nombre d’étudiants dans le privé, dans le public, le nombre de nationalités dans les établissements privés, l’année de création des écoles qui nous ont servi de cadres d’études etc.
Ainsi aussi, avons-nous pu mieux apprécier la représentativité de nos cadres de recherche à l’échelle nationale, à savoir le HECI, l’ITECOM, et l’IAM, à eux seuls, regroupent près du quart (¼) de l’ensemble des effectifs de l’enseignement supérieur privé.
Cette évaluation ne sera pas caduque, surtout lorsqu’il s’agira par la suite, d’effectuer des interprétations et de trouver des formules de généralisation des données.
Ainsi, en définitive, toute la pertinence de notre problématique de recherche a été passée au crible au cours de cette phase.
Le Pré-test.
Avant l’enquête proprement dite sur le terrain, notre questionnaire a été pré testé auprès d’un échantillon de sept (7) étudiants de l’Ucad présentant les mêmes caractéristiques que notre population mère (représentée par l’ensemble des étudiants du privé au Sénégal).
Ce sont quatre (4) filles et trois (3) garçons dont les âges varient entre vingt et cinq (25) et dix neuf (19) ans, et fréquentant des Facultés différentes (Faculté des Sciences et Techniques, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Faculté des Sciences économiques et de Gestion).
Ce travail de pré-test a été hautement bénéfique pour nous.
En effet, il nous a encouragé à apporter des correctifs dans notre questionnaire de départ.
L’objectif de ce travail était d’éliminer autant que possible toutes les sources d’erreurs qu’il pourrait y avoir dans la conception ou la forme de notre instrument de recherche.
Ceci a aussi rendu clairs et compréhensibles nos objectifs et nous a permis d’avoir des résultats fidèles et valides par rapport à notre thème de recherche.
L’enquête proprement dite.
L’enquête sur le terrain s’est déroulée durant un peu plus de trois semaines (du 10 au 25 Mai 2004).
L’univers de la recherche est constitué par l’ensemble des étudiants du privé répartis u niveau des établissements qui ont été effectivement choisis comme cadres d’étude à notre travail, je veux parler de IAM, ITECOM et HECI.
Il est à noter sur ce point précis, la variation constatée dans le choix de nos cadres d’étude, du moins, en ce qui concerne les frais de scolarité (les études aux HECI étant plus chères et celles à ITECOM, les plus abordables). Cette variation se retrouve également au niveau des effectifs des établissements (IAM sur ce point, est plus important et HECI, le moins important).
Par ailleurs, cette enquête sur le terrain s’est effectuée avec un échantillon de deux cent un (201) individus,à raison d’un quota de soixante dix huit (78)enquêtés à IAM et ITECOM et Quarante cinq ( 45) interrogés aux HECI. Parmi ces quotas, on veillé à avoir si possible des étudiants de la deuxième (2è) année et plus, ceux là qui sont, en principe, les mieux imprégnés de la culture de l’établissement qu’ils fréquentent ; ceux en qui se dessine le plus distinctement, les projets professionnels etc.
La représentativité des différentes nationalités a été aussi pour nous, un souci permanent. Et pour nous en assurer, nous avons mené ces enquêtes auprès de classes entières.
Ceci nous a fait faire d’une pierre deux coups, car, la question du rapport genre a été de ce fait, traitée.
En outre, au cours de cette enquête, nous n’avions pas choisi un calendrier bien défini qu’il fallait impérativement respecter , les obstacles et autres imprévus étant toujours à prendre en compte ;
Nous avions donc jugé plus efficace et de loin plus rapide, mais surtout plus fructueux, d’enquêter dans plusieurs établissements à la fois. Et mises à part quelques lenteurs notées çà et là à cause des rouages administratifs, l’enquête s’est généralement bien déroulée.
Par ailleurs, les entretiens exploratoires se sont effectuées pendant près de deux (2) mois, (du 15 Mars au 15 Avril 2004).
Ce fut évidemment dans le but de mieux évaluer la pertinence de notre thème de recherche, de mieux saisir l’orientation qu’il fallait donner à la recherche, mais aussi dans le but de mieux faire la jonction du qualitatif d’avec le quantitatif.
Ces entretiens (ou interviews) nous auront ainsi permis d’évaluer certaines de nos variables ou facteurs que les questionnaires standardisés ne pouvaient éclaircir, comme les données nos logiques, les motivations secrètes des enquêtés, leurs « backgrounds » culturels, leurs histoires et convictions personnelles.
Inventaire des techniques d’investigation.
La méthodologie, c’est l’art de la recherche scientifique. On entend par « méthodes », les « modalités d’action » par lesquelles le sociologue tente de résoudre le problème qu’il s’est posé.
Bourdieu a pu dire à propos de méthodes : « c’est à se demander ce qu’elles font aux objets et les objets qu’elles font »28.
Ainsi, vue la complexité de la nature de notre objet d’étude (les catégories des étudiants du privé, leur identité, leur motivation, leur rapport au savoir), l’utilisation simultanée des méthodes d’enquête dites « qualitatives » (ou intensives) et celles qualifiées de « quantitatives » (ou extensives) s’avère opportun. Parce que justement, ces méthodes ne doivent pas être utilisées de façon concurrentielle, mais l’une avec l’autre afin d’espérer arriver à une meilleure lisibilité des causalités de notre fait social.
A ce propos, nous citerons F de Singly qui disait que « la comparaison des renseignement obtenus par questionnaire et ceux obtenus dans des entretiens à propos du même objet informe sur les effets des deux situations d’enquête mais n’autorise aucune conclusion en terme de hiérarchisation des méthodes. Les questionnaires rendent visibles certains déterminants sociaux des trajectoires, les entretiens, la construction individuelle de ces trajectoires, et notamment l’appréhension de certains moments clés. Des deux côtés se trouve la richesse : davantage dans la complexité de la production pour l’enquête par questionnaire, davantage dans les manières dont les acteurs appréhendent (et contribuent ainsi à produire) le social pour l’enquête par entretien »29.
Concernant l’utilisation des techniques de recueil de données, il faut dire que c’est une étape importante dans le processus de recherche.
Aussi s’avère-t-il crucial de choisir les techniques les plus adéquates pour cerner notre objet d’étude.
Déjà, Pierre Bourdieu nous mettait en garde : « Toutes les fois que le sociologue est inconscient de la problématique qu’il engage dans ses questions, il s’interdit de comprendre celle que les sujets engagent dans leurs réponses » 30, d’où alors l’importance de cette phase de la recherche.
C’est ainsi qu’à la méthode « quantitative », nous avons associée l’utilisation de questionnaires à soumettre aux étudiants des différents établissements qui nous ont servi de cadres d’étude.
Le rôle du questionnaire est central car, comme le dit François de Singly, « le questionnaire a pour ambition première de saisir le sens «objectif des conduites en les croisant avec les indicateurs des déterminants sociaux, contrairement à l’entretien qui a pour fonction de reconstruire le sens subjectif, le sens vécu des comportements des acteurs sociaux […]. L’enquête par questionnaire a pour fonction de mettre à jour les déterminants sociaux, inconscients, des pratiques ».31
En outre, les techniques de recueil de données choisies pour l’enquête qualitative sont l’entretien avec des personnes ressources ou informateurs-cléfs (évoluant dans le secteur de l’enseignement supérieur privé) et de l’observation directe.
L’entretien ou interview est une technique d’observation qui comporte l’utilisation de questions plus ou moins directes adressées à des informateurs choisis en fonction de certaines critères préalablement définis, (ici, le choix a été porté sur des enseignants, des membres du personnel administratif des institutions d’enseignement supérieur privés, des Directeurs d’établissements, des syndicalistes, et des étudiants.
Le but de l’entretien est de recueillir des données essentielles sur les conditions de l’émergence de l’enseignement supérieur privé, l’organisation des établissements, l’enseignement qui y est dispensé, les caractéristiques socio-économiques des étudiants etc.
C’est donc un rapport oral, une discussion orientée, un procédé d’investigation utilisant un processus de communication verbale pour recueillir des informations en relation avec nos objectifs.
Ces entretiens feront l’objet d’une analyse de contenu afin de saisir derrière le discours des interviewés, la réalité sous jacente (parfois subjective) de leur prise de position.
Par ailleurs, l’utilisation de l’observation directe, pour ne pas dire « participante » se justifie par le fait que nous soyons assez bien imprégné des réalités de nos cadres d’étude, puisque évoluant dans l’enseignement supérieur depuis pas mal d’années maintenant.
La méthode d’observation participante (ou directe) a été très bien décrite par Henri Peretz32 « […] elle consiste à être le témoin des comportements sociaux, d’individus ou de groupes dans les lieux mêmes de leurs activités ou de leurs résidences sans en modifier le déroulement ordinaire. Elle a pour objet le recueil et l’enregistrement de toutes les composantes de la vie sociale s’offrant à la perception de ce témoin particulier qu’est l’observateur »
Echantillonnage.
La problématique de notre étude, à savoir la construction identitaire, la relation entre l’étudiant et le savoir, de même que les caractéristiques socio économico culturelles des étudiants du secteur privé ne peuvent être appréhendées et valablement estimées qu’à travers une bonne méthode empirique puisqu’il s’agit d’ausculter un phénomène relevant de conviction personnelle.
C’est donc un problème assez délicat, d’autant plus que la population concernée par cette étude est hétérogène, issue de diverses nationalités, multiculturelle…
Ceci nous a donc encouragé à choisir la méthode d’échantillonnage probabiliste pour l’administration des questionnaires.
Cette méthode d’échantillonnage également dénommée « aléatoire » relève d’un sondage scientifique qui obéit au hasard.
Le terme de hasard ne signifie pas fantaisie ou improvisation. D’ailleurs, l’étude des grands nombres de chiffres montre que le hasard lui-même présente des régularités.
La technique du sondage aléatoire permet de soustraire l’échantillon à un arbitraire ou personnel et de procéder à un véritable tirage au sort. Elle se définit par le fait que l’on accorde à chacune des unités de la population, une chance connue non nulle, d’appartenir à l’échantillon. On dira que l’on a effectué un sondage probabiliste si le prélèvement peut être assimilé à un choix au hasard
Ce choix de la méthode d’échantillonnage probabiliste répond à une nécessité d’obtenir un échantillon représentatif, garant de la scientificité de notre travail de recherche.
Rodolphe Ghiglione et Benjamin Matalon expliquent à ce propos « qu’en principe un échantillon est représentatif si les unités qui le constituent ont été choisies par un procédé tel que tous les membres de la population ont la même probabilité de faire partie de l’échantillon. Si ce n’est pas le cas, on dira que l’échantillon est biaisé : puis que certains individus avaient plus de chances que d’autres d’être choisis, les catégories auxquelles ils appartiennent occuperont dans l’échantillon plus de place qu’elles ne le devaient ; les caractéristiques de l’échantillon seront donc systématiquement différentes de celles de la population ».33
Par ailleurs, le technique utilisée est celle de l’échantillon des quotas. Les quels quotas seront constitués de soixante dix huit ( 78 ) unités (donc d’étudiants) choisis dans deux établissements d’enseignement supérieur privés (ITECOM, IAM) et quarante cinq ( 45 ) aux HECI.
Table des matières
Première Partie : Cadre d’analyse et approche générale de l’étude
Introduction
I –1.Objet d’étude
I –2.Intérêt du sujet
I –3.Revue de la littérature
I –4.Problématique
I –5.Hypothèse
I – 6.Définition conceptuelle
I – 7.Objectif général
I – 8.Objectifs spécifiques
I – 9.Modèle d’analyse
Deuxième Partie : Méthodologie et Historique de l’enseignement supérieur.
II – 1.Méthodologie
II – 1.1.Histoire de la collecte
II – 1.1.1.Le prè-enquête
II – 1.1.2.Le prè-test
II – 1.1.3.L’enquête proprement dit
II – 1.2.Inventaire des techniques d’investigation
II – 1.3.Echantillonnage
II – 1.4.Questionnaire
II – 1.5.Présentation des cadres d’études
II – 1.6.Difficultés rencontrés
II –2.Historique de l’enseignement supérieur
II – 2.1.Le contexte juridique
II – 2.2.Le contexte économique
II – 2.3.Le contexte démographique
II – 2.4.Le contexte éducatif
II – 2.5.Histirique de l’enseignement supérieur
Troisième Partie : Analyse et exploitation des données.
III – 1.Identité des étudiants
III – 1.1.Situation matrimoniale et nationalité des étudiants
III – 2.Itinéraire scolaire des étudiants
III – 2.1.Les filières d’étude
III – 2.2.Les types d’étude
III – 2.3.Les passerelles entre le privé et le public
III – 3.Origine sociale des étudiants
III – 3.1.Le capital culturel des étudiants
III – 3.2.Le capital économique des étudiants
III – 4.Les ressources financières des étudiants
III – 4.1.Les activités génératrices de revenus et la source de financement des études
III – 4.2.Les lieux de résidence des étudiants
III – 5.Construction identitaire chez les étudiants
III – 5.1.Les choix des filières d’étude
III – 5.2.Les raisons du choix d’études privées
III – 5.3.Les fonctions souhaitées par les étudiants
II – 5.4.Les secteurs et lieux d’activités professionnelles souhaités
III – 5.5.Le rapport des étudiants au savoir
– Conclusion
– Bibliographie
– Annexes
– questionnaires
– guide d’entretien