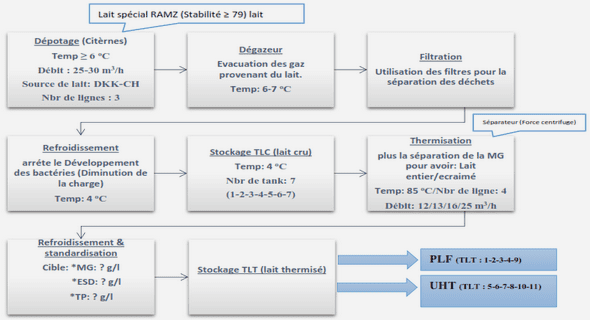Les indices cliniques Évaluation des pathologies
La gonométrie
Les repères anatomiques Les repères osseux principaux sont déterminés de la manière suivante : • Le point fémoral supérieur est le plus simple à déterminer : il s’agit du centre de la tête fémorale ‘C’ (Figure 16a), • Le point de la cheville est à peine plus délicat à déterminer. Moreland (Moreland et al. 1987) propose trois points proches les uns des autres (Figure 16b), en utilisant au final leur moyenne. Deltour (Deltour et al. 2005) quant à lui propose d’utiliser le milieu du dôme astragalien (centre du talus) qui, d’après lui, est le point le plus facile à repérer. Figure 16 : Références anatomiques (Moreland 1987). (a) – Le centre de la tête fémorale. (b) – Schéma présentant les différents centres de la cheville • Le centre du genou est le point de convergence de l’axe mécanique tibial et de l’axe mécanique fémoral.
Ce point est sujet à de nombreuses discussions. Moreland (Moreland et al. 1987) propose cinq points différents (Figure 17A) et conclut finalement qu’ils sont tous Centre du tissu mou Centre de l’os Centre du talus Les indices cliniques Évaluation des pathologies Yasmina CHAIBI Thèse de doctorat 38 très proches et qu’il convient donc de prendre le point moyen. Duparc et Massare (Duparc J. and Massare 1967) déterminent le centre du genou comme étant l’intersection d’une ligne tangente aux condyles fémoraux avec la perpendiculaire abaissée du milieu de la ligne qui joint les épines tibiales. Deltour (Deltour et al. 2005) considère que le centre du genou est le point situé au milieu de la ligne qui joint le sommet des épines tibiales, mais ajoute que dès qu’il existe la moindre translation du tibia sous le fémur dans le plan frontal, ce point ne sert plus qu’à la détermination de l’axe mécanique tibial (Figure 17B).
Pour tracer l’axe mécanique fémoral, il est nécessaire de localiser un quatrième point, le point fémoral inférieur. Figure 17 : Références anatomiques du genou. (Moreland 1987). (A) – Cinq méthodes de détermination du centre genou. (B) – Repères anatomiques de référence servant à définir les axes anatomique et mécanique du membre inférieur • Cooke (Cooke et al. 1991) et Oswald (Oswald et al. 1993) définissent le point fémoral comme étant le point le plus haut de l’échancrure inter-condylienne (Figure 17B). Deltour (Deltour et al. 2005) quant à lui, le définit comme le milieu de la droite qui joint le point le plus distal de chaque condyle fémoral. 1.2 Les principaux axes En pratique clinique, il est courant de tracer six axes fondamentaux pour exprimer la déviation angulaire du membre inférieur et de la hanche :
• L’axe mécanique fémoral qui va du centre de la tête fémorale au centre du genou (Figure 19B-1), • L’axe mécanique tibial, souvent associé à son axe anatomique (Duparc J. and Massare 1967, Oswald et al. 1993). C’est l’axe qui relie le centre du genou au centre de la cheville (Figure 19B-2), • L’axe bicondylien distal passant par les deux condyles distaux fémoraux (Figure 19B-3), • L’axe des fonds de plateaux ou axe biglénoïdien, qui joint les deux compartiments tibiaux (Figure 19B-4), • L’axe du col fémoral (Figure 19B-6), dont peu de définitions claires sont rapportées dans la littérature quant à son « traçage ». Néanmoins, tous les auteurs s’accordent à faire passer cet axe par le centre de la tête fémorale et le fût du col.
Ainsi, cet axe traverse ce dernier en son milieu. Dans la littérature, nous retrouvons quelques définitions plus précises. Tel est le Centre de la trochlée Centre des épines tibiales Centre des condyles fémoraux Centre du tissu mou Centre du tibia Yasmina CHAIBI Thèse de doctorat 39 cas pour (Yoshioka et al. 1987) qui fait passer cet axe entre le centre de la tête fémorale ‘C’ et le milieu de la section minimale du col ‘N’ (Figure 18A). Rubin (Rubin et al. 1992) quant à lui fait passer cet axe par le centre de la tête fémorale et le point ‘K’, point d’intersection de l’axe anatomique du fémur avec un axe ‘D’ perpendiculaire à ce dernier situé à 20 mm audessus du petit trochanter (Figure 18B). Finalement, Tian (Tian et al. 2003) associe à l’axe du col fémoral l’axe de symétrie des contours 2D de la tête fémorale et du col. Il applique par la suite un algorithme d’optimisation pour déterminer le meilleur axe de symétrie (Figure 18C).