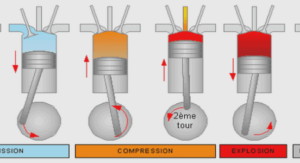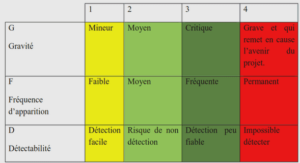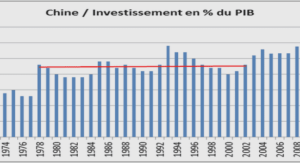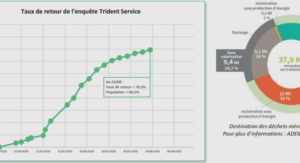Définition et répartition géographique dans les Niayes
La trypanosomose animale africaine est une affection parasitaire provoquée par des protozoaires flagellés du genre Trypanosoma, qui se multiplient dans le plasma sanguin, la lymphe et divers tissus, dont les muscles cardiaques et le liquide céphalorachidien des mammifères, y compris l’homme. Cette maladie sévit dans la plupart des régions tropicales, dont le Sénégal où elle constitue un obstacle majeur dans le développement de l’élevage (Finelle, 1983) surtout dans la zone des Niayes.
Au Sénégal, dans l’aire occupée par les glossines, le bétail héberge une ou plusieurs espèces de trypanosomes : Trypanosoma congolense, Trypanosoma vivax, et Trypanosoma brucei (Touré, 1972) avec une prévalence de Trypanosoma vivax et Trypanosoma brucei brucei supérieure à Kayar et à Pout qu’à Tassette, et moins importante à Kayar qu’à Pout où l’incidence annuelle à atteint 86% (figure 1). A ces études s’ajoutent des analyses sanguines montrant des séroprévalences trypanosomiennes chez le bétail de l’ordre de 28,68% (Trypanosoma vivax) et 4,36% (Trypanosoma congolense) avec une prévalence chez les jeunes bovins (< 3ans) trois fois supérieure pour les deux espèces dans les zones infestées par les glossines (Seck et al., 2010).
Par ailleurs, cette distribution trypanosomienne est en parfaite corrélation avec la répartition des glossines dans les Niayes (Seck et al., 2010). Ce qui montre que la transmission de la maladie ne s’est pas faite en l’absence des glossines malgré la présence de plusieurs vecteurs mécaniques dans la zone. Cela permet d’espérer une éradication de la TAA dans les Niayes si les glossines y sont éliminées.
Figure 1 : Résultats de l’enquête parasitologique dans la zone des Niayes (ISRA/LNERV, 2011)
Etiologie
Les trypanosomes, au corps fusiforme muni d’un flagelle, sont des protozoaires appartenant à l’embranchement des Sarcomastigophora, sous embranchement des Mastigophora, la classe des Zoomastigophora, l’ordre des Kinetoplastida, la famille des Trypanosomatidae, le groupe des Salivaria et le genre Trypanosoma (Marchand, 1994). Ils se reproduisent de manière asexuée par fission binaire et leur cycle de développement comporte six stades (amastigote, promastigote, opisthomastigote, épimastigote, trypomastigote et choanomastigote) d’environ 6 à 30 jours, partagé entre deux hôtes en général : un invertébré et un vertébré. (Marchand, 1994).
Au Sénégal, d’après Touré (1972), les espèces de trypanosomes qui existent (Trypanosoma congolense, Trypanosoma vivax, et Trypanosoma brucei) (figure 2) sont transmises aux animaux par les mouches piqueuses selon deux modalités : une transmission cyclique au cours de laquelle les trypanosomes se multiplient activement chez les vecteurs ; elle se réalise par l’intermédiaire des glossines et une transmission mécanique qui s’effectue par l’intermédiaire de divers insectes piqueurs tels que les tabanidés, les stomoxes et qui dépend de facteurs liés au parasite, au vecteur, à l’hôte définitif et à leurs relations. (Finelle, 1983)
Symptômes et diagnostic
La trypanosomose est une affection à évolution généralement chronique, le plus souvent mortelle si un traitement approprié n’est pas institué. Les symptômes les plus fréquents sont cependant sensiblement variables selon les espèces de mammifères, leur trypanosensibilité, leur gestion (alimentation) et les espèces de parasites. Ce sont entre autres : des poussées fébriles, des avortements, de la fièvre, des œdèmes, des larmoiements, un amaigrissement et une anémie importants, etc (Finelle, 1983).
Toutefois, aucun des symptômes n’est pathognomonique de la maladie. Leur association entraîne une forte suspicion dans un environnement de vecteurs connus ; mais à coup sûr, la maladie ne peut être diagnostiquée que par un examen microscopique du sang ou par réactions sérologiques (Finelle, 1983).
II-4. Impact économique
Dans le domaine vétérinaire, la trypanosomose constitue un des principaux facteurs limitants en Afrique subsaharienne, en gênant ou en empêchant les productions animales.
En effet, dans toute cette zone, et en particulier celle des Niayes infestée par les glossines, les pertes directes (amaigrissement, avortement, retard de croissance, chute de la production de lait, etc.) et indirectes (travail, capital, développement, revenus, etc.) enregistrées à l’échelle du troupeau sont importantes, bien que variables selon l’état de trypanotolérance des animaux. La production de viande peut être diminuée de 30%, celle de lait de 40% et la puissance de travail réduite du tiers. Par ailleurs, le coût des traitements n’est pas anodin car la chimiothérapie et la chimioprophylaxie sont largement utilisées chez les animaux avec au moins 25 à 30 millions de doses chaque année selon la FAO (1998), pour un coût annuel de 30 millions d’Euros. Ce qui représente un budget énorme. La levée de cette contrainte parasitaire conditionne donc directement la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et le bien-être des populations humaines.
LES VECTEURS DE LA TAA
Les vecteurs biologiques
Les glossines : systématiques et biologie
Les glossines sont les vecteurs majeurs des trypanosomoses humaines et animales en Afrique tropicale. Elles font partie de l’embranchement des Arthropodes, le sous-embranchement des Hexapodes, la classe des Insectes, la sous-classe des Ptérygotes, l’infra-classe des Néoptères, l’ordre des Diptères, le sous-ordre des Brachycères, l’infra-ordre des Cyclorraphes, la super-famille des Muscoidea, la famille des Glossinidae et le genre Glossina subdivisé en trois sous genre : Austenina (ou groupe fusca), Nemorhina (ou groupe palpalis), Glossina (ou groupe morsitans) (Brunhes et al., 1994). Dans la zone des Niayes au Sénégal, seule l’espèce Glossina palpalis gambiensis est présente (Touré, 1972).
Les glossines sont des mouches allongées, robustes, brun-noirâtres, de longueur d’environ 1 centimètre du bout des antennes à l’extrémité des deux ailes repliées sur le dos, de poids d’environ 12 milligrammes et ont une trompe piqueuse saillante qui révèle leur hématophagie (dans les deux sexes) (figure 3) (Bentaleb et al, 2008). Ce sont des insectes essentiellement diurnes qui vivent en zones intertropicales où la température moyenne est supérieure à 20°C et la pluviométrie aux environs de 400-600 mm. Elles se nourrissent, selon les espèces, sur une gamme plus ou moins large de mammifères sauvages ou domestiques, sur l’homme et les reptiles. Et c’est lors d’un de leur repas sur un hôte atteint de trypanosomose qu’elles s’infestent, pour toute leur vie, du parasite de la maladie et de là, elles peuvent transmettre ce dernier à tous leurs futurs hôtes nourriciers. Généralement, les glossines femelles après accouplement stockent dans leurs spermathèques le sperme qui leur sera nécessaire jusqu’à la fin de leur vie.
Elles sont larvipares et produisent une larve tous les 9 à 10 jours. Pendant environ un mois à un mois et demi de vie moyenne (maximum de presque un an), la femelle produit quatre à six larves. La larve émise s’enfouit rapidement dans le sol et devient une pupe (stade le moins vulnérable du cycle de la mouche). Dans un délai de 20 à 30 jours, un adulte va éclore par rupture circulaire du puparium, comme chez tous les diptères cyclorrhaphes.
Figure 3 : Illustration de la tsé-tsé. De gauche à droite : glossine adulte, face ventrale d’un mâle, face ventrale d’une femelle (Cliché M. Dukhan/IRD, Dominique Cuisance, Stéphane de La Rocque)
Les vecteurs mécaniques
Les Tabanidés : systématique et biologie
Les Tabanidés ou taons sont des diptères Brachycères Orthorraphes de la famille des Tabanidae et jouent un rôle important dans la transmission mécanique des trypanosomes animaux. Ils sont de distribution cosmopolite et sont représentés par environ 3 000 espèces dont seules les femelles sont hématophages (les mâles sont floricoles). Les espèces d’intérêt médical ou vétérinaire se rencontrent dans les sous-familles des Chrysopinae et des Tabaninae parmi les genres Chrysops, Haematopota, Atylotus, Ancala, Tabanus (Rhodain et Perez, 1985). Les tabanidés sont de grande taille (5 à 25 mm de long), plutôt sombres, bien que certaines espèces présentent des tâches de couleur claire (jaune) sur l’abdomen (figure 4). Leur tête large porte une paire d’yeux composés volumineux, jointifs sur la ligne médiane chez les mâles (yeux holoptiques) et séparés par une étroite bande frontale verticale chez les femelles (yeux dichoptiques) (Rhodain et Perez, 1985).
Les femelles se nourrissent le plus souvent sur un mammifère domestique ou sauvage, quelquefois sur des reptiles et rarement sur des oiseaux. Mis à part de rares espèces autogènes, la réalisation du cycle des tabanidés est étroitement dépendante de leurs hôtes (Desquesnes et al., 2005). L’accouplement a lieu très tôt après l’émergence des adultes, puis les femelles recherchent un hôte nourricier. Après le repas sanguin, le développement des ovocytes se fait en une semaine environ. Les femelles pondent (200 à 500 œufs) sur des brindilles, des herbes ou des arbustes.
Les larves carnivores, qui émergent des œufs une dizaine de jours après la ponte, ont un cycle complexe (9 à 10 stades) dont le développement est parfois suspendu par une phase de quiescence (jusqu’à 300 jours parfois). La nymphe cylindrique, possède un bulbe céphalique et des épines sur le corps. Elle est parfois aérienne, le plus souvent souterraine. Elle éclot une à trois semaines après la nymphose. La durée de vie maximale des adultes est de un à deux mois (Desquesnes et al., 2005).