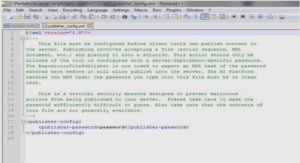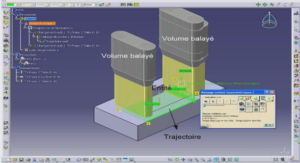Les fontaines et réservoirs
Fontaines
Les axes de circulation du bassin de la Karnali sont rythmés par la présence de nombreuses fontaines offrant l’occasion d’une halte. Les fontaines (Ju. mugrāhā, Skt. dhārā) sont placées de manière relativement régulière, et plus particulièrement dans les vallées des districts de Kalikot et de Jumla, de fait qu’un voyageur en rencontrera une à trois lors de sa journée de marche. Les fontaines sont typiquement creusées à flanc de colline, avec un parement vertical en pierres, sculpté de plinthes et de projections (Skt. bhadra) ou de pilastres, de la même manière que sur les façades des temples deval (Fig. 7.1). Dans la partie supérieure sont installés un ou deux goulots reliés à un conduit d’alimentation enterré. À l’instar des fontaines médiévales de la vallée de Kathmandou les goulots ont souvent la forme d’une tête de makara (animal mythique semblable à un crocodile, Fig. 7.2). Dans certains cas le goulot a une forme serpentine évoquant un chaperon de serpents (Fig. 7.3). Sur les deux côtés du panneau central sont placées des plateformes également sculptées. L’eau tombe entre les deux plateformes latérales, sur une dalle en pierre pouvant être creusée en bassin. L’écoulement est ensuite fait via un canal à parements en pierre, enterré ou hypêtre.
Les réservoirs
Un autre type d’infrastructure hydraulique concerne des réservoirs en pierre abrités par une toiture en dôme (Skt. vāpī, Ju. nāulo). À l’instar des fontaines, les réservoirs sont difficilement datables. Seuls deux monuments de ce type sont datés. Il s’agit des réservoirs de Patharnauli (DLK16-01.01, Fig. 7.10, Pl. 7.8) et de Kuchi (district d’Achham, Fig. 7.11) déjà évoqués précédemment. Ils sont tous deux construits en 1354 (SS 1276) par le ministre Devavarmā, pendant le règne de l’empereur Pṛthvīmalla (r. 1338-1358). Revenons sur la fin de la dédicace du réservoir de Patharnauli :
« Le Grand Ministre l’illustre Devavarmadeva a construit un réservoir […] en utilisant une nouvelle méthode332. » De quelle nouvelle méthode est-il question ? Comparons tout d’abord le bâtiment avec les autres réservoirs connus. Dans la vallée de la Karnali, un réservoir se trouve au village de Tatopani (en amont de sources d’eau chaude encore en activité, JUM13, Fig. 7.12, Pl. 7.6) et un autre dans le village de Jacha (SIJ31, Fig. 7.15, Pl. 7.7). Le bâtiment de Tatopani a un plan carré de 1,50 X 1,50 mètre. Les murs font près d’un mètre de hauteur. Ils supportent un dôme en lanterne de la même hauteur. La porte est orientée au sud/sud-est. Sur le linteau figure un bas-relief central de Gaṇeśa entouré par des volutes (Fig. 7.13). Directement à l’aplomb du seuil se trouve un bassin carré entouré par sept marches en pierre de dimension décroissante. Ces marches ne dépassent pas 10 cm de profondeur. La profondeur du réservoir est d’environ 80 cm, ce qui confère au réservoir un volume approximatif de 1,5 m3 .
Le réservoir de Jacha présente une forme pyramidale creuse avec deux niveaux internes. Le niveau supérieur est à peine accessible par une petite lucarne. Il comporte une stèle inscrite de plusieurs lignes en tibétain (Fig. 2.2 et 2.3). Au-dessous se trouve une ouverture plus large permettant d’accéder à un bassin en pierres de 20 cm de profondeur. Un conduit en pierre, plus tardif, distribue l’eau depuis son arrivée sur le mur ouest. Le liquide n’est donc pas stocké mais directement prélevée depuis l’extérieur. Le bâtiment est difficilement datable par critères stylistiques. Cependant, la présence de l’inscription en caractères tibétains, hypothétiquement datable des débuts de l’empire Khaśa Malla (cf. discussion Ch. 2), pourrait postuler une datation haute, vers le XIIe -XIIIe siècle.
Les piliers mémoriels
Le bassin de la Karnali est ponctué de nombreux piliers (ou stèles) en pierre, disposés en groupe ou seuls. On les retrouve près des temples, des fontaines, ou de manière isolée. Comme le note M. Lecomte-Tilouine, nombre de ces objets sont déplacés par les villageois et réinstallés en bord de chemin suite à leur découverte lors de travaux divers334. Il est également dit que Y. Naraharinath a déplacé certains piliers, comme ceux de Satkhamba (DLK19, Fig. 8.1 et 8.2). Compte tenu de ces interventions, l’orientation de ces artefacts sera ici considérée comme scientifiquement non-exploitable. À ma connaissance, seuls les groupes de piliers sur plateforme de Laha (MUG03, Fig. 8.1) et de Rara (MUG15 peuvent être considérés comme étant en position initiale. Les piliers de Laha sont orientés au sud-est et ceux de Rara au sud.