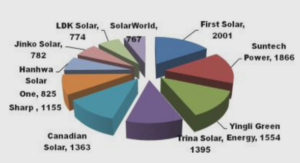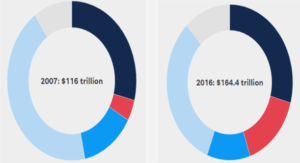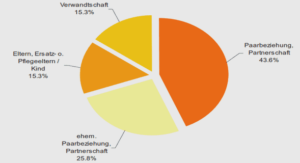La philosophie morale américaine comme clef de décryptage des théories
La philosophie morale et politique américaine, depuis les travaux de John RAWLS (1971), offre deux réponses tranchées à la question de l’identification et de la spécification des minorités65 : une réponse néo-libérale directement inspirée des travaux de RAWLS (qui, à l’extrême, rejette la pertinence de la notion de minorité), et une réponse « communautarienne », élaborée en riposte à la première. On montre toutefois que ce débat correspond assez bien à ce qui caractérise les anglo-saxons et que, dans le contexte français, une voie pragmatique intermédiaire semble devoir et pouvoir être trouvée.
Les deux approches (néo-libérales et communautariennes) obéissent de surcroît à des positionnements épistémologiques radicalement opposés : -l’Individualisme Méthodologique pour la première, et –le Holisme Méthodologique pour la seconde.
L’approche néo-libérale ou la non spécificité de l’entrepreneuriat immigré
Même si RAWLS construit sa philosophie en rupture avec l’utilitarisme, son approche individualiste s’inscrit dans la filiation des travaux de la philosophie politique libérale, comme on le montrera (2.1.2.1.) avant d’en envisager les conséquences (2.1.2.2.) et les limites (2.1.2.3)
La tradition libérale
La longue tradition de la philosophie politique libérale (MANDEVILLE ; Adam SMITH…) trouve un certain achèvement dans l’œuvre de RAWLS même si ce dernier s’écarte des critères de jugement des actions mis en avant par ses prédécesseurs et, en particulier, de l’utilitarisme. Rappelons que l’objectif de RAWLS était de dégager les principes les plus généraux et les plus universels possibles pour apprécier les actions qui sont justes dans le contexte des sociétés démocratiques occidentales.
En raison de ce dessein universaliste, on caractérise sa « théorie de la justice » de « théorie de la justice globale » par opposition avec des approches de la « justice locale »66 qui, au contraire, mettent l’accent sur l’existence d’une pluralité de principes de justice comme le font notamment les auteurs de la Théorie des Conventions et, par exemple, BOLTANSKI et THEVENOT (1987, 1991).
Les principes consensuels que RAWLS retient pour fonder sa « théorie de la justice » sont l’attachement à la démocratie et l’égalité des hommes « dans l’accès à des libertés de base » qu’il considère comme une caractéristique sous-jacente de l’idéal démocratique. Ces deux principes sont connus sous le nom de –principe de liberté et de –principe de différence.
L’auteur les pose comme résultant d’un « contrat social » et, en ce sens, sa théorie peut être rapprochée des traditionnelles théories du contrat social (ROUSSEAU, HOBBES, LOCKE, voire KANT) qu’il actualise en quelque sorte.
Ainsi, comme le résume François TERRE, (1988, p. 10), « au fondement de sa construction, il imagine une position originaire dans laquelle les individus prêts à discuter des principes de justice appliqués dans la société où ils seront amenés à vivre ensemble, ignoreraient tout ce qui les différenciera concrètement. (…). Ils ne connaissent pas ce que seront leurs familles, leurs classes sociales, leurs fortunes, leurs races, leurs convictions, leurs aptitudes….. Situés de la sorte en position de négociation collective, équitable et égale, les individus s’accorderaient » sur les deux principes fondamentaux de liberté et de différence.
De ce fondement découle toute l’originalité de l’œuvre de RAWLS, sa force comme ses limites. Pour appréhender la justesse d’une action, seul semble compter l’individu, en faisant abstraction de ses caractéristiques socioculturelles. C’est en cela que John RAWLS, comme les économistes libéraux, est profondément individualiste. Enfin, comme le reconnaît SEVE (1988 ; p. 27), le plus curieux dans la construction rawlsienne du contrat social, au moins pour un européen, c’est aussi l’absence de prise en compte de l’Etat et d’autres institutions auxquelles l’individu se soumettrait ou recourrait. « Le contrat social sert, en effet, traditionnellement à fonder l’obligation politique envers le souverain » (SEVE, op. cit.). Ainsi, chez LOCKE67 , l’obéissance à l’Etat, découlant du « contrat initial », doit se poursuivre par la suite. Au contraire, « puisque (pour lui) la position originelle ne fonde pas d’obligation imprescriptible envers un supérieur (l’Etat), John RAWLS rejette comme un artifice inutile la théorie du consentement, tacite ou exprès, aux lois de la cité, comme si chaque citoyen devait allégeance au souverain, car cette allégeance n’obligerait pas en conscience » (SEVE, op. cit. ; p. 28 ; RAWLS, « Théorie de la Justice », &51).
En l’absence de souverain supérieur ou de juge-arbitre68, les individus s’entendraient sur le principe de liberté qui permettrait à chacun d’entreprendre ce que bon lui semble. Tout le monde possède le droit d’entreprendre, d’émettre un avis et de peser sur les choix publics parce que chaque individu revêt a priori une valeur égale à celle des autres.
Evidemment, de cette liberté d’entreprendre pourrait émerger par la suite des inégalités, les plus doués, les plus efficaces, les plus forts, les plus favorisés par le sort, risquant de s’imposer progressivement. D’où la nécessité du second principe dit de différence qui reste subordonné au premier, ce qui implique que l’on ne doit notamment pas, pour combattre les inégalités, aller à l’encontre des libertés individuelles. Dans les termes de RAWLS, le principe de différence admet que « les inégalités sociales et économiques doivent être aménagées de telle sorte qu’elles soient assurées, en dernière analyse, pour le plus grand profit des plus défavorisés ». RAWLS rejoint la pensée d’Adam SMITH (1776) elle-même inspirée de la célèbre Fable des abeilles de Bernard de MANDEVILLE (1750). Dans cette tradition, la position néo-libérale de RAWLS considère que l’affirmation individuelle prime sur toute inscription communautaire de l’individu. En ce sens, RAWLS est un pur « subjectiviste ». Pour lui, « le moi est premier par rapport aux fins qu’il défend» (op. cit., &84 ; p.601).
Par la suite, les règles économiques imposeraient des modes d’action sociale normés en permettant à l’individu de porter un jugement sur ses actes. Il n’y aurait pas lieu de distinguer les pratiques entrepreneuriales des immigrés des autres entrepreneurs, lesmodes de jugement individuel étant de même nature. A l’extrême, l’étude de l’entrepreneuriat ethnique ou immigré en tant que tel serait sans objet puisque, à terme au moins, les entrepreneurs immigrés ne se distingueraient pas des autres entrepreneurs !
Les débouchés sociologiques, pratiques et épistémologiques de la position philosophique rawlsienne
Sur le plan sociologique, cette approche débouche sur une perspective « assimilationniste » (théorie du Melting-pot) que l’on retrouve fréquemment dans la littérature sur l’entrepreneuriat ethnique et plus largement dans toute littérature sur l’insertion des migrants dans l’économie. L’idée en est qu’à terme plus ou moins lointain, tous les groupes ethniquesdisparaîtraient pour se fondre dans le creuset de la nation. Malcom CROSS et Roger WALDINGER (1997) rapportent ainsi « les idées classiques de Robert PARK (1928) et de Milton GORDON (1964) », selon lesquelles « l’assimilation représente le point culminant d’une véritable insertion, depuis la période initiale de séparation et de concurrence jusqu’au point où les valeurs et les façons de vivre des migrants ne se distinguent plus de celles de la majorité, en passant par l’adoption » (op. cit., Chapitre 3, p. 1).
Le dilemme américain», une critique « de l’intérieur »
Avant l’œuvre de RAWLS, MYRDAL en critiquait pragmatiquement les fondements en constatant que la démocratie américaine était incapable de résoudre l’inégalité entre les blancs et les noirs. Le principe de liberté et le principe de différence paraissent inconciliables, car la situation d’inégalité apparaît à MYRDAL comme statique. Il décrit la société comme divisée en deux castes: la caste dominante blanche qui a le pouvoir politique, et la caste subordonnée noire. Il observe l’apparition de leaders noirs contestant plus ou moins l’ordre établi69 et tenant en quelque sorte un discours culturaliste ou, à tout le moins, centré sur l’étude du leadership (Marco MARTINIELLO,1992 ).
Pragmatiquement et semble-t-il à contrecœur, MYRDAL appelle au dépassement des représentations trop individualistes. Partant d’un constat d’inégalité, son diagnostic autorise un traitement scientifique différencié des populations immigrées.
Plus récemment, d’autres auteurs anglo-saxons qui, au départ, partageaient les thèses assimilationnistes, se sont trouvés face au même dilemme que MYRDAL et ont dû reconnaître que, dans certains cas, le processus d’assimilation semblait bloqué. WALDINGER et alii (1996, p. 18-19) notent que c’est particulièrement vrai de certains immigrants non européens aux Etats-Unis pour qui les désavantages socio-économiques qu’ils perçoivent ne diminuent pas avec le temps70. Alejandro PORTES (1995) montre de son côté que l’assimilation est un concept ambigu, en soulignant que certains enfants de migrants adoptent les valeurs des classes sociales défavorisées et rejettent tout processus entrepreneurial qui les rapprocherait des classes dominantes. Il rapporte ainsi des observations effectuées dans le Bronx où les Portoricains, porteurs de projet, étaient rapidement montrés du doigt et considérés comme « traîtres », « cherchant par l’entrepreneuriat, à devenir blancs ».
Dans le prolongement des travaux de Gunnar MYRDAL, la position intellectuelle de John RAWLS a suscité une vive réaction « communautarienne » émanant d’auteurs qui mettent en avant le rôle des particularismes sociaux et culturels dans la constitution de l’individu. Cette perspective que nous allons discuter (2.1.3) est le fondement des théories de l’entrepreneuriat ethnique que nous présenterons ensuite.
Une approche communautarienne extrême
Lorsqu’il traite des patients immigrés africains, Toby NATHAN considère que l’héritage freudien est nul et non avenu….. L’auteur , psychanalyste-thérapeute, se revendiquant de l’ethnopsychiatrie à la suite de G. DEVEREUX, est extrêmement explicite : « s’il existait une morale de notre profession, elle devrait nous interdire –je dis bien interdire ! – de penser le migrant en souffrance hors de son groupe (…). Il suffit de comprendre que devant un cas donné, l’interlocuteur n’est pas la personne mais le groupe, puisque nous sommes nous-mêmes un groupe ! pas le groupe, mais ses représentants puisque nous-mêmes ne sommes pas autre chose que des représentants…. » (T. NATHAN, 1996, cité in BOUCHER, 2000, p. 240).
Dans le domaine de l’accompagnement de porteurs de projet, cela voudrait dire que les dispositifs « occidentaux » seraient à coup sûr inadéquats pour aider le créateur immigré71. A défaut, il faudrait internaliser dans l’accompagnement la culture de l’immigré : « tout faire pour agir en Soninké avec un patient (pour nous un porteur de projet) Soninké, en Bambara avec un Bambara, en Kabyle avec un Kabyle… » (T. NATHAN, 1994, p. 24). « Sinon, le marocain, le Bambara, lorsqu’il est pris en charge dans l’un des réseaux des blancs, ne peut que ressentir la cruelle absence de tout représentant autorisé de ses groupes de référence » (T. NATHAN, 1996).
D’ailleurs, M. BOUCHER ne s’y trompe pas. Commentant ce texte de T. NATHAN, il conclut : « Dans ces conditions, l’intégration des migrants étant impossible, des individus dans des groupes distincts sont donc condamnés à rester entre eux, chez eux, ou bien séparés dans un même espace » (op. cit., p. 240).
Cette conclusion, appliquée aux relations économiques et à l’entrepreneuriat conduirait à une ethnicisation marquée et irréductible du processus entrepreneurial et, par la suite, de l’économie. Cette constatation semble pour le moins excessive, d’autant qu’il a pu être également démontré que l’inscription dans le commerce ethnique n’était pas nécessairement synonyme de cloisonnement social pour l’individu immigré au sein de sa société d’accueil (RAULIN, 2000)72, car il n’est pas rare de rencontrer des entrepreneurs immigrés « jouant sur les deux tableaux ». « L’économie ethnique correspond d’ailleurs fréquemment à des marchés et à des consommations qui ne se limitent pas aux populations ethniques de référence» (M. WIEVORKA, 2000, p. 115).
L’intérêt de la théorie de T. NATHAN pour notre thèse ne réside pas dans ses conclusions, mais plutôt dans sa force de questionnement des dispositifs d’accompagnement génériques et de leur éventuelle inadéquation au suivi d’entrepreneurs fortement enracinés dans leur culture d’origine.
Globalement, ce survol des positions philosophiques pertinentes pour l’étude des minorités nous permet d’envisager plusieurs approches de l’entrepreneuriat immigré comme l’illustre le synoptique de la Figure 2.1. Dans les deux positions extrêmes, l’étude de l’entrepreneuriat immigré n’aurait pas de sens. Les quatre positions intermédiaires servent de fondements aux principaux travaux théoriques sur l’entrepreneuriat ethnique et sur l’entrepreneuriat des migrants. Il est désormais possible de les passer en revue.
Une entrée par la différence culturelle
Définissant la culture d’un groupe comme un système de significations et de valeurs apprises et partagées par la majorité de ses membres et se reflétant dans leurs pratiques, HOFSTEDE (1994) a proposé une grille instrumentale mesurant les principales différences culturelles.
Cette grille, bien connue, repose sur 4 items :
-la distance hiérarchique qui mesure le degré d’acceptation des inégalités par le groupe ;
-le rapport à l’incertitude estimé à partir du « degré de contrôle de l’incertitude » du groupe, c’est-à-dire du « degré d’inquiétude de ses membres face à des situations inconnues ou incertaines » (p. 150) ;
-la position par rapport à la masculinité et à la féminité. Sont dites masculines « les sociétés où les rôles sont nettement différenciées (où l’homme doit être fort, s’imposer et s’intéresser à la vie matérielle, tandis que la femme est censée être plus modeste, tendre et plus concernée par la qualité de la vie); sont féminines les sociétés où les rôles sont plus interchangeables » (p. 113) ; -la position plutôt individualiste ou plutôt collectiviste du groupe, « l’individualisme caractérisant les sociétés dans lesquelles les liens entre les personnes sont lâches ; chacun doit se prendre en charge ; à l’opposé, le collectivisme caractérise les sociétés dans lesquelles les personnes sont intégrées, dès leur naissance, dans des groupes forts et soudés qui continuent de les protéger tout au long de leur vie, en échange d’une loyauté indéfectible » (HOFSTEDE, p. 76).
Asie, Afrique, Turquie et pays arabophone seraient ainsi globalement plus collectivistes que les pays du Nord. Dans les pays africains, la description du collectivisme s’apparente très explicitement au « tributariat » que WAGUE (1998) présentait en soulignant l’importance de l’influence communautaire sur l’entrepreneur. « Dans les pays africains, l’individu existe en raison de son appartenance à une communauté. Il en est de même de l’entrepreneur. A la différence notable que celui-ci a la particularité d’être mieux doté économiquement et, de ce fait, il acquiert un pouvoir d’action et donc une marge de liberté par rapport à l’individu ordinaire. Cependant, il est sous la pression économique de sa communauté. Celle-ci est régie par des droits et des obligations qui s’imposent à chacun de ses membres.
L’entrepreneur subit des obligations de redistribution plus accentuées », obligations qui passent par l’embauche de membres de la communauté. TSIKA (1995) souligne ainsi que les entrepreneurs africains « éprouvent d’énormes difficultés à desserrer l’étau du tributariat, terme par lequel on désigne une sorte d’impôt de reconnaissance sociale qui s’impose à eux, c’est-à-dire un ensemble de transferts contraignants et de tous ordres en direction du groupe familial ou plus largement lignager. Quand le sujet ne parvient plus à s’acquitter de ces obligations communautaires et traditionnelles, il est alors sujet à la sanction constituée par l’absence de reconnaissance de son statut, de sa position sociale et de son rang familial et se place sous la menace d’une répression magico-religieuse qui peut aller jusqu’à en faire la victime de faits de sorcellerie» (p. 251).
Dans le prolongement de ces travaux, KOMBOU et SAPORTA (2000) ont souligné combien cette primauté donnée à la communauté sur l’individu remettait en cause les modélisations de l’entrepreneuriat existantes. La grille d’HOFSTEDE identifie des « programmations mentales » différentes suivant les pays (HOFSTEDE, 1994). A la lumière des quatre items qui la composent, il serait possible de dépeindre les traits culturels supposés de tout individu suivant son pays d’appartenance. Récemment, en se fondant sur cet outil, un étudiant de DEA, GHARBI (2000), a même essayé de décrire l’entrepreneur méditerranéen, prouvant ainsi qu’il serait possible de construire un idéal-type. La question posée est de savoir, dans le cas d’un entrepreneur immigré, si l’on peut se référer à ce type d’analyse. Peut-on tenter d’interpréter les difficultés d’un entrepreneur immigré d’origine marocaine entreprenant en France par l’écart des programmations mentales entre France et Maroc ? Bien que cette approche paraisse séduisante, nous répondrons par la négative. Auparavant, nous devrons admettre que cet outil a déjà été mobilisé dans la recherche en Entrepreneuriat et envisager ce que serait un modèle entrepreneurial africain/ turc / chinois qui puisse servir de référence à l’entrepreneuriat immigré (2.2.2).
Plusieurs auteurs ont déjà utilisé la grille d’HOFSTEDE dans le cadre de recherches en Entrepreneuriat, le plus souvent dans une perspective de comparaisons internationales et en s’attachant surtout à l’item Individualisme/ Collectivisme. Il en ressort en général que les sociétés individualistes cultiveraient davantage l’esprit entrepreneurial (notamment en en retenant l’acception la plus restrictive, c’est-à-dire en se focalisant sur les « entrepreneurs entreprenant » et innovateurs) comme le suggère l’étude de PETERSON (1980).
Dans le même ordre d’idées, à partir d’un large échantillon d’entrepreneurs appartenant à 11 pays, SCHEINBERG et Mac MILLAN (1988) et CONSIDINE, Mac MILLAN et TSAI (1988) ont pu mettre en évidence statistiquement des accents différents quant à la motivation entrepreneuriale première des entrepreneurs suivant leurs cultures. Ils ont ainsi remarqué que les « Latinos » (entrepreneurs originaires du Portugal, d’Italie et de Porto-Rico dans l’échantillon) étaient significativement plus sensibles à la dimension « communautaire » (entreprendre pour contribuer au bien-être de la communauté ethnique proche) que les entrepreneurs « anglo » (Entrepreneurs d’Australie, du Canada, des Etats-Unis et du Royaume Uni) qui verraient, au contraire, avant tout l’entrepreneuriat comme un moyen d’accroître leur statut personnel.