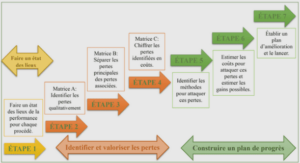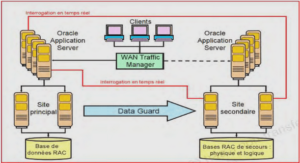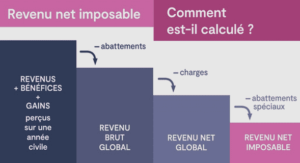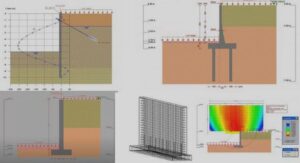La ferme solaire d’Akuo Energy, à La Réunion
Promouvant un véritable système novateur, le groupe Akuo Energy a su développer un outil de valorisation axé sur les pratiques agricoles et la production d’énergie verte. L’ « agrinergie » a été créé en 2007 et propose de réinventer l’énergie solaire en créant des synergies positives avec le monde agricole et les productions innovantes.
« Partant du constat que lorsqu’une centrale photovoltaïque au sol est exploitée, la terre qui l’accueille cesse de jouer son rôle primaire, l’Agrinergie® créée des synergies entre production d’énergie et agriculture en intercalant les deux modes de production, occasionnant ainsi une utilisation optimale et adaptée des espaces que requièrent ces activités »128.
Le concept d’« agrinergie » qui associe production d’énergie et activité agricole et qui optimise l’utilisation de l’espace, a ainsi été opérationnel pour 20 fermes solaires photovoltaïques, dont 12 dans les DROM et 6 en Corse.
L’un des projets, nommé « Bazdour », offre une synergie particulière en plus : l’installation de panneaux solaires produisant 9 MW d’électricité par an sur les 35 hectares appartenant au centre pénitentiaire du Port de la Réunion. Ce projet réussit donc à marier une centrale de production énergétique, des serres de production agricole et des objectifs de réinsertion de détenus129. Par ailleurs, l’énergie peut être stockée et réinjectée sur le réseau grâce à des batteries de stockage. Cette production permet de couvrir environ 1/3 de la consommation de la commune du Port130 en énergie solaire renouvelable et en plus de l’électricité, ses serres produisent des fruits et légumes sur 6.000 m² et du miel à partir de 14 ruches. Projet unique, il cible au plus près les singularités environnementales mais aussi sociales propres au site et a été lauréat du concours « My Positive Impact », lancé par Nicolas Hulot131,
– La centrale géothermique de Bouillante, en Guadeloupe
Située dans la commune de Bouillante, la centrale géothermique est l’unique site de production d’énergie géothermique électrique en activité dans la Caraïbe et a longtemps été la seule centrale française produisant de l’électricité à partir de la géothermie. Les premiers travaux d’exploration ont eu lieu sur ce site en 1963 et cette centrale relève d’une importance majeure pour la Guadeloupe. En effet, elle correspond à une contribution significative à l’autonomie énergétique de la Guadeloupe. La géothermie à Bouillante représente l’équivalent d’une production électrique de 6 à 7% de la Guadeloupe. Cette production permet alors de satisfaire les besoins locaux en électricité de 12 000 à 15 000 personnes et le développement de nouveaux sites d’exploitation devrait tendre vers un objectif de production proche de 20% à l’horizon 2020.
Les ressources énergétiques fournies par la chaleur interne de la Terre sont énormes et largement supérieures aux besoins de l’homme. Toutefois l’utilisation de cette énergique géothermique représente un défi technologique de premier d’ordre : forages à grande profondeur, nécessité d’un fluide vecteur d’énergie, extraction de la chaleur, conversion de la chaleur en électricité, etc. La situation idéale pour l’exploitation de la géothermie haute température à proximité du volcan de la Soufrière permet au site de Bouillante de représenter un potentiel énergétique de premier ordre pour la Guadeloupe et d’autres DROM. Enfin, l’atout de cette technologie est que la géothermie est une ressource dont on peut maîtriser pleinement la production, à l’inverse par exemple du photovoltaïque qui dépend des conditions d’ensoleillement. Par ailleurs, ses coûts de production son environ de moitié plus faibles que ceux des centrales thermiques fossiles et ne dépendent pas de fluctuation du marché mondial.
Des lieux d’expérimentation pour des projets en développement
Outre les réalisations, les territoires insulaires et plus particulièrement les DROM sont prédisposés à expérimenter des solutions nouvelles. De nombreux projets sont actuellement en cours dans diverses thématiques inhérentes au domaine de l’énergie et ces derniers permettent, parfois plus facilement qu’ailleurs, de tester à échelle réduite mais grandeur nature, des solutions innovantes pour les EnR.
– Le projet Pégase132 : pallier à l’intermittence
L’île de La Réunion, engagée de longue date dans la transition énergétique, possède un mix électrique composé à 36 % d’EnR133. Dans le but de pallier aux problèmes des énergies intermittentes, neufs partenaires134, au côté du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), développent actuellement le projet Pégase. Pour rappel, les énergies intermittentes se caractérisent par une production touchée par des phases d’interruption non volontaire, plus ou moins prévisible car dépendante des conditions de vent ou d’ensoleillement. Lorsque l’énergie issue du solaire ou de l’éolien est injectée sur le réseau, ce dernier est instable, car les habitants ne consomment pas forcément l’électricité au moment où le soleil est le plus fort, par exemple. Afin de parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande sur un réseau électrique, plusieurs acteurs ont donc opté pour une solution permettant d’accroitre le rendement d’EnR.
Cette initiative, lancée en 2010 à Saint-André dans le nord-est de l’île, permet de corriger, grâce à un système de stockage par batteries sodium-souffre, les chutes de production des parcs éolien et photovoltaïque réunionnais et de soutenir la fréquence du réseau en cas de besoin. A l’origine, l’objectif du projet Pégase était de réduire significativement le nombre de jours de déconnexion des unités de production d’EnR présentes sur l’île afin de réduire au maximum les pertes énergétiques mais cette expérimentation permet de coupler, pour la première fois en France, une ferme photovoltaïque et/ou éolienne avec un moyen de stockage par batterie sodium-souffre suivant un plan de production qui intègrera la prévision de production via une station d’observation météo afin d’anticiper les fluctuations de production135. Enfin, cette initiative s’est fixée comme objectif de diviser par trois le nombre de jours de déconnexion des unités intermittentes et de réduire de 80 % la perte d’électricité inutilisable.
– Le projet OPERA, à Mayotte136
D’autres projets à l’étude ont pour objectif de dépasser le seuil de 30 % d’énergies intermittentes injectées sur le réseau au sein des DROM. L’arrêté du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement des installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution, indique que la production non-pilotable et intermittente ne doit pas dépasser 30 % de la consommation instantanée du réseau afin de stabiliser ce dernier. Même si Mayotte a été la dernière île ultramarine à se lancer dans la production d’électricité photovoltaïque, elle a cependant été la première à atteindre le seuil des 30 % d’électricité produite grâce aux EnR.
Afin de pérenniser le développement des EnR tout en respectant la sûreté et la sécurité du réseau électrique de l’île, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de Mayotte, EDM, en partenariat avec la société Sunzil et l’Institut national de l’énergie solaire, développe actuellement le projet OPERA. Ces acteurs ont imaginé une nouvelle batterie géante, financée par des fonds européens, qui pourrait prendre le relais du soleil caché par les nuages et injecter jusqu’à 3 MW dans le réseau électrique, le temps pour le gestionnaire du réseau de démarrer les moteurs des centrales thermiques de l’île. Ce système permettrait, d’une part, d’utiliser au mieux les EnR, et d’autre part, de basculer progressivement d’un type de production d’électricité à un autre sans mettre en danger le système, via la réserve d’EnR stockée dans la batterie. Le projet doit également développer différents procédés innovants comme la prévision de l’évolution de la couverture nuageuse grâce à un système de caméras, autour d’un réseau plus « intelligent »137. « C’est la solution technique qu’attendent toutes les régions du monde et particulièrement les outremers français pour accroître leur production en énergies renouvelables », constate le directeur de Sunzil Mayotte138.
– Le projet Némo : l’énergie thermique des mers, en Martinique
Les nombreux projets conduits au sein des DROM prouvent que ces derniers participent pleinement à l’expérimentation de solutions énergétiques renouvelables. C’est aussi le cas pour la Martinique, qui fait actuellement l’objet d’une expérimentation concernant la production d’énergie thermique des mers. Le projet, baptisé Némo (New Energy for Martinique and Overseas), va consister à produire de l’énergie en exploitant le différentiel de température entre les eaux de surface largement supérieures à 20°C et les eaux profondes des océans d’environ 4°C, en alimentant une centrale flottante de production d’énergie thermique des mers. Développée par Akuo Energy, cette dernière permettra par ailleurs de fournir de manière stable et garantie, une électricité d’origine renouvelable et totalement décarbonnée à environ 35 000 foyers martiniquais. En effet, elle est l’une des rares EnR à produire sans intermittence, c’est-à-dire en continu.
Par ailleurs, la localisation de la Martinique sur la ceinture tropicale en fait l’une des zones les plus prometteuses au monde pour l’exploitation de cette énergie renouvelable et cette centrale sera la première de ce type au monde qui devrait être opérationnelle dans quelques années et contribuer à la création d’emplois locaux139. De telles centrales offrent en effet la possibilité de produire de la chaleur ou de l’électricité, mais aussi de l’eau douce, de l’eau pour la climatisation, ainsi que des eaux riches en nutriments pour l’aquaculture.
Le développement du projet a bénéficié d’un fort soutien financier de l’Europe, à hauteur de 72 millions d’euros et a été lauréat de l’appel à projet NER 300140 (qui financera 19 projets innovants en matière de production d’énergie renouvelable) et dont il est le seul insulaire. Enfin, ce projet préfigure le développement d’une nouvelle filière industrielle profitable à l’Outre-mer français et à toute la zone océanique intertropicale, à la fois dans les grands archipels (Indonésie, Philippines), les systèmes insulaires (Caraïbes, Pacifique, Océan Indien) ainsi que les zones côtières (Mexique).
Des dispositifs innovants grâce à l’habilitation énergie
Dans le domaine de l’énergie, la réglementation en vigueur et les normes applicables sont les mêmes sur l’ensemble du territoire français. Comme vu précédemment, l’article 73 de la Constitution prévoit que les lois et règlements « peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières »141 au sein des DROM. Les Régions de Guadeloupe et Martinique ont souhaité saisir cette opportunité et ainsi s’inscrire dans une innovation au niveau de la gouvernance énergétique de leur territoire. La Guadeloupe est la première région française à avoir demandé et obtenu une habilitation en 2009, après l’élaboration de son PRERURE en 2008. Grâce à cet outil, la région a mis en œuvre des mesures innovantes dans le cadre du développement des EnR et en matière d’efficacité énergétique. Par la délibération du 17 décembre 2010, la Région a par ailleurs demandé au parlement une prolongation de son habilitation dans le domaine afin de poursuivre les actions engagées.