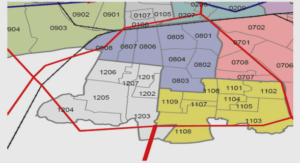Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
La décision d’apprendre
Pour certains élèves, entrer ou non dans les apprentissages relève d’un choix personnel directement influencé par les éléments pédagogiquesmis en place par l’enseignant. On considère que certains élèves ont besoin de s’impliquer dans une activité pour entrer dans une situation d’apprentissage. Mais si pour certains élèves, c’est un phénomène corrélatif, il n’est pas nécessairement causatif. On peut s’engager dans l’action et ne pas nécessairement entrer simultanément dans les apprentissages. L’élève prend alors la décision de réaliser quelque chose mais pas nécessairement d’apprendre. Quels types d’expériences peuvent mobiliser les élèves pour entrer dans une tâche et un apprentissage ? Dewey développe ce cas précis grâce l’apprentissage par l’expérience learning by doing (1916).
John Dewey se débarrasse des dualismes qui encombrent la pensée pédagogique et empêchent d’appréhender de la vérité. Il défend unepédagogie du concret pour aller vers l’abstrait. Mais ce qui est concret pour un élève ne l’est pas pour tous les élèves. Il distingue ce qui est familier, ce dont il a l’habitude de se servir, de voir dans son environnement de ce qui est concret. Est facile, simple, familier, concret, ce qui appartient à l’expérience déjà là, aux habitudes, aux schèmes. Partir du concret ne signifie donc pas partir de la perception pour aller à l’image, au mot et à l’idée, d’une manière empiriste. Le concept ne résulte pas de la sédimentation des images successives des objets. Il vient plutôt d’hypothèses effectuées en cours d’enquêtes et qui s’affinent par l’expérience. C’est donc l’action et non l’observation qui est première. Comment concevoir cette action ? Il ne suffit pas de vouloir l’élève actif, encore faut-il considérer cette activité comme intelligente : « Alors, l’idée devient plan à l’intérieur de l’activité qu’il s’agit de promouvoi pour elle » (John Dewey, 1968, p.120).14 Le concret, c’est donc ici la réflexion appliquée à l’activité dans le but de résoudre les difficultés des pratiques familières. Mais si l’action, même lasimple manipulation d’objets, est déjà pétrie d’intelligence, alors le concret désigne bien cette réflexion en action caractéristique des enquêtes de la vie quotidienne. C’est pourquoi la pédagogie de John Dewey trouve son point de départ dans les « occupations » telles que le jardinage, la cuisine, les jeux…qui n’étant ni routinières ni mécaniques, s’avèrent susceptibles ed déclencher la réflexion.
Pour Bernadette Aumont et Pierre-Marie Mesnier (1992), la décision d’apprendre est un état « ordinaire » chez tout individu, mais cette orientation spontanée ne peut s’exercer que
sur des savoirs reconnus « par l’individu comme désirables ». 15 Si elle résulte seulement de l’intensité qu’a l’enseignant à valoriser le savoir , cela devient problématique si c’est le seul biais par lequel l’élève décide d’entrer dans les pprentissages. Ils relèvent des situations à caractère exceptionnel dans lesquelles c’est justement l’enjeu du savoir de l’enseignant perçu par l’élève qui déclenche ce phénomène. Mais pour ernadetteB Aumont et Pierre-Marie Mesnier (1992), le rôle du médiateur a un rôle plut ôt incitateur, révélateur pour faire entrer dans les apprentissages. Ils considèrent que le médiateur doit d’abord établir une motivation à apprendre sur un domaine inexploré de l’apprenant afin de le sensibiliser aux enjeux latents que peut révéler le savoir par la suite aux élèves .Alors, cette médiation qui se fonde sur la capacité de l’enseignant à susciter l’envie pour un savoir qui ne l’aurait pas été de prime abord par l’élève ne doit pas être confondue par cedernier avec la fascination pour le savoir passionné qu’ont certains enseignants pour leur discipline. Le risque est alors de perdre tout envie lorsque le médiateur disparaît de l’entourage de l’apprenant. Dans cette perspective, l’entrée dans les apprentissages est peut être alors biaisée par l’effet médiateur, qui laisse en réalité l’élève en dehors de la sphère du savoir isqu’ilpu n’avait pas été réellement acteur de son apprentissage.
L’étude des processus « entreprendre et chercher» par Bernadette Aumont et Pierre-Marie Mesnier (1992) a montré comment un sujet se constitue par le fait qu’il se sent « autorisé » à exercer son indépendance dans ’activitél de construction d’un objet ou de mise en œuvre d’un projet. Pour ces auteurs, cette corrélation avec l‘apprentissage est une construction opérée par un sujet sur un objet à connaître.17 On utilise l’expression « objet à connaître » ici afin de différencier le savoir acquis et le savoir en devenir qui « doit s’inscrire dans toute son économie affective pour être appris». Les auteurs distinguent deux phases, l’agir entrepreneurial grâce auquel « l’individu me t en route des apprentissages à partir d’une action menée sur le terrain ». La seconde phase concerne la construction des savoirs, c’est le moment d’organisation du nouveau savoir par les élèves en remettant en jeu leurs conceptions.
Cette notion d’apprentissage est peu adéquate pour Bernadette Aumont et Pierre-Marie Mesnier (1992),18 puisqu’elle décrit un processus précis subi par l’élève. Au contraire, la description de l’activité cognitive et de la volonté « d’agir sur sa propre pensée pour la transformer et la développer » est un processus quirelève d’une décision d’apprendre. Ils lui préfèrent donc la notion « d’acte d’apprendre ». Mais ce terme n’exclut pas les composantes sociales de l’apprentissage cependant développées ltérieurement. .
Le confort de l’apprentissage
Michel Serres19 explique le processus d’apprentissage par un passage d’un état à un autre: pour lui, il faut « quitter des rivages inconnus pour accéder progressivement à des rivages connus, mais en passant par des zones de très grande turbulence ». Philippe Meirieu le rejoint dans cette idée en affirmant que le processus d’apprentissage, c’est « quitter la certitude pour accéder progressivement à des choses nouvelles», mais en passant par des phases de déstabilisation considérables. « Apprendre c’est faire quelque chose qu’on ne sait pas faire, pour apprendre à le faire » L’apprentissage devient le dépassement d’une erreur « dont le caractère est clairement structurant ». L’erreur est même considérée commenuoutil pour enseigner. (Astolfi, 1997) Il reprend le postulat de Bachelard (1993) qui affirme que l’erreur est « consubstantielle à l’apprentissage ». En effet, la rencontre de l’élève avec les nouveaux obstacles souvent provoqués par l’enseignant, est destinée à lui faire non pas acquérir un nouveau savoir,
Table des matières
Introduction
1. Cadre théorique
1.1. Comment définir l’entrée dans les situations d’apprentissages
1.1.1. Les concepts « d’entrée et d’apprentissage » : un problème de temporalité
1.1.2. Une entrée dans les situations d’apprentissages singulière en fonction du vécu
chaque enfant
1.1.3. Entreprendre et chercher
1.1.4. Des résistances de diverses natures à cette entrée dans l’activité
1.1.5. L’entrée dans les apprentissages : une problématique peu traitée
1.2. Développement des hypothèses de travail sélectionnées
1.2.1. La perception des élèves du savoir et le lien avec leur motivation
1.2.2. La décision d’apprendre
1.2.3. Le confort de l’apprentissage
1.2.4. La relation à l’enseignant et aux « pairs »
1.3. Lexicologie.
1.3.1. Quels liens linguistiques émergent face à la notion d’entrée dans les situations
d’apprentissage ?.
1.3.2. Une approche systémique du verbe « saisir »
2. Le cadre méthodologique issu de la réflexion théorique
2.1. Quel outil méthodologique ?
2.1.1. L’observation
2.1.2. L’enquête qualitative
2.2. Le contexte des entretiens
2.2.1. Présentation du dispositif
2.2.2. Une population jeune
2.2.3. Le terrain d’enquête : une école de campagne en Loire-Atlantique
2.3. Les biais de l’enquête
2.3.1. Les échelles de compréhension et d’expression de l’enquêté doivent être adaptées
2.3.2. Les dérives de l’utilisation de la vidéo
2.3.3. La connivence entre enquêté et enquêteur.
2.4. L’étude de l’entretien par groupements sémantiques
3. L’analyse de l’entretien par groupements sémantiques de T
3.1. La mise en confiance
3.2. La mise en contexte
3.3. Le rappel de la séance
3.4. La participation
3.5. Première chute d’attention
3.6. Compréhension de l’activité à réaliser
3.7. Intérêt de l’activité
3.8. Explication de ses préacquis
3.9. Le travail en binôme
3.10. Résultat de la tâche
3.11. Mutualisation au tableau
3.12. Explication des relations inter-binôme
3.13. Intérêt de la tâche
3.14. Explication de son désintérêt.
3.15. Les obstacles épistémologiques.
4. Interprétation des données de l’entretien de T.
4.1. L’arrivée de T dans la classe : un manque de sécurité affective
4.2. Les fluctuations de l’intérêt porté à la tâche :.
4.3. Le sens de la tâche
4.4. Une attitude en adéquation avec son vécu personnel
Conclusion générale des apports du mémoire
Télécharger le rapport complet