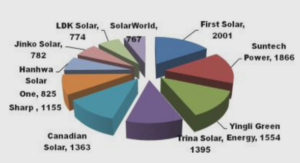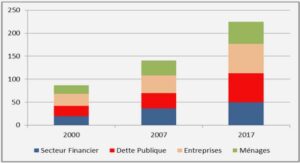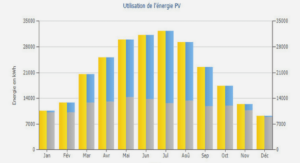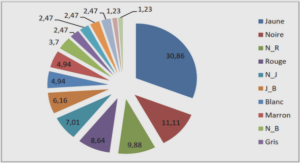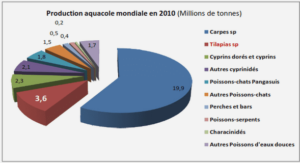Les crises de et dans l’État
Formation/construction de l’État et thème centre-périphérie « (…)
If conquest shapes societies, even conquered peoples can force changes in the forms that states take, so leading, to some extent, their captors captive » John Lonsdale (1992: 39) « On ne doute jamais trop quand il s’agit de l’État » Pierre Bourdieu (1993 : 49) L’État, que nous envisageons ici de façon « génétique », résulte d’un processus double, à la fois endogène et exogène. Reprenant la distinction soulignée plus haut entre la formation de ses frontières extérieures et de ses frontières intérieures (interdépendantes), les premières peuvent être considérées comme relatives aux conquêtes, à l’intégration ou à la protection d’une entité politique, alors que les frontières internes relèvent d’une « constitution progressive de formes de domination d’une partie de la société sur le reste de ses membres » (Godelier 1980 : 657). La définition offerte par P. Bourdieu de l’État est révélatrice de ces deux dimensions interdépendantes et présente par ailleurs l’intérêt de dépasser sa dimension formelle pour y voir également une organisation symbolique puissante : « L’État est l’aboutissement d’un processus de concentration des différentes espèces de capital, capital de force physique ou d’instruments de coercition (armée, police), capital économique, capital culturel ou, mieux, informationnel, capital symbolique, concentration qui, en tant que telle, constitue l’État en détenteur d’une sorte de métacapital, donnant pouvoir sur les autres espèces de capital et sur leurs détenteurs. La concentration de différentes espèces de capital (qui va de pair avec la construction des différents champs correspondants) conduit en effet à l’émergence d’un capital spécifique, proprement étatique, qui permet à l’État d’exercer un pouvoir sur les différents champs et sur les 76 différentes espèces particulières de capital, et en particulier sur les taux de change entre elles (et, du même coup, sur les rapports de force entre leurs détenteurs). Il s’ensuit que la construction de l’État va de pair avec la construction du champ du pouvoir entendu comme l’espace de jeu à l’intérieur duquel les détenteurs de capital (de différentes espèces) luttent notamment pour le pouvoir sur l’État, c’est-à-dire sur le capital étatique donnant pouvoir sur les différentes espèces de capital et sur leur reproduction (à travers, notamment, l’institution scolaire) (Bourdieu 1993 : 52). P. Bourdieu souligne ainsi l’importance du « capital symbolique » défini comme « n’importe quelle propriété (n’importe quelle espèce de capital, physique, économique, culturel, social) lorsqu’elle est perçue par des agents sociaux dont les catégories de perception sont telles qu’ils sont en mesure de la connaître (de l’apercevoir) et de la reconnaître, de lui accorder valeur (Bourdieu 1993 : 55). Cependant, cette définition de P. Bourdieu présente l’État comme le résultat d’un processus impulsé largement « par le haut » et subit par la « société ». Rappelons ici les processus d’interactions à partir desquels l’État se forme continuellement. Ici, la distinction entre « formation » et « construction » de l’État permet de dépasser la vision selon laquelle l’État émanerait d’une logique de diffusion unilatérale. Afin de séparer deux dimensions de la formation étatique au Kenya, J. Lonsdale propose de distinguer le « state-building » du « state-formation » (Berman & Lonsdale 1992). Le « state-building », que nous traduirons par la « construction de l’État », est ici définie comme l’« effort conscient visant à créer un appareil de contrôle » (Lonsdale 1992 : 5). Quant à la « formation de l’État » (« stateformation »), elle serait ce « processus historique dont le déroulement est un processus de conflits (en grande partie inconscient et contradictoire), de négociations et de compromis entre différents groupes, dont les actions et les échanges motivés par l’intérêt constituent la ‘vulgarisation’ du pouvoir » (Lonsdale 1992 : 5). Cette distinction permet à J. Lonsdale de montrer que « l’embryon de l’État ne fut pas seulement délibérément construit, comme moyen de canaliser et de diriger le pouvoir au bénéfice de quelques uns », mais qu’« il fut 77 aussi formé par les actions anonymes de nombreux acteurs » (Lonsdale 1992 : 15). La formation de l’État ne dépend donc plus uniquement des acteurs étatiques qui le « construiraient » « par le haut », mais également des acteurs non-étatiques qui participent à sa « formation » « par le bas », se l’approprient, empruntent ses cadres d’action, le réinventent, y résistent, ou encore entreprennent de le renverser pour y gouverner. Ces travaux rejoignent assez largement les analyses de C. Tilly pour qui les acteurs de la « formation de l’État » n’ont pas forcément conscience d’œuvrer à cette tâche. À partir de ses travaux sur la formation des États européens à la fin du Moyen Âge et les facteurs de mobilisations sociales, l’auteur met également en relief deux dimensions de la construction des États : la dimension stratégique des acteurs, mais également le fait que ceux-ci n’ont pas alors nécessairement pour objectif de développer les structures d’un système que nous appelons aujourd’hui l’« État moderne » : « Power holders’ pursuit of war involved them willy-nilly in the extraction of resources for war making from the populations over which they had control and in the promotion of capital accumulation by those who could help them borrow and buy. War making, extraction, and capital accumulation interacted to shape European state making. Power holders did not undertake those three momentous activities with the intention of creating national states – centralized, differentiated, autonomous, extensive political organizations. Nor did they ordinarily foresee that national states would emerge from war making, extraction, and capital accumulation » (Tilly 1985: 172). Nous pouvons donc retenir la distinction tout à fait éclairante établie par J. Lonsdale entre « construction de l’État » et « formation de l’État », dans la mesure où, même s’il admet cette distinction, C. Tilly regroupe ces deux dimensions sous la même expression (« state-making »). Nous définirons donc l’État comme un processus continu résultant de cette double dynamique : nous parlerons de processus conscient des acteurs à créer un système de contrôle lorsque nous évoquerons la « construction de l’État » ; alors que l’ensemble plus large des processus et actions contribuant à sa formation et engendrant d’autres dynamiques de conflits sera évoqué en tant que « formation de l’État ».
Trajectoire de l’État, trajectoire de la centralité
En dehors des travaux anthropologiques, l’État africain en tant qu’objet d’étude est relativement marginal jusqu’au lendemain du second conflit mondial et jusque dans les années 1970. Le contexte d’après guerre incite dans un premier temps les observateurs et intellectuels à se focaliser sur les notions d’autoritarisme ou de totalitarisme. L’État occidental lui-même est alors considéré comme quelque peu « poussiéreux » et les analyses se tournent davantage vers les études « sociétales » 79 (Skocpol 1985 ; Poulantzas 1980).45 Il faut attendre les vagues des indépendances (et donc la multiplication des États sur le continent) pour offrir une nouvelle dimension aux études portant sur l’État, et l’Afrique fait alors partie de ces continents qui attirent l’attention (Harbeson 1995). La science politique s’émancipe et l’intérêt se tourne vers les États « en voie de développement », puis du « Tiers-Monde », prenant ensuite la dénomination tout aussi problématique d’États du « Sud ».46 À partir des années 1970, l’État africain est « reconnu » et le champ se trouve alors investi par deux grandes tendances : l’école libérale d’un côté (qualifiée a posteriori de « développementaliste »), et néo-marxiste de l’autre (dépendantiste). Les critiques faites à l’encontre de ces approches à partir de la fin des années 1970 poseront les fondements des études africanistes contemporaines.
L’approche par la modernisation
Ce sont les théoriciens de la modernisation politique qui investissent, presque initialement, ce champ d’étude. Ils entendent déterminer les conditions « nécessaires » et « incontournables » au développement d’États considérés comme modernes. C’est ainsi qu’apparaît ce qui sera qualifié d’école développementaliste (Lerner 1964, Rostow 1959, Almond et Verba 1963 ; Pye et Verba 1965). Le cycle d’étude s’ouvre avec la création en 1954 du Committee on Comparative Politics, suivie de la tenue en 1959 du premier colloque portant sur la « modernisation politique » (Baudouin 1998 : 81). Les premières recherches aboutissent à l’idée selon laquelle le développement économique serait une condition sine qua non à tout développement démocratique et à la fin des violences sociales (Lipset 1959 ; Dahl 1998). L’exposé de Rostow en termes d’étapes de développement constitue sans doute le travail le plus explicite en ce domaine (Rostow 1959 ; 1975). 45 Notons ici le Projet de recherches comparatives sur la formation de l’État et de la nation conduit dans le cadre de l’Unesco et du Conseil international des sciences sociales dans les années 1960 et 1970. Les conférences menées dans le cadre de ce projet, en Europe, en Amérique latine et en Asie conduiront à la publication des deux célèbres ouvrages collectifs dirigés par S.N. Eisenstadt et S. Rokkan en 1973, Building States and Nations. 80 Dans ces analyses, le « centre » n’est pas incarné par l’« Occident » en tant que tel, mais par l’État lui-même. État et centre politique sont ainsi superposés et confondus. Quant à la « périphérie traditionnelle », située à l’intérieur de cet État en voie de modernisation, elle est considérée comme un frein au développement. Autrement dit, les organisations sociales « traditionnelles » sont jugées archaïques, « résiduelles », et le progrès impliquerait leur élimination par la modernisation de type occidental (Zolberg 1968). C’est alors qu’apparaissent dans ces études les notions de « processus », de « prérequis », ou encore de « stades » visant à expliquer et légitimer la conquête de la périphérie. Soulignant notamment la fragilité du lien causal entre croissance économique et démocratisation, les limites de ces théories ont depuis été exposées (Badie 1984). Il semble en effet impossible de prédire le devenir politique à partir de développements économiques, ne serait-ce qu’en raison de la diversité des trajectoires politico-historiques des pays (A. Sen 2006). L’Amérique latine, l’Afrique, la Chine ou plus largement l’Asie du Sud-Est fournissent autant d’illustrations des limites de cette logique. En outre, analyser les États du Sud à partir de modèles économiques ne permet pas de lier « a priori des situations objectives aux représentations subjectives que les individus sont censés en retirer. (…) Rien ne permet, en effet, d’affirmer que telle ou telle variation intervenue dans la vie économique ou sociale sera vécue et interprétée politiquement de la même manière dans des sociétés différentes. Ce passage dans le champ politique suppose l’interférence des données spécifiques (culture, institutions en place, relations entre forces sociales) qui ont leur autonomie et donc leur effet propre » (Badie 1984 : 23-24).
L’État comme artefact « périphérique » du « centre » occidental
À partir d’un rapport centre-périphérie différent, la théorie de la dépendance propose quant à elle une toute autre façon de considérer l’État au « Sud ». Inspirée des travaux de Marx au « Nord »49, l’État au « Sud » devient un artefact, une création pure et simple du Nord au sein d’un système de domination international. Le thème « centre-périphérie » y est donc modélisé différemment. Le centre de gravité n’est désormais plus à voir dans l’État lui-même, mais dans cet ensemble dominant qu’est le Nord (le centre) vis-à-vis du Sud (la périphérie) (Frank et alii. 1968 ; Amin 1976). L’État y est réduit à un instrument de domination manipulée par un ordre international (néo)impérialiste, ou (néo)colonialiste (Wallerstein 1974). Ces études semblent déprécier à la fois l’État dans ses relations à l’international ou sur la scène politique intérieure. Celui-ci se trouverait en effet réduit à un simple produit d’exportation (Baudouin 1998). Par ailleurs, malgré l’influence marxiste dont ces réflexions se réclament, elles ne laissent paradoxalement pas apparaître les jeux complexes d’acteurs ou de classes à l’intérieur de ces pays périphériques (McKenzie 1977). Enfin, la dichotomie NordSud ne permet pas d’entrevoir les différentes trajectoires et dynamiques internes au sein des grands ensembles que sont le centre, la périphérie ou la semi-périphérie. Le rôle de l’État évolue en fonction de ses modalité de formation, des groupes sociaux auxquels il est associé et plus largement qui le composent. Les rapports entre ces groupes et la formation des « idéologies » nées de l’État ou le contestant sont ainsi négligés dans l’approche de l’école de la dépendance (Birnbaum 1980 : 733). Ainsi, l’explication par la domination économique et le capitalisme ne peuvent suffir à expliquer les trajectoires particulières des États et leurs dynamiques internes (Poulantzas 1980 : 650-651). 49 Pour un commentaire de la vision marxienne de l’État, voir BADIE Bertrand et BIRNBAUM Pierre, Sociologie de l’État, Hachette, 1982, p. 15-27. Les auteurs insistent notamment sur les premiers écrits de Marx dans lesquels celui-ci reconnaît la diversité des trajectoires historiques qui façonnent les États de façons radicalement différentes, dépassant ainsi la vision réductrice du « matérialisme historique » la plus souvent retenue.
La centralité comme production de l’État et la société
À la fin des années 1970 et au début des années 1980 émerge une approche dont l’objectif consiste à « ramener l’État » au cœur des analyses (Skocpol 1985). Ce mouvement s’inscrit dans une critique à la fois des approches structurofonctionnalistes, marxistes, et de l’école de la modernisation politique. L’État y est considéré non plus comme un artefact ou comme un ensemble d’institutions à envisager en dehors de la société, mais comme un véritable acteur en interaction avec celle-ci. L’État y est dans un premier temps considéré comme une entité composée d’organisations et d’acteurs officiels, menant des politiques et établissant des stratégies à partir des ressources disponibles. S’inspirant de la vision tocquevillienne des liens unissant l’État à la société, l’État n’y est pas considéré uniquement comme un gouvernement. Il est ici présenté comme un ensemble continu de systèmes administratif, bureaucratique et coercitif entendant structurer les relations entre l’autorité publique et la société, mais également les relations à l’intérieur de cette dernière (Skocpol 1985). Le réinvestissement du champ d’étude de l’État se justifierait ainsi par l’influence qu’exercerait ce dernier sur les modes de revendications politiques, les orientations et la formation d’entités sociales ou culturelles, en les impulsant ou en les prohibant. Les structures de l’État et les actions de ses agents influeraient sur le cadre spatial et temporel, les objectifs et les formes des mouvements collectifs (Tilly 2001 ; Tilly & Tarrow 2008). Afin d’étudier les capacités de l’État, se cantonner à examiner les ressources et les instruments de celui-ci ne suffirait plus. Il s’agit d’examiner les relations avec ses environnements socioéconomiques et politiques. Cette approche dépasse les études se focalisant sur l’impact sociétal des stratégies mises en place par l’État. Les répercussions des politiques étatiques ne dériveraient plus uniquement de la volonté rationnelle de ses dirigeants, mais également des effets inattendus ou non intentionnels de leurs politiques. L’État devient ainsi producteur des cadres sociaux de l’action qu’il propose et parvient à faire entériner par ses partenaires non étatiques, sans que « politiciens » ou 85 « bureaucrates » n’aient d’ailleurs nécessairement conscience de produire alors de tels cadres d’action (Ferguson 2006, cité dans Darbon 2011). L’argument ouvre à la fois le champ des études des agents étatiques, mais également de leurs réceptions par les populations. En outre elle remet en cause l’idée d’action rationnelle dans la conduite et les comportements de ces agents. Ces études présentent l’intérêt d’avoir effectivement « ramené » l’État et ses influences sur la société au centre de la littérature sur la formation de l’État et sur les mobilisations sociales dans leurs formes violentes. Cependant, elles cherchent trop souvent à comprendre l’impact de l’État sur la société, en délaissant le politique dans la société, et l’influence de ce dernier sur les institutions étatiques. Résultant directement de cette critique et de ses applications à l’État africain, une troisième approche va consister à revenir sur la production de la politique en dehors des structures de l’État. Symbolisée par la revue Politique Africaine, la « politique par le bas » se donne pour objectif d’identifier les productions de politique en dehors de l’État.50 Nouvelle critique des modèles de la modernisation ou de la dépendance (Bourmaud 1997), l’approche dénonce les visions binaires parmi lesquelles État et société, ou encore modernité et tradition (Badie 1984 ; Gazibo 2001).51 Les groupes sociaux, dont le rôle était sous-évalué jusque là, deviennent ainsi les sujets d’études privilégiés (Bayart & Mbembe & Toulabor 1992). Il s’agit alors, une fois encore, de déplacer le « centre ». On se démarque en effet des modèles centre-périphéries de l’école de la dépendance ou de la modernisation pour préférer une dynamique d’interactions entre les acteurs sociaux, voire institutionnels (si le rôle des institutions étatiques est parfois délaissé, celles-ci ne sont pas pour autant ignorées).
SOMMAIRE |