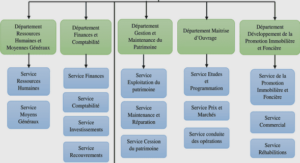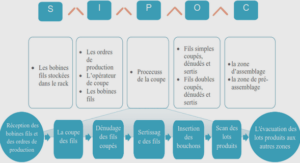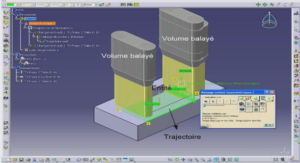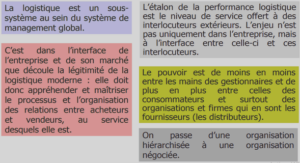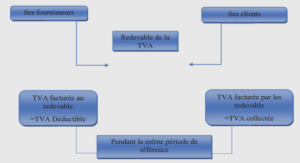Depuis la fin des années 1980, les changements géopolitiques, les évolutions socioéconomiques ont été nombreux, profonds, souvent rapides. Pour en comprendre le sens, il faut rappeler que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les relations internationales étaient globalement structurées et encadrées par les rapports de forces et stratégies dictés par ce qu’on a appelé « la guerre froide». Une opposition entre nations, celles des blocs de l’Est et de l’Ouest incarnant deux systèmes politiques et idéologiques (socialisme et capitalisme), auxquelles s’ajoutaient le mouvement des pays dits « non alignés », qui refusaient de s’inscrire sous la férule de l’un ou de l’autre camp, ou encore les pays engagés dans un mouvement de libération nationale, pays souvent colonisés par des puissances européennes.
Avec la fin de la guerre froide et la disparition d’un des deux modèles de sociétés – le modèle socialiste – au seul profit de son pendant capitaliste, le monde politique, économique, social bipolaire s’est retrouvé comme orphelin, privé d’opposition. Pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle, le capitalisme est en mesure d’opérer à l’échelle mondiale. Sur les ruines du mur de Berlin, frontière de deux mondes qui s’opposaient, un autre monde émerge selon les préconisations du « consensus de Washington », un monde où l’économie de marché s’impose. Au tournant des années 1990, l’ordre du monde change, de nouvelles formes mondiales de souveraineté apparaissent, celle de l’« Empire » , celle du passage au « quatrième monde capitaliste » , où l’uniformisation progressive prend les traits de la mondialisation libérale, capitaliste. Parallèlement se forgent un « nouveau désordre belliqueux » et une représentation idéalisée (où sont évacués les conflits et oppositions de classes, les inégalités et les rapports de domination et d’exploitation) des rapports sociaux, des réalités sociopolitiques. Il n’est plus guère question de conflits et d’oppositions de classes – n’est-ce pas la fin des classes sociales ? -, d’inégalités, de richesse et de pauvreté. C’est l’essor du capital sans nationalité dans un monde dans lequel « les frontières n’auraient plus de sens » (Borderless world) .
Ce monde émerge de la scène écroulée du bloc de l’Est et de l’accélération sans précédent du processus de mondialisation. Les repères et les critères dominants changent, la régulation par le marché s’immisce là où l’État recule. Le monde débordant de nations se double d’un monde sous emprise des marchés.
Dans ce contexte, la superpuissance américaine est la figure de proue de ce mouvement sociopolitique et économique désentravé. L’interventionnisme des États (welfare) est déjà bien en recul (tout au moins l’État social), d’abord aux États-Unis et au Royaume-Uni, puis dans l’ensemble de l’Europe. Les préceptes de l’économie libérale s’imposent. Le rejet de la puissance publique et de l’intervention de l’État se noue à l’affirmation de l’individualisme et de la liberté économique. L’État-nation est critiqué, remis en cause. Il se heurte à la fois aux dynamiques transnationales de la mondialisation et aux éveils identitaires hérités des contentieux sociopolitiques accumulés au cours de la période de la guerre froide et de la période de colonisation. Le jeu des relations internationales n’en devient pas pour autant plus simple à comprendre. Les relations entre nations et populations, bien loin de connaître une évolution pacifiée comme le prédisaient nombre d’observateurs et « spécialistes », sont entrées dans un nouveau cycle où les questions de pouvoir, de rapports de force, d’intérêt et de souveraineté ne sont ni moins présentes, ni plus simples à appréhender. Au contraire, les conflits ne disparaissent pas et la désintégration du bloc de l’Est et d’États-nations ouvre la voie à divers irrédentismes et oppositions politico-militaires que la guerre froide avait en partie estompés et circonscrits, au besoin instrumentalisés ou alimentés, mais finalement contenus.
Dès 1991, la première guerre du Golfe et l’éclatement de la Somalie dans des luttes claniques suite à la chute de la dictature de Syad Barre inaugurent une nouvelle période de tensions et de conflits. Puis, la guerre civile algérienne, qui n’est pas sans rappeler les atrocités que le Liban a connues dans les années 1970-1980, les conflits dans le Caucase, en ex-Yougoslavie et au Rwanda révèlent les nouvelles lignes de fracture que l’ordre ancien avait un temps immobilisées. Le nationalisme, l’ethnie, la religion, l’« identitaire » sont autant de traits communs aux conflits ou tout au moins mis en avant pour les expliquer au cours desquels des pseudo-États, des groupes politico-militaires se disputent un territoire, redessinant les cartes et les frontières des souverainetés, faisant naître de nouveaux États sur les ruines d’anciens comme dans le cas de la Yougoslavie par exemple.
Peu à peu, l’adversaire, le danger n’ont plus un visage, mais plusieurs, les combattants ne portent plus un uniforme clair, au nom d’un État identifié. C’est le début des conflits asymétriques . Et c’est dans cette fragmentation politique (inverse de la tendance à l’homogénéisation à laquelle pousse la mondialisation) que la géopolitique se cherche de nouveaux paradigmes. On retrouve d’ailleurs l’expression de cette nécessité dans le champ scientifique comme en témoignent, au tournant des années 1990, divers travaux de chercheurs en science politique, mélangeant approches des relations internationales et géographie .
Les expressions les plus parlantes de cette évolution idéologique et politique, que le champ scientifique a alimentée pour une part, se retrouvent par exemple dans les travaux de Francis Fukuyama avec sa thèse sur « la fin de l’histoire » qui pourrait se résumer en ces termes : « Nous avons atteint le terme de l’évolution idéologique de l’humanité et de l’universalisation de la démocratie libérale occidentale en tant que forme définitive de gouvernement ». Mais on trouve aussi cela dans les écrits de Samuel P. Huntington qui développe une approche des relations internationales à partir de rapports civilisationnels.
La théorie qu’il développe réduit les conflits à une opposition entre « civilisations » le long de lignes de fracture où chaque « culture » agirait comme un ensemble cohérent, un tout, rassemblé non plus sur des bases politiques et idéologiques, mais sur des bases religieuses et culturelles. Tout ceci fonctionne sur une représentation pour le moins simplificatrice où les « civilisations » agiraient comme des plaques tectoniques s’entrechoquant. Caricaturale, cette approche n’en traduit pas moins une volonté d’incarner un « nouvel ennemi global », proposant de rejouer sur un mode binaire les rapports de domination entre le « monde civilisé » et les « barbares », entre le « bien » et le « mal ».
INTRODUCTION GÉNÉRALE |