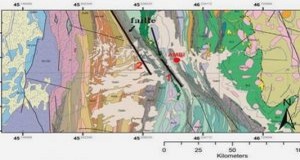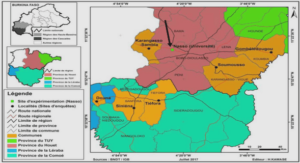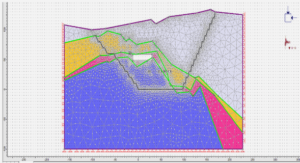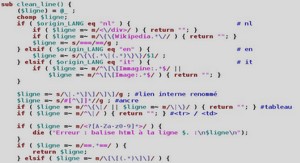De nos jours, il est inadmissible qu’un enfant meure encore de maladies évitables par la vaccination. La politique sanitaire nationale a mis pour objectif de concentrer nos activités de vaccination sur la population cible de 0 à 11 mois et les femmes enceintes, et en âge de procréer (1). L’OMS estime qu’en 1984, quatre millions d’enfants étaient morts avant leur premier anniversaire et quatre autres millions ont été atteints d’un handicap physique ou mental dû à l’une des six maladies infectieuses suivantes: la poliomyélite, la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole. Et quant au virus de l’hépatite B, il est responsable de 60 a 80 % du cancer du foie qui est l’une des 3 principales causes de décès par cancer chez l’homme. En d’autres termes, à chaque fois que l’on respire, un enfant meurt d’une maladie qu’on aurait pu facilement éviter par la vaccination (2)(3). L’OMS a lancé un Programme Elargi de Vaccination (PEV) dans le monde car en effet, il vaut mieux prévenir que guérir. De plus, la vaccination a permis de faire reculer de façon notable ces différentes maladies cibles du PEV (leur incidence, leur prévalence, et la mortalité dont elles sont responsables). Ce PEV se fixe comme objectif de vacciner tous les enfants du monde, en particulier, ceux de moins d’un an.
GENERALITES
QUELQUES DEFINITIONS
Antigène
C’est une substance (micro-organisme, cellules d’une espèce différente substance chimique ou organique, etc.) qui, une fois, introduit dans l’organisme, provoque la formation d’un anticorps.
Anticorps
Le mot anticorps vient du mot grec anti : contre et du latin corpus : corps. Ce sont des substances élaborées par les organismes soumises à l’action de certains produits (protides, glucides, lipides) dits antigéniques ou antigènes. On distingue plusieurs types d’anticorps : les antitoxines (bacille de la diphtérie, du tétanos) ; les opsonines, qui ont le pouvoir de faciliter la digestion des microbes par les phagocytes ; les agglutinines qui rassemblent les microbes ; les lysines qui les dissolvent et voire aussi les gammaglobulines, au supplément.
Vaccin
Du mot latin vacca qui signifie vache. C’est une préparation antigénique permettant de réaliser la prévention de certaines infections microbiennes, virales ou, parasitaires par vaccination. C’est une préparation apportée à un sujet réceptif à une maladie infectieuse. Cette préparation agit en obligeant l’organisme à fabriquer les éléments de défense, c’est à dire des anticorps qui détruiront le microbe responsable, s’il vient à pénétrer dans l’organisme. De ce fait, la maladie ne pourra pas se développer.
• Les différents types de vaccin
Schématiquement, on distingue deux types tels que :
– les vaccins viraux
– les vaccins bactériens .
Ces vaccins peuvent être préparés soit à partir des agents pathogènes atténués d’où le qualificatif vivant, soit à partir des germes tués et inactivés. Par ailleurs, on peut inoculer des vaccins chimiques ou anatoxines auxquels on fait perdre leur pouvoir pathogène en conservant leur pouvoir antigénique. Il existe donc plusieurs variétés principales de vaccins et citons :
– les vaccins vivants comme le Vaccin Anti-Rougeoleux (VAR), la Bacille de Calmette et Guérin (BCG), le Vaccin Polio Oral (VPO) ;
– les vaccins tués (TAB)
– les vaccins atténués (Vaccin polio injectable) ;
– les vaccins chimiques (anatoxines diphtériques et tétaniques) .
Sérum
Du mot latin qui signifie petit lait. C’est le liquide séparant du caillot après la coagulation du sang d’un animal, habituellement le cheval, vacciné contre une maladie microbienne, ou contre une substance toxique.
• Sérum thérapeutique : sérum provenant de la coagulation du sang de divers animaux, du cheval en particulier, tantôt normaux, tantôt immunisés contre les microbes et toxines de diverses maladies, tantôt soumis à des traitements variés, signés répétéspour provoquer une régénération sanguine, ablation d’organe.
• Sérum spécifique : les uns proviennent d’animaux préparés avec un antigène microbien. Ce sont les sérums antimicrobiens. D’autres résultent d’animaux préparés avec antigène toxique et ce sont les sérums antitoxiques. Enfin, en présence de certainesmaladies dont on ignore l’agent causal, on peut pratiquer la sérothérapie avec du sérumde convalescent de ces maladies. Exemple : sérum antidiphtérique : sérum antitoxique provenant d’animaux immunisés avec la toxine diphtérique élaborée par corynebacterium diphterae ou avec les produits de transformation de cette toxine (anatoxine, action préventive et curative).
• Sérum antitétanique : sérum antitoxique provenant d’animaux immunisés avec la toxine élaborée par le bacille du tétanos ou avec l’anatoxine, il existe sous forme de sérum liquide (au moins 300 unités par cm3), de sérum purifié et desséché.
• Sérum non spécifique : le sérum normal de cheval et le liquide qui se prépare du caillot après la coagulation spontanée du sang d’un animal sain ; le sang est prélevé aseptiquement par saignée à la veine jugulaire.
Vaccination
La vaccination est un acte de prévention qui symbolise la progression de la médecine. C’est une méthode qui consiste à immuniser l’organisme par inoculation ou ingestion de vaccins. Elle consiste, donc, à administrer dans l’organisme un germe microbien ou une toxine à virulence atténuée. L’organisme réagit, alors, à ce corps étranger en fabriquant des anticorps. Ainsi, lors d’une infection ultérieure, l’organisme possède déjà des anticorps prêts à agir contre ce germe infectieux. L’immunité ainsi créée est comparable à celle acquise spontanément. Elle est d’installation progressive et la durée en est plus ou moins longue mais n’est pas indéfinie, contrairement au sérum qui procure une immunité passive, immédiate mais de courte durée.
Immunité
C’est la capacité que possède l’organisme à se défendre, en particulier lors d’une agression par un agent infectieux. Ce terme désigne, également, l’ensemble des facteurs humoraux et cellulaires qui protègent l’organisme de toute agression.
a. Immunité active
C’est le processus conférant l’immunité par introduction d’antigènes dans le corps.
b. Immunité passive
C’est le processus conférant l’immunité par introduction d’anticorps spécifiques.
Population cible
C’est le nombre des enfants de 0 à 11 mois de 4% de la population totale, des femmes en âge de procréer de 23% et les femmes enceintes de 4.5%, de la communauté qui sont dans le groupe d’âge cible à vacciner en un mois ou en un an.
Le vaccin reçu varie selon l’âge et se fait comme suit :
– les enfants de 0 à 11 mois, pour tous les antigènes de PEV (anti : diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, tuberculose, rougeole, hépatite B) ;
– les femmes enceintes, pour l’antigène antitétanique ;
– les femmes en âge de procréer, pour l’antigène antitétanique.
A noter que les enfants de moins de 5 ans dans le cadre de la Prise en Charge Intégrée de Maladies de l’Enfant (PCIME), reçoivent tous les antigènes sauf le BCG qui est limité aux enfants de moins de 12 mois.
INTRODUCTION |