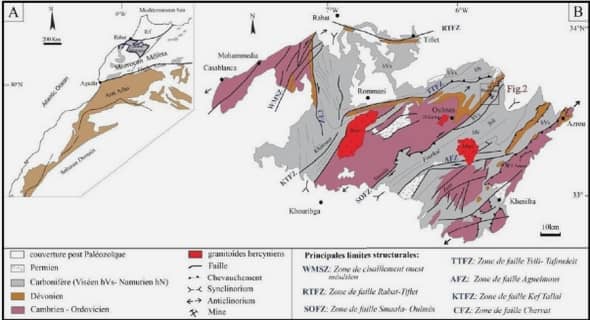L’ENVIRONNEMENT ET LA SECURITE ALIMENTAIRE: LES ASPECTS THEORIQUES
Le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation reconnaît le rôle qu’une bonne gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement peuvent jouer dans la hausse de la productivité des terres, de l’eau, des forêts, de la mer et du travail, dans l’augmentation de la production alimentaire et agricole, et dans l’amélioration de la sécurité alimentaire. Il fournit une série de directives pour arriver à la sécurité alimentaire durable, entre autres par le biais d’une meilleure gestion des ressources naturelles et de la protection de l’environnement puisqu’il traite d’agriculture, de pâturages, de forêts et de pêche. De plus, la plupart des spécialistes qui ont analysé les scénarios mondiaux de l’offre et de la demande pensent que l’offre totale d’ici quinze ans devrait être en mesure de satisfaire la demande alimentaire mondiale. Mais ces même spécialistes s’accordent également à dire que dans le même temps, les projections statistiques indiquent que beaucoup de pays risquent de connaître de gros déficits alimentaires et la famine. Les disparités régionales et nationales dans la disponibilité alimentaire et la nutrition risquent de persister et pourraient même devenir plus prononcées. (Uttam Dabholkar2002) .
THEORIES SUR LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE
Une hausse de la production alimentaire et de la demande est nécessaire, mais il est évident que cela ne suffira pas à renforcer la sécurité alimentaire. Alors, une bonne gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement s’avèrent importants pour augmenter de manière durable la production alimentaire et l’offre. Le présent chapitre nous permet donc de connaître les différents modèles de gestion des ressources naturelles, les approches socio-économiques de l’environnement naturel et enfin les concepts fondamentaux de la sécurité alimentaire.
Les modèles de gestion des ressources naturelles
Pression démographique, divergence d’intérêt, … nombreux sont actuellement les phénomènes qui conduisent à la privatisation des ressources naturelles jusque là en propriété commune. Le débat qui persiste actuellement, c’est la comparaison en termes d’efficacité entre: la propriété privée et la propriété commune des ressources naturelles.
a) La propriété privée des ressources naturelles
Avoir une propriété privée signifie » être autorisée à exclure d’autres personnes et à prendre soi-même la décision de faire telle ou telle chose » . Si une personne a donc le droit d’utiliser des ressources naturelles quelconques, il peut les détruire, les utiliser, les vendre etc, et personne n’est autorisé à l’en empêcher. En d’autres termes, il est l’autorité en la matière, il est le souverain.
Vers le XVIII ème siècle, se trouve l’idée ou « la prospérité économique d’une nation dépend étroitement de la mesure dans laquelle les citoyens respectent les lois naturelles qui sont censées gouverner toute société humaine » . Ces lois étaient conçues pour traduire l’action d’une »main invisible » pouvant assurer l’auto reproduction et le progrès régulier de la société. Ces mécanismes exigent l’existence d’institutions efficaces sans lesquelles le progrès matériel est impossible (Delas, 1991) . La propriété privée figurait au premier plan de ces institutions, et puisque l’agriculture était une activité dominante à l’époque, la propriété privée de la terre apparaissait comme une condition importante du développement agricole et de la sécurité alimentaire d’un pays. François Quesnay et ses disciples ont fortement insisté sur l’importance de la relation précédente. Ils seront suivis par Adam Smith, pour qui la propriété privée (sur toute forme de richesse) constituait un outil majeur à l’accumulation du capital.
b) La gestion communautaire des ressources naturelles : la cogestion et l’auto organisation
Au sens de la loi, une ressource communautaire est définie comme : « une ressource faisant l’objet d’une convention de gestion entre une communauté villageoise et l’administration… » . L’expression gestion de ressources naturelles englobe une vaste gamme d’activités et de projets. La présente, sous-section concerne les aspects de gestion des ressources naturelles qui requièrent spécifiquement la participation des communautés locales. Selon Litvack J. (1996) , la conservation centralisée n’est efficace que lorsqu’elle est effectuée de façon autocratique ou en dépensant un énorme fonds. Aussi, selon ce même chercheur, la participation de tout concernés est considérée indispensable pour une gestion efficace et la conservation des systèmes de ressources naturelles. En effet, on admet donc qu’une décentralisation poussée peut être favorable à la participation des communautés locales.
La gestion communautaire des ressources naturelles peut se présenter sous deux formes à savoir : la cogestion et l’auto organisation. La cogestion consiste à diviser ou bien partager équitablement – entres les acteurs et l’Etat – la décision. Ici, la collaboration étroite entre ces deux entités est très importante, car elle facilite la diffusion d’information dans les communautés. Libecap (1989) et Ostrom (1990) ont affirmé que la cogestion permet de faciliter le processus de décision, surtout dans des petits groupes stables ou l’autorité locale est reconnue par le gouvernement. Kuperan et Abdulla (1974) donnent aussi ces arguments en faveur de la cogestion en énonçant que : » La cogestion est un modèle adapté aux situations locales car elle reconnaît l’existence d’un savoir écologique traditionnel, et d’un système basé sur le droit coutumier ». En général, la cogestion requiert des liens opérationnels efficaces entre le secteur public, le secteur privé et les groupes communautaires.
Approche socio-économique de l’environnement
L’homme moderne, Homo sapiens, est apparu tardivement sur la Terre . Les premiers hommes, peu nombreux et dépourvus de moyens techniques, ont vécu pendant longtemps en harmonie avec leur milieu, comme les autres animaux. Ils étaient des chasseurs-cueilleurs qui avaient besoin, pour survivre, de bien connaître les plantes et les animaux. Cet équilibre a profondément changé avec la première révolution agricole, qui a favorisé l’érosion du sol et la dégradation de la végétation naturelle. Tant que les hommes sont restés peu nombreux et leurs moyens techniques rudimentaires, leur impact sur la nature a été limité et localisé. Actuellement, « il y a plus de six milliards d’hommes sur Terre, et certaines régions sont surpeuplées » ( Microsoft Encarta 2003). Les besoins en terres cultivables, en matières premières et en sources d’énergie ainsi que les besoins en termes sociaux croissent constamment et les moyens techniques permettant de modifier ou même de détruire le milieu ont une puissance considérable. En outre, les hommes se concentrent dans des villes dont l’air est de plus en plus pollué et ils perdent le contact avec la nature. La dégradation de la biosphère a déjà, et aura des conséquences de plus en plus préoccupantes.
Approche purement économique de la biodiversité : valeur économique des ressources naturelles
Le fait que la biologie de la préservation développe des connaissances sur la dynamique de la biodiversité et propose des stratégies écologiquement efficaces pour sa préservation est insuffisante. Il faut aussi qu’elle élabore ces plans stratégiques de façon à les rendre interdépendant avec le développement économique. Faire de la conservation un objectif politiquement et socialement acceptée par la population nécessite une évaluation économique, mais aussi éthique et philosophique, de la biodiversité. Selon Barbault , trois types de difficultés se heurtent avec l’évaluation économique de la biodiversité, à savoir :
– méconnaissance d’une grande part de la biodiversité et de ses rôles précises,
– l’indicateur capable d’intégré globalement gène, espèces et écosystème n’existe pas encore pour l’évaluation de cette biodiversité,
– les outils économiques habituels sont difficilement compatibles avec la représentation écologique du monde.
INTRODUCTION |