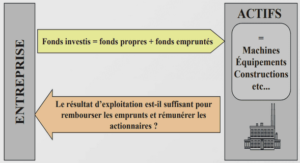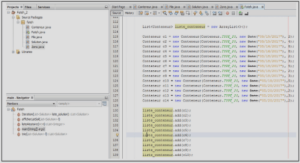L’Enseignement de la langue et communication dans les écoles élémentaires de la banlieue
Définition des concepts
La maitrise de certaines notions clés dans le jargon éducatif est une priorité voire une nécessité pour tous les acteurs du milieu. Ainsi pour mieux imprégner l’opinion publique de notre sujet voici des termes que nous jugeons important de définir : Enseignement/Apprentissage Ce sont des termes que l’on associe le plus souvent quand on parle du processus de l’enseignement /apprentissage. Ces notions méritent des éclaircissements Enseignement Du latin « insignarer » qui signifiait : signaler, faire reconnaitre ; il est défini par le MEQ (1981) comme une « activité assumée par le personnel enseignant auprès de l’élève dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de l’éducation scolaire tel qu’ils sont définis dans les programmes d’études »p507 BEGIN, Y (1973) clarifie la notion comme étant « une intervention d’une personne sur les activités d’apprentissage d’une autre personne qui se soumet à cette intervention et qui accepte en conséquence une certaine structuration de ces activités d’apprentissage par un enseignant » p507 En examinant ces deux définitions, il est évident de constater que la seconde acceptation du mot enseignement est plus large car il englobe toute la procédure de diffusion d’un savoir donné à un récepteur par une personne habilitée. Par contre, la première signification, celle du ministère Québécois de l’éducation est plus expressive dans la mesure où elle centre le débat dans le domaine scolaire. C’est dans ce cadre que l’enseignement est une science de par son recours à la technique et il est aussi un art qui s’exprime par les compétences, l’expérience, et la personnalité de l’enseignant1 . En effet, les enseignements que l’on dispense aujourd’hui au Sénégal sont plus centrés sur l’apprenant que sur l’enseignant. Il permet à l’élève de mieux mobiliser ses capacités intellectuelles pour participer à sa propre formation. Ainsi, il est à signaler qu’au sein de l’enseignement il y a des subdivisions selon des niveaux: l’enseignement supérieur, l’enseignement technique et la formation professionnelle, l’enseignement moyen et secondaire, et enfin l’enseignement primaire et préscolaire. Dans le champ de l’enseignement primaire qui nous concerne, nous notons six classes réparties par Joan, FREEMAN, (1993) pour une éducation de base de qualité: comment développer la compétence p153 20 cycle. Cet enseignement élémentaire est destiné aux enfants âgés de 7 à 12 ans pour acquérir des connaissances de base qui seront couronnées à la sixième année par un certificat de fin d’étude élémentaire connu sur le nom de CFEE. Mais de nos jours, on constate que nombreux sont des élèves qui franchissent ce stade sans au préalable décrocher le grade et qui poursuivent leur scolarité au niveau de l’enseignement moyen. Apprentissage SEGUN, S.P(1974) définit l’apprentissage comme « la résultante d’un cheminement d’évolution chez un sujet qui peut se traduire entre autre, par l’acquisition de connaissance, de développement d’habileté ou d’un savoir-faire, l’adoption de nouvelles attitudes, de nouvelles valeurs, de nouvelles orientations cognitives de nouveaux intérêts ou d’un savoir être » p67. Une autre définition tirée du dictionnaire actuel de l’éducation de Renald LEGENTRE consolide la première. Celui-ci définit le terme comme étant : «le processus d’acquisition ou de changement, dynamique et interne à une personne, laquelle, mue par le désir et la volonté de développement, construit de nouvelles représentations explicatives, cohérentes et durables de son réel à partir de la perception de matériaux, de stimulations de son environnement, de l’interaction entre les données internes et externes au sujet et d’une prise de conscience personnelle » p67 De ces définitions acceptables, nous pouvons formuler une synthèse pour dire que l’apprentissage consiste à acquérir des connaissances, construire de nouvelles compétences et modifier sa façon d’agir et de penser. Cependant, parler de l’apprentissage évoque généralement l’idée d’apprentissage chez les élèves, mais les caractéristiques de l’apprentissage s’appliquent tout autant à l’apprenant et à l’enseignant. Car ce dernier avant de pouvoir transmettre des connaissances passe obligatoirement par le processus d’apprentissage dit t-on : « qui ne cesse d’apprendre, cesse d’enseigner ». Toutefois, certaines difficultés empêchent la procédure d’apprentissage à l’école : – Handicaps physiques, spécifiques (insuffisance de la vue ou de l’ouïe) qui n’ont pas été décelés ou qui ont été négligés – Pauvreté extrême – Comportements sociaux ou culturels défavorables 21 – Négligence ou mauvais traitement à l’égard de l’enfant – Manque de suivi régulier à la maison
La didactique et la pédagogie
La didactique et la pédagogie sont deux termes proches mais distincts l’un de l’autre: la didactique se préoccupe de la planification, du contrôle, de la régulation des objectifs et des moyens de les atteindre par un groupe d’élèves. Quant à la pédagogie, elle utilise les données fournies notamment par les didacticiens pour susciter les meilleurs apprentissages. Pour plus de détail voici la définition de chaque notion.
La didactique
Le dictionnaire didactique de langue française (1996) de Michel POUGEOISE définit le terme didactique comme « une discipline qui a pour but de définir et de délimiter un champ d’étude spécifique, un langage descriptif et un parcours d’enseignement avec une méthode de présentation des stratégies d’exploitation et de recherche ». Ce dictionnaire didactique des langues s’est trop penché sur l’aspect linguistique c’est-à-dire comment acquérir des langues. Cependant elle est définie autrement dans le dictionnaire actuel de l’éducation paru en 1993 et c’est cette définition qui a plus de rapport ave notre sujet de recherche car cette clarification du concept touche le domaine de l’enseignement apprentissage. Dès lors, le terme didactique est défini dans ce glossaire comme étant « une discipline éducationnelle appliquée qui consiste à élaborer, expérimenter, évaluer et assurer la rétroaction continuelle d’un agencement d’objectif et de stratégie pédagogique devant permettre à des sous-groupe de sujet d’atteindre les buts d’un système éducatif »p357 Dans la thèse intitulée application à la didactique de la psychologie de Jean Piaget, Hans HABLI et M.A définissent la notion comme « une science auxiliaire de la pédagogie à laquelle cette dernière délègue, pour la réalisation ou des détails, plus des tâches éducatives générales comme amener l’élève à acquérir telle notion, telle opération ou telle technique de travail » En confrontant la définition des deux dictionnaires, l’un didactique des langues et l’autre de l’éducation, nous remarquons une différence de champ d’étude dans la mesure où chaque manuel tente d’apporter des réponses qui favorisent une meilleure compréhension de son 22 domaine de compétence. Ainsi pour mieux soutenir la seconde définition afin de la renforcer, nous prenons appui sur ces mots que la didactique est un ensemble de stratégies, de techniques mis sur pied dont l’objet concerne les interventions éducatives de l’enseignant dans la situation pédagogique réelle.
La pédagogie
Tirant sa propre maitrise des vertus de la science et de la méthode, le mot pédagogie conformément à son étymologique s’applique à un enseignement des enfants, par opposition à andragogie pour les adultes. Mais au fil des temps, le sens étymologique du terme pédagogie science qui a pour objectif l’éducation des enfants semble avoir été oubliée. L’usage a retenu son sens de méthode éducative C.T.E.Q (1985) Le dictionnaire de l’éducation actuel la définit comme une discipline éducationnelle qui élabore des méthodes et des principes concernant la dynamique et l’harmonisation de la situation pédagogique. Elle est constituée d’un ensemble de valeur de règle, de principe, de modèle ainsi que toutes les autres données théoriques et pratiques dont le but est de guider les interventions de l’enseignant de façon à optimiser les apprentissages de tout un chacun. C’est ainsi qu’aujourd’hui des théoriciens de l’éducation pensent que la pédagogie différenciée est la meilleure démarche pour mettre en œuvre un ensemble diversifié d’apprentissage à des apprenants de niveau différent parce qu’ils viennent des catégories socio culturelles diverses, et les rythmes d’apprentissage fort éloignés des uns des autres. Ainsi, nous pouvons dire que le terme pédagogie désigne une méthode particulière d’un enseignant d’utiliser des ressources nécessaires pour une meilleure compréhension des apprenants dans une situation d’apprentissage. C’est à dire les différents procédés employés par le maître pour faciliter l’acquisition des élèves en suscitant leurs inquiétudes. Alors la remarque est naturelle dans ce milieu, les apprenants déclarent que tel enseignant a de la connaissance mais il n’a pas de pédagogie. Toutefois, l’absence totale de pédagogie adaptée à des situations où le français n’est pas la langue maternelle des gens enseignés1 surtout dans la banlieue pose une énorme difficulté dans l’apprentissage des élèves. Mieux dans un contexte submergé par la pédagogie inspirée de la psychologie de l’apprentissage qui met en relation directe l’enfant avec le savoir en maintenant le maître dans une position de médiateur. DUMONT. P (1983)
Un curriculum
Du latin « curriculum » ,signifiait un terrain ou champ de course, il est apparu dans le vocabulaire de l’éducation à partir du XVII siècle pour désigner un ensemble de savoir qui a pour objectif pratique la construction méthodique d’un plan éducatif global ou spécifique, reflétant les valeurs et les orientations d’un milieu et devant permettre l’atteinte de but prédéterminé de l’éducation. Selon shorter oxford dictionnairy le terme curriculum signifie « l’ensemble structuré des expériences d’enseignement et d’apprentissage (objectif de contenu, habileté spécifique, cheminements ramifiés et règles de progression de réussite, environnement éducatif) planifiées et offertes sous la direction d’une institution scolaire en vue d’atteindre des buts éducatifs prédéterminés »p228. Quant au PDEF qui était l’outil de politique de l’Etat du Sénégal définit le concept comme étant « un instrument stratégique essentiel d’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la promotion de l’éducation de base. » p62 Ainsi, après ces définitions sur la terminologie de curriculum, voici notre propre définition sur la question : le curriculum est un accessoire de référence permettant aux acteurs éducatifs de mieux conceptualiser les contenus d’enseignement pour une meilleure prise en charge des questions relatives à l’apprentissage par le biais d’un programme défini au préalable. Car il planifie des finalités d’objectif à atteindre dans des moments précis, et demande des méthodes pédagogiques à mettre en œuvre. Mais l’emploi exclusif des manuels conçus pour cela nécessite la formation initiale et continue des maîtres afin qu’ils puissent mieux être à la hauteur des attentes des autorités en charge de l’éducation. Néanmoins, rappelons que dans sa conception anglo-saxonne, le curriculum désigne la conception, l’organisation et la programmation des activités d’enseignement apprentissage selon un parcours éducatif. Il regroupe l’énoncé des finalités, les contenus, les activités et les démarches d’apprentissage, ainsi que des modalités et moyens d’évaluation des acquis des élèves. Sa conception se fait d’un projet d’école reflétant un projet de société. Son caractère systémique permet de prendre en charge les cibles de l’action éducative, les acteurs, de même l’environnement scolaire.
DEDICACE |