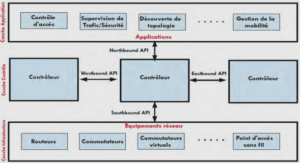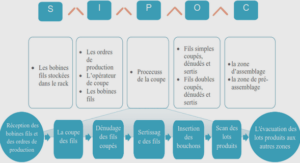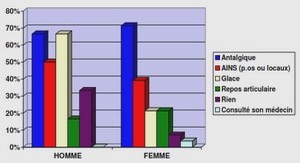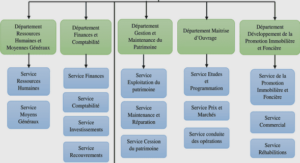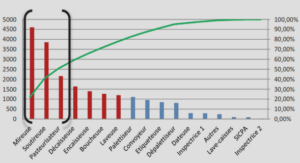L’ENFANT NOIR
J’étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là ? Je ne me rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore : cinq ans, six ans peut-être. Ma mère était dans l’atelier, près de mon père, et leurs voix me parvenaient, rassurantes, tranquilles, mêlées à celles des clients de la forge et au bruit de l’enclume.
Brusquement, j’avais interrompu de jouer, l’attention, toute mon attention, captée par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case ; et je m’étais bientôt approché. J’avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour – il en traînait toujours, qui se détachaient de la palissade de roseaux tressés qui enclôt notre concession – et, à présent, j’enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas : il prenait goût au jeu ; il avalait lentement le roseau, il l’avalait comme une proie, avec la même volupté, me semblait-il, les yeux brillants de bonheur, et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti, et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes doigts.
Je riais, je n’avais pas peur du tout, et je crois bien que le serpent n’eût plus beaucoup tardé à m’enfouir ses crochets dans les doigts si, à l’instant, Damany, l’un des apprentis, ne fût sorti de l’atelier. L’apprenti fit signe à mon père, et presque aussitôt je me sentis soulevé de terre : j’étais dans les bras d’un ami de mon père !
Autour de moi, on menait grand bruit ; ma mère surtout criait fort et elle me donna quelques claques. Je me mis à pleurer, plus ému par le tumulte qui s’était si opinément élevé, que par les claques que j’avais reçues. Un peu plus tard, quand je me fus un peu calmé et qu’autour de moi les cris eurent cessé, j’entendis ma mère m’avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu ; je le lui promis, bien que le danger de mon jeu ne m’apparut pas clairement.
Mon père avait sa case à proximité de l’atelier, et souvent je jouais là, sous la véranda qui l’entourait. C’était la case personnelle de mon père. Elle était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l’eau ; et comme toutes nos cases, rondes et fièrement coiffées de chaume. On y pénétrait par une porte rectangulaire. À l’intérieur, un jour avare tombait d’une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d’une simple natte en osier tressé et d’un oreiller bourré de kapok. Au fond de la case et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les boubous et les peaux de prière. Enfin, à la tête du lit, surplombant l’oreiller et veillant sur le sommeil de mon père, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d’écorces.
Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle et elles étaient richement et curieusement cerclées de chapelets de cauris ; on avait tôt fait de comprendre qu’elles étaient ce qu’il y avait de plus important dans la case ; de fait, elles contenaient les gris-gris, ces liquides mystérieux qui éloignent les mauvais esprits et qui, pour peu qu’on s’en enduise le corps, le rendent invulnérable aux maléfices, à tous les maléfices. Mon père, avant de se coucher, ne manquait jamais de s’enduire le corps, puisant ici, puisant là, car chaque liquide, chaque gri-gri a sa propriété particulière ; mais quelle vertu précise ? Je l’ignore : j’ai quitté mon père trop tôt.
De la véranda sous laquelle je jouais, j’avais directement vue sur l’atelier, et en retour on avait directement l’œil sur moi. Cet atelier était la maîtresse pièce de notre concession. Mon père s’y tenait généralement, dirigeant le travail, forgeant lui-même les pièces principales ou réparant les mécaniques délicates ; il y recevait amis et clients ; et si bien qu’il venait de cet atelier un bruit qui commençait avec le jour et ne cessait qu’à la nuit. Chacun, au surplus, qui entrait dans notre concession ou qui en sortait, devait traverser l’atelier ; d’où un va-et-vient perpétuel, encore que personne ne parût particulièrement pressé, encore que chacun eût son mot à dire et s’attardât volontiers à suivre des yeux le travail de la forge. Parfois je m’approchais, attiré par la lueur du foyer, mais j’entrais rarement, car tout ce monde m’intimidait fort, et je me sauvais dès qu’on cherchait à se saisir de moi. Mon domaine n’était pas encore là ; ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai pris l’habitude de m’accroupir dans l’atelier et de regarder briller le feu de la forge.
Mon domaine, en ce temps-là, c’était la véranda qui entourait la case de mon père, c’était la case de ma mère, c’était l’oranger planté au centre de la concession.
Sitôt qu’on avait traversé l’atelier et franchi la porte du fond, on apercevait l’oranger. L’arbre, si je le compare aux géants de nos forêts, n’était pas très grand, mais il tombait de sa masse de feuilles vernissées, une ombre compacte, qui éloignait la chaleur. Quand il fleurissait, une odeur entêtante se répandait sur toute la concession. Quand apparaissaient les fruits, il nous était tout juste permis de les regarder nous devions attendre patiemment qu’ils fussent mûrs. Mon père alors qui, en tant que chef de famille – et chef d’une innombrable famille – gouvernait la concession, donnait l’ordre de les cueillir. Les hommes qui faisaient cette cueillette apportaient au fur et à mesure les paniers à mon père, et celui-ci les répartissait entre les habitants de la concession, ses voisins et ses clients ; après quoi il nous était permis de puiser dans les paniers, et à discrétion ! Mon père donnait facilement et même avec prodigalité : quiconque se présentait partageait nos repas, et comme je ne mangeais guère aussi vite que ces invités, j’eusse risqué de demeurer éternellement sur ma faim, si ma mère n’eût pris la précaution de réserver ma part.
— Mets-toi ici, me disait-elle, et mange, car ton père est fou.
Elle ne voyait pas d’un trop bon œil ces invités, un peu bien nombreux à son gré, un peu bien pressés de puiser dans le plat. Mon père, lui, mangeait fort peu : il était d’une extrême sobriété. Nous habitions en bordure du chemin de fer. Les trains longeaient la barrière de roseaux tressés qui limitait la concession, et la longeaient à vrai dire de si près, que des flammèches, échappées de la locomotive, mettaient parfois le feu à la clôture ; et il fallait se hâter d’éteindre ce début d’incendie, si on ne voulait pas voir tout flamber. Ces alertes, un peu effrayantes, un peu divertissantes, appelaient mon attention sur le passage des trains ; et même quand il n’y avait pas de trains – car le passage des trains, à cette époque, dépendait tour entier encore du trafic fluvial, et c’était un trafic des plus irréguliers – j’allais passer de longs moments dans la contemplation de la voie ferrée.
Les rails luisaient cruellement dans une lumière que rien, à cet endroit, ne venait tamiser. Chauffé dès l’aube, le ballast de pierres rouges était brûlant ; il l’était au point que l’huile, tombée des locomotives, était aussitôt bue et qu’il n’en demeurait seulement pas trace. Est-ce cette chaleur de four ou est-ce l’huile, l’odeur d’huile qui malgré tout subsistait, qui attirait les serpents ? Je ne sais pas. Le fait est que souvent je surprenais des serpents à ramper sur ce ballast cuit et recuit par le soleil ; et il arrivait fatalement que les serpents pénétrassent dans la concession. Depuis qu’on m’avait défendu de jouer avec les serpents, sitôt que j’en apercevais un, j’accourais chez ma mère.
— Il y a un serpent ! criais-je.
— Encore un ! s’écriait ma mère.
Et elle venait voir quelle sorte de serpent c’était. Si c’était un serpent comme tous les serpents – en fait, ils différaient fort ! – elle le tuait aussitôt à coups de bâton, et elle s’acharnait, comme toutes les femmes de chez nous, jusqu’à le réduire en bouillie, tandis que les hommes, eux, se contentent d’un coup sec, nettement assené.
Un jour pourtant, je remarquai un petit serpent noir au corps particulièrement brillant, qui se dirigeait sans hâte vers l’atelier. Je courus avertir ma mère, comme j’en avais pris l’habitude ; mais ma mère n’eut pas plus tôt aperçu le serpent noir, qu’elle me dit gravement :
— Celui-ci, mon enfant, il ne faut pas le tuer ; ce serpent n’est pas un serpent comme les autres, il ne te fera aucun mal ; néanmoins, ne contrarie jamais sa course.
Personne, dans notre concession, n’ignore que ce serpent-là, on ne devait pas le tuer, sauf moi, sauf mes petits compagnons de jeu, je présume, qui étions encore des enfants naïfs.
— Ce serpent, ajouta ma mère, est le génie de ton père.
Je considérai le petit serpent avec ébahissement. Il poursuivait sa route vers l’atelier ; il avançait gracieusement, très sûr de lui, eût-on dit, et comme conscient de son immunité ; son corps éclatant et noir étincelait dans la lumière crue. Quand il fut parvenu à l’atelier, j’avisai pour la première fois qu’il y avait là, ménagé au ras du sol, un trou dans la paroi. Le serpent disparut par ce trou.
— Tu vois : le serpent va faire visite à ton père, dit encore ma mère.
Bien que le merveilleux me fût familier, je demeurai muet tant mon étonnement était grand. Qu’est-ce qu’un serpent avait à faire avec mon père ? Et pourquoi ce serpent-là précisément ? On ne le tuait pas, parce qu’il était le génie de mon père ! Du moins était-ce la raison que ma mère donnait. Mais au juste qu’était-ce qu’un génie ? Qu’étaient ces génies que je rencontrais un peu partout, qui défendaient telle chose, commandaient telle autre ? Je ne me l’expliquais pas clairement, encore que je n’eusse cessé de croître dans leur intimité. Il y avait de bons génies, et il y en avait de mauvais ; et plus de mauvais que de bons, il me semble. Et d’abord qu’est-ce qui me prouvait que ce serpent était inoffensif ? C’était un serpent comme les autres ; un serpent noir, sans doute, et assurément un serpent d’un éclat extraordinaire ; un serpent tout de même !
J’étais dans une absolue perplexité, pourtant je ne demandai rien à ma mère je pensais qu’il me fallait interroger directement mon père ; oui, comme si ce mystère eut été une affaire à débattre entre hommes uniquement, une affaire et un mystère qui ne regarde pas les femmes ; et je décidai d’attendre la nuit.
Sitôt après le repas du soir, quand, les palabres terminées, mon père eut pris congé de ses amis et se fut retiré sous la véranda de sa case, je me rendis près de lui. Je commençai par le questionner à tort et à travers, comme font les enfants, et sur tous les sujets qui s’offraient à mon esprit ; dans le fait, je n’agissais pas autrement que les autres soirs ; mais, ce soir-là, je le faisais pour dissimuler ce qui m’occupait, cherchant l’instant favorable où, mine de rien, je poserais la question qui me tenait si fort à cœur, depuis que j’avais vu le serpent noir se diriger vers l’atelier. Et tout à coup, n’y tenant plus, je dis :
— Père, quel est ce petit serpent qui te fait visite ?
— De quel serpent parles-tu ?
— Eh bien ! du petit serpent noir que ma mère me défend de tuer.
— Ah ! fit-il.