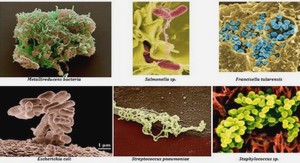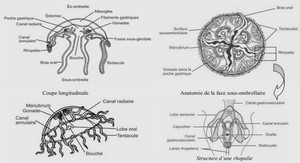Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
L’apparition du strip dans la presse
Autre élément bénéfique à cette éclosion : l’industrialisation de la littérature16 par le développement dans la presse des histoires à suivre. Dans un but de fidélisation du lecteur, les rédactions de journaux laissent une place de leur publication à des feuilletons dont la caractéristique est d’être composés d’épisodes à suivre. Cette pratique mise en place par Émile de Girardin apparait en 1836 dans le journal La Presse.
Malgré les critiques sur la qualité des dites publications – en particulier leur objectif de recherche de profit plutôt que de traits d’esprits et la qualification de « littérature industrielle »17 (Sainte- Beuve) – ces écrits ont habitué le lecteur à disposer d’une bande de journal axée sur le loisir et non pas l’actualité ou le reportage. Ainsi le format du strip (bande) ne sera pas une complète découverte lorsqu’il apparaitra dessiné.
La figure précurseur de Rodolphe Töpffer
En traitant de l’apparition de la bande dessinée, il est immanquable de passer par la présentation du personnage et de la production de Rodolphe Töpffer. S’exerçant à partir de la fin des années 1820, le Suisse est en effet retenu comme le père de la bande dessinée de par sa production et l’analyse qu’il porte sur cette nouvelle littérature.
Töpffer est le premier à réunir dans ses œuvres trois caractéristiques essentielles qui participent à la définition de la bande dessinée.
La première est la création d’histoires séquentielles. C’est-à- dire que les scénarios de Töpffer se déroulent en séquences, sous le format de bande, divisées en cases racontant chacune un moment de l’histoire. De plus, le temps de récit s’écoulant entre les cases n’est pas fixe ; deux cases peuvent se succéder sur le papier comme dans le temps ou bien être séparées de plusieurs heures ou jours dans le récit. Les espaces inter-cases qu’on appelle marges sont des ellipses narratives.
La deuxième caractéristique de ce nouveau média est la reproductibilité technique. Profitant des moyens de reproduction et diffusion offerts par la lithographie récemment inventée, Töpffer fera connaitre en 1833 L’histoire de M. Jabot à ses compatriotes mais aussi aux pays voisins. Il ne s’agit pas d’une diffusion de masse telle qu’on l’entend au XXIe siècle mais c’est le premier échelon de la BD qui s’étend. Toutefois, il faut se rappeler qu’à ses débuts (1827) M. Jabot n’était connu que des proches de l’auteur et de ses élèves. Töpffer voulait par cette diffusion volontairement faible limiter dans un premier temps les jugements que le public pouvait alors lui porter par rapport à son statut d’enseignant et homme de lettres. Les mentalités n’étaient pas forcément favorables à une nouvelle forme d’histoire. La critique s’arrête sur le débat de la hiérarchie entre le texte et l’image. Selon Thierry Groensteen « cette tension s’appuie sur un substrat culturel qui attribue la prédominance hiérarchique au texte sur l’image, à la raison du langage contre la passion des sens »18. La « bonne » pédagogie d’alors préfère l’apprentissage au divertissement ; or, la bande dessinée, par l’importance qu’elle donne à l’image, contrevient à ce précepte.
Les histoires de Töpffer surmonteront finalement cette difficulté.
Enfin, la troisième caractéristique propre à la bande dessinée que Töpffer présente est un rapport étroit entre le texte et l’image. Il faut partir du postulat que l’auteur créé des histoires dont chaque séquence est accompagnée d’un dessin (exécuté par lui-même). Mais à la différence de ce qui était vu dans les illustrations qui se limitaient à présenter ce qui était dit par le texte, il y a là une réelle solidarité entre l’écrit et le dessin.
Puisqu’il en a conscience et le revendique, il faut laisser l’auteur expliquer ce rapport particulier entre les deux moyens d’expression. Dans un avertissement au lecteur de L’histoire de M. Jabot, Töpffer prévient :
Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se compose d’une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d’une ou deux lignes de texte. Les dessins, sans ce texte, n’auraient qu’une signification obscure ; et le texte sans les dessins ne signifierait rien. Le tout forme une sorte de roman d’autant plus original qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre chose19 .
Ce ton explicite permet par ailleurs à Töpffer d’apporter des réponses aux interrogations qui se posent naturellement au sujet de ses créations. Que sont-elles ? À quoi peut-on s’attendre avec ce nouveau média ? Il apparait ainsi comme le premier théoricien de la BD, notamment grâce à son Essai de physiognomonie de 1845, duquel sont tirées les citations suivantes.
Le Suisse a effectivement pleinement conscience d’explorer un nouveau champ d’expression et donne ses lettres de noblesse à sa production : « L’on peut écrire des histoires avec des chapitres, des lignes, des mots : c’est de la littérature proprement dite. L’on peut écrire des histoires avec des successions de scènes représentées graphiquement : c’est de la littérature en estampes »20. Une fois encore, Töpffer innove, il est le premier à proposer une appellation pour cette nouvelle forme d’expression, ce qui en légitime sa paternité21.
Cette première définition est parfaitement explicative du nouveau sujet. Mais puisque ce ne sont que les débuts, Töpffer prédit qu’il faut s’attendre à des évolutions parce que c’est « un genre encore bien nouveau où il y a prodigieusement à moissonner »22.
Le créateur Suisse comprend aussi la diversification vers laquelle peut aller la littérature en estampes : « il est certain que le genre est susceptible de donner des livres, des drames, des poèmes, tout comme un autre, à quelques égards mieux qu’un autre… »23. Il promeut ainsi déjà ces lectures encore jeunes en annonçant qu’elles ne seront pas monotypiques.
Une dernière remarque vient justifier la distinction de « père de la BD » accordée à Töpffer. Il s’agit d’un élément toujours d’actualité, c’est la volonté de créer du divertissement24. Que ce soit par l’histoire de M. Crépin (1837) ou les amours de M. Vieuxbois (1838) l’auteur se détache des illustrations jusqu’alors connues à travers les âges en présentant des images de fiction de son cru et non pas des images saintes ou historiques auxquelles la population a toujours été habituée. Il est l’inventeur de la BD dans le sens (juridique) où l’on « invente » un trésor en en faisant la découverte : « il a révélé au grand jour une forme narrative qui existait déjà, sous d’autres aspects, bien avant lui »25.
S’il apparait comme le père fondateur de la bande dessinée, Töpffer n’est pas le seul européen à s’essayer à cette forme d’expression nouvellement venue au XIXe siècle. Un suiveur en particulier est à mettre en avant : l’Allemand Wilhelm Busch, auteur de Max und Moritz. Ce sont les histoires de deux gamins turbulents et espiègles, parues pour la première fois en 1865. Le livre 26 est original par la rédaction des textes en rimes encadrant les dessins en couleurs où les enfants exécutent leurs tours27. Ces héros connaitront une nouvelle jeunesse encore plus populaire environ trois décennies plus tard en inspirant les Katzenjammer kids de Rudolph Dirks28, traduits en français en Pim, Pam, Poum.
Bien que travaillant sur le sol américain, Dirks était d’origine allemande, ce qui a profité à la postérité des héros qu’il a pu lire plus jeune. Ici, l’inspiration est à chercher à la source de l’auteur lui-même qui participe au déplacement du centre d’activité de la BD de l’Europe vers les États-Unis.
Le « boom » des années 1890, les États-Unis s’emparent du phénomène
Après une traversée du milieu du XIXe siècle sans évolution majeure, la bande dessinée trouve des couleurs et son développement avant le passage aux années 1900.
Pendant le dernier tiers du XIXe siècle on s’aperçoit d’une prolifération de périodiques à travers le monde ; ils présentent des caricatures, images déjà ancrées dans la culture populaire.
La presse se développant, la concurrence pousse à attirer le lecteur par des illustrations et l’usage de couleurs pour illustrer les faits divers ; puis la « Sunday page » (page du dimanche) prend de l’importance auprès du lectorat29.
Les histoires en images des suppléments dominicaux ne connaissent pas un grand succès en Europe. Mais elles le rencontrent aux États- Unis où la presse était entre les mains de magnats qui avaient les moyens (et l’envie, car poussés par la concurrence) d’innover.
C’est dans ce cadre-là que voient le jour les comics dans les années 1890.
Avec le recul dont nous disposons aujourd’hui, les comics peuvent être perçus comme une convergence des innovations et évolutions qui ont émaillé la production littéraire du XIX e siècle: dessins satiriques, caricatures et illustrations d’un côté et multiplication des titres de presse, périodiques puis lectures enfantines de l’autre.
Aux États-Unis donc, les comics sections (ou comics supplements) se répandent par les éditions dominicales du New York World d’abord (à partir de 1893, appartenant à Joseph Pulitzer) puis du New York Morning Journal (de Randolph Hearst) ensuite. Le terme comic était déjà connu depuis les histoires en images d’Arthur Frost publiées dans les années 1880 dans le Harper’s New Monthly mais il ne se popularise qu’à la décennie suivante grâce à ces supplements30. On utilisera aussi le mot funnies ; l’un comme l’autre démontrant le caractère humoristique des petites histoires dessinées dont ils sont le support.
Probablement parce qu’il est un enfant des rues et que le lectorat issu des classes populaires est important, le Yellow kid de Richard Outcault est la première star des comics. De son vrai nom Mickey Dugan, le môme apparait en 1895 dans des scènes de rues qui existaient déjà mais n’étaient pas encore centrées sur un héros récurrent. Yellow kid sera le premier. Son surnom provient de la couleur de son vêtement sur lequel s’affichent ses paroles, à l’exclusion de tout autre phylactère. Toutefois, d’autres zones de texte sont présentes, elles sont placées sur des panneaux, affiches ou cartons intégrés au dessin, par exemple collés au mur ou portés par des personnages.
Son succès est considérable, il fera débaucher Outcault du New York World par le New York morning journal quand ce dernier lancera son comic supplement, et donnera malgré lui naissance à l’expression « yellow journalism » renvoyant aux méthodes peu flatteuses que la presse n’hésite parfois pas à employer toujours dans la lutte concurrentielle31.
Mais l’héritage immédiat des histoires en images d’Outcault se trouve dans la multiplication par les titres de presse de ces comics qui se voient rapidement organisés en séries. C’est ainsi qu’apparaissent successivement les Katzenjammer Kids32 en 1897 ; le Happy hooligan33 en 1900 et Little Jimmy34 en 1905. Cette même année la plus célèbre série de Winsor Mc Cay, Little Nemo in Slumberland, rejoint Buster Brown35 dans le New York Herald.
Le succès de la formule transparait dans les chiffres de 1907. Cette année- là, quatre-vingt comic supplements sont présents dans les journaux américains et le San Francisco chronicle propose une bande quotidienne36 : Mutt and Jeff37 ; ils sont les héros du premier daily strip. Cette « bande quotidienne » qui présente un découpage en cases et des bulles, montre l’augmentation de la fréquence de parution de bande. De nombreux autres suivront, preuve de l’adoption par le public et les médias de cette littérature. S’il ne fallait en citer qu’un, ce serait Krazy Kat38 puisque le New York Journal le publie dans les pages… « Arts et théâtre ». Le choix d’une telle rubrique pour la diffusion des comics révèle une première considération de la bande dessinée comme un objet rattachable à la culture et aux loisirs.
Le développement est facilité par l’apparition des syndicates39. On nomme ainsi les entreprises qui ont profité du fleurissement de la presse à la fin du XIXe pour devenir « fournisseur de contenu ». D’abord les informations, puis différentes rubriques tels que les jeux ou romans à suivre. Aussi, quand les comics se créèrent, ces syndicates s’emparèrent de ce nouveau succès et un marché se mit en place. Pulitzer revendit les comics du New York World dès 1898. Le dessinateur Sydney Smith (auteur des Gumps) fut lié au Chicago tribune New York news syndicate par un contrat dont les chiffres démontrent l’importance prise par ce média. Signé en 1922, ledit contrat garantissait un revenu de cent mille dollars annuels à l’auteur pendant dix ans pour sa production de comics40. Ce type de lien professionnel allié à une demande grandissante du lecteur donna naissance aux ateliers de dessinateur.
Sans prendre en comptes les histoires muettes, les comics présentent un avantage pour leur diffusion ; ils sont de traduction facile. En s’appuyant sur cette opportunité, les syndicates sont allés toucher des lecteurs/acheteurs à travers le monde et se sont ainsi exportés (on trouve des traces plus que centenaires de ce média au Japon, en Argentine, en France)41.
La reprise de la bande dessinée par l’Europe
Sur le Vieux Continent, la publication des bandes dessinées n’est pas cantonnée au support de la presse. S’est en effet développée une littérature destinée à la jeunesse dans la suite des théories pédagogiques du XIXe siècle. Cependant, en intégrant ces lectures illustrées orientées vers le loisir, les publications pour jeunes se verront reprocher une perte de leur rôle pédagogique42. Malgré tout, la bande dessinée gagne de l’ampleur.
A partir de 1889, Le Petit Français illustré publie les récits humoristiques de la famille Fenouillard43. Famille de « bourgeois ridicules »44 qui part en voyage, dans l’état d’esprit du moment, c’est- à-dire celui de l’exposition universelle de Paris et l’apogée de la France coloniale. Cette concomitance entre le monde réel et celui développé dans les illustrés donne une popularité certaine à Léocadie, Agénor, Cunégonde et Artémise Fenouillard.
Il faut comprendre que cette popularité s’étend en fait aux récits illustrés qui se multiplieront à partir des années 1900. On relève en France la création de 62 titres de journaux entre 1904 et 1930 (dont 46 hebdomadaires) publiant des illustrés pour la jeunesse45. Certains héros donnent alors rendez-vous fréquemment à leurs lecteurs, et deviennent ainsi chefs de file des périodiques qui les publient.
Parmi les parutions de début de siècle, se trouve La semaine de Suzette « le journal des petites filles bien élevées » (1905). Elle diffuse les histoires d’Anaïk Labornez plus connue comme Bécassine46, dont le nom – qui laisse supposer une certaine naïveté – fait comprendre que se déroulent des histoires à caractère humoristique. Son auteur s’illustrera aussi en 1920 par la création du personnage de Frimousset.
Dans L’épatant, ce sont Les Pieds nickelés (par Louis Forton) qui s’exercent à partir de 1908 tandis que Fillette présente L’espiègle Lili (par Jo Valle, en 1909) et Le Petit Illustré Les aventures de Bibi Fricotin (encore par Louis Forton), en 1924.
Les titres sont, de plus, évocateurs quant au lectorat visé. On distingue les périodiques pour les jeunes garçons et ceux pour les petites filles. De même, une catégorisation s’opère selon les opinions et c’est ainsi que certaines parutions sont à rattacher à un milieu ou mouvement de pensée. Par exemple, Les petits bonshommes (1911) sont soutenus par les socialistes, et Bernadette (1914) par les catholiques.
Toujours au rang des publications, il convient de préciser que quelques-unes des histoires illustrées pour la jeunesse ne paraissaient pas dans la presse mais directement sous forme de livre. Elles sont certes minoritaires mais cela ne les a pas forcément empêché de survivre. Benjamin Rabier puis Jean de Brunhoff font naitre respectivement en 1923 puis 1929 le canard Gédeon et Babar l’éléphant.
Puis un autre héros animal traversera les âges : Alfred, le pingouin de Zig et Puce. Ceux-ci sont mis en scène par Alain de Saint Ogan à partir de 1925 et publié dans l’Excelsior-dimanche, selon la formule éprouvée aux États-Unis du supplément dominical. Zig et Puce est souvent reconnue comme la première BD française, bien que les Fenouillard soient plus anciens. Zig et Puce, eux, s’expriment dans des bulles, figure propre à la bande dessinée. Malgré cela, de Saint-Ogan ne se présentera pas comme auteur de BD. Cette considération n’interviendra que bien plus tard quand des auteurs comme Hergé et Greg reconnaitront l’admiration qu’ils avaient pour leur prédécesseur, décédé en 1974.
Par ailleurs, un autre usage de la BD développé outre -Atlantique apparait alors en Europe avec Alfred : la mercantilisation. Le pingouin Alfred devient le héros de publicités, produits dérivés (dont une peluche à succès)47 et Benjamin Rabier dessine la Vache qui rit. L’on voit alors ici une autre reconnaissance du média dans laquelle s’engage la BD dès les années 1920.
Un nouveau média parmi d’autres, les relations inter-médiatiques
Le passage du XIXe au XXe siècle est un tournant dans l’histoire de la bande dessinée qui affirme sa présence. C’est une époque qui voit aussi se mettre en place de nouveaux médias. Ceux-ci entretiendront un certain rapport avec la BD, toujours en lien avec l’image et son traitement. C’est un rapport composé d’influences réciproques, qui ont joué sur le développement de chacun.
Pendant cette période, une nouvelle sorte d’image apparait et se perfectionne : la photographie. Elle devient rapidement l’objet de nombreuses expérimentations pour des clichés toujours plus inédits (aériens, avec effets, grattage, montage etc.). Bien sûr, une telle nouveauté s’accompagne de théories et analyses – notamment philosophiques – sur la représentation de la réalité, et les opinions varient jusqu’à ce que la photographie devienne l’illustration standard de l’actualité dans la presse.
Ce constat a deux effets a priori insoupçonnés mais pourtant majeurs sur la considération des comics aux États-Unis. Le premier est esthétique. La photo s’accapare la représentation de la réalité, le dessin en devient plus libre, se dispense de son rôle de représentation de la vérité et donc s’autorise
à montrer de la fiction jusqu’à être associée aux images non réelles. Le second est social ; les dessinateurs « chassés » par les photographes se réfugient en nombre vers les illustrations émergeant alors, c’est-à-dire les comics, participant de la sorte à leur expansion.
Autre jeune média : le cinématographe. Faisant fi du fond du débat attribuant la paternité du septième art à Edison ou aux frères Lumières, il faut en retenir que dans la même dernière décennie du XIXe siècle se développent les images animées des deux côtés de l’Atlantique. Il convient de souligner le travail précurseur de l’Anglais Eadweard Muybridge qui a le premier décomposé un mouvement trop rapide pour l’œil humain afin d’afin d’en extraire en images l’instant pendant lequel un cheval au galop ne touche plus le sol. Ces études sur le mouvement et l’image ont rapproché la bande dessinée et les images animées. Le rapport entre BD et cinéma sera développé dans la deuxième partie (voir infra).
Enfin, une autre innovation technologique se met en place à cette époque : l’enregistrement du son. Ceci a profité bien sûr au cinéma mais on a pu voir dans la forme des pavillons de phonographes naissant en 1889 une inspiration probable pour le phylactère. Les deux partagent la même sémiologie de diffusion du son.
La BD a donc entretenu dès son origine des liens avec d’autres médias, qui furent sources ou repreneurs de succès. Cette complicité inter-médiatique peut aider à la reconnaissance artistique de la BD dans le sens où aujourd’hui l’expression « septième art » est parfaitement intégrée pour désigner le cinéma et que le huitième, malgré une impression de « fourre-tout », renvoie aux « arts médiatiques », soit la radiophonie et la photographie. La place de neuvième était donc à prendre à la suite.
L’annonce d’une future industrie
L’apparition d’une reconnaissance artistique a posteriori
La BD du XIXe siècle est celle de la découverte d’une nouvelle littérature intégrant le texte à l’image.
La BD du passage au XXe siècle est celle du développement par l’intégration dans les mœurs et la multiplication des titres.
La BD des années 1930 est celle qui sera la première admise comme un âge d’or, celui de la BD américaine. En effet, la critique des années 1950 et 1960 parlera à son propos de néoclassicisme, un terme déjà employé pour d’autres arts, quand on y voit la reprise de codes qui s’imposent comme références de la production artistique.
Les héros vivent de grandes histoires spectaculaires ; ils s’appellent Tarzan, Jungle Jim, Flash Gordon, Mandrake ou Red Ryder, apparaissent à partir de 1929 et évoluent dans des cadres variés tels que le Far-West ou la forêt sauvage, propices à l’aventure. On va alors mettre en avant les dessins produits et souligner des éléments relevant de l’art, tel qu’on l’entendait. Par exemple, la maitrise du clair-obscur de Milton Caniff (Terry, entre 1934 et 1946) fera école. À partir des années 1950, l’art contemporain s’inspirera de l’univers des comics, usant des mêmes procédés graphiques de lettrage ou cadrage par exemple (voir Infra).
Bien sûr, les auteurs d’avant-guerre ne savaient pas sur le moment que leur production serait vue comme une époque dorée. Cette considération intervenant au sortir du conflit mondial, on s’aperçoit qu’elle provient de critiques ayant profité de ces BD dans leur jeunesse. Une part de nostalgie joue dans leur opinion ; celle qui peut parfois amener une certaine subjectivité mais aussi qui pousse l’amateur – passionné – à se muer en professionnel.
La mise en place des écoles belges
L’année 1928 vient marquer le lancement de ce que Benoit Peeters appelle « le moment belge »48, soit l’époque (le milieu du XXe siècle) pendant laquelle la Belgique est la locomotive tirant toute la bande dessinée européenne.
Alors que la France s’était pourtant distinguée par la place laissée à la BD dans la culture littéraire avant la première guerre mondiale, Peeters relève que la Belgique est un « carrefour de langues et de culture, ne subissant pas le poids d’une longue tradition littéraire »49, c’est pourquoi elle « se révèle plus accueillante que la France à la BD »50. Illustration : dès les premières pages de leurs histoires, Tintin et Milou s’expriment par des phylactères. Cependant, leur auteur Hergé est obligé de lutter contre les périodiques français qui publient son héros en ajoutant sous les cases des explications de type légende, créant ainsi une inutile répétition du texte. L’éditeur Hachette utilisera le même procédé pour Félix le chat et Mickey, en blanchissant de surcroit l’espace de la bulle dans le dessin51. Ce qui déséquilibre la composition de l’illustration. Toutefois, l’Excelsior-Dimanche diffusait Zig et Puce de la même manière que les BD américaines dont il publiait aussi certaines séries : en conservant les phylactères52.
Alors qu’aux États- Unis – pays référence en la matière – la bulle est systématiquement présente, la France conservera régulièrement une narration sous le dessin et la Belgique, elle, suivra la mode américaine de suite. Les publications belges permettent de contrer une sorte d’opposition entre un vieux continent archaïsant et un nouveau monde symbole de modernité, s’offrant ainsi une certaine fraicheur.
1928 est l’année au cours de laquelle le jeune Hergé se voit confier la direction du Petit vingtième, supplément jeunesse du Vingtième siècle géré par l’abbé Wallez53. C’est là – notamment inspiré du trait d’Alain de Saint-Ogan – que Tintin apparait. Dans un premier temps naïvement, dans une atmosphère propagandiste, conservatrice et emplie de stéréotypes (Tintin au pays des soviets, au Congo, en Amérique) avant de s’affirmer et d’évoluer dans un cadre plus libre d’esprit et abouti grâce aux recherches de l’auteur (Le lotus bleu –1936).
Quelques années plus tard, une concurrence se développe face à la puissance du Petit vingtième. En Flandre tout d’abord par l’hebdomadaire Bravo à partir de 1936 puis en Wallonie en 1938 avec Le journal de Spirou.
La seconde guerre mondiale vient alors modifier de nombreuses données: Le petit vingtième disparait avec l’invasion de la Belgique ; Tintin passe au Soir sous contrôle allemand (mais gagne alors en diffusion) ; Bravo accueille l’auteur E.P Jacobs, est lancé en version française suite à la fermeture de la frontière avec les Pays-Bas et vit une période de gros tirage ; Spirou est publié jusqu’à son interdiction par l’administration allemande en septembre 1943 mais l’éditeur Dupuis réussit à diffuser tout de même ses principales séries par d’autres biais ; enfin, en anticipant pour le marché après la guerre, Casterman sort Tintin en couleurs et finit par recruter Jacobs pour la surcharge de travail que cela entraine. Hergé ne travaille alors plus seul et fondera en 1950 les Studios Hergé dont les collaborateurs se chargeront des décors ou accessoires des illustrations. À l’image de l’organisation des ateliers des peintres, le maitre Hergé se réserve le trait des personnages principaux. Toutefois, la Libération lui interdira de publier dans la presse pendant deux ans pour cause de collaboration54.
Justement, l’ambiance de la Libération va bénéficier à la bande dessinée. Non seulement des parutions arrêtées par la force des choses se relancent, mais de plus, de nombreux nouveaux titres voient le jour. On en dénombre vingt-deux pour l’année 194655 ! Bien sûr, tous ne dureront pas. C’est une époque qui voit arriver en Europe la culture américaine, ce qui participe à la résurrection du Journal de Mickey par exemple. A contrario et sans surprise, particulièrement en France, se développe une volonté de ne pas se laisser « avaler » par l’oncle Sam. Aussi, de nombreuses oppositions s’élèvent contre cette effervescence d’illustrés, au nom de la protection de la pureté de l’enfance, des valeurs morales et religieuses qui peuvent être perverties ; reprenant un combat parfois déjà mené en faveur des mêmes arguments avant la guerre. Cette lutte sera légalement soutenue en France par la loi du 16 juillet 1949 qui vient surveiller le contenu des publications destinées à la jeunesse. Certaines restrictions qu’elle impose de façon élargie en feront un « instrument de censure qui ne dit pas son nom »56. Bien que s’appliquant sur le territoire français, cette loi va avoir un impact sur la BD belge puisque les éditeurs devront s’adapter pour voir leurs produits adoptés par le marché français. C’est ainsi que le journal Tintin trouvera sa place dans l’Hexagone par une édition française.
L’apogée belge des années 1950
La Belgique a acquis dans les années 1940 une réputation reconnue de producteur de qualité de BD ; elle voit ses albums traduits et s’immisce dans les marchés des pays voisins. Cause et conséquence à la fois, les auteurs se déplacent et rejoignent le royaume belge (dont les Français Uderzo, Martin et Tibet – pères entre autres d’Astérix, Alix et Ric Hochet).
Des périodiques s’installent sur le marché. L’on peut citer Pat, Heroic albums, Bimbo, Petits Belges, Le Patriote illustré ou encore La Libre Junior ; mais ils sont finalement effacés par Tintin et Spirou.
Tous ces éléments viennent montrer la dynamisation que connait le monde de la BD dans les années d’après-guerre en Belgique.
Au sortir du conflit mondial, le héros Tintin ne disparait pas avec le Petit vingtième. L’éditeur Raymond Leblanc fait démarrer l’aventure du Journal Tintin, qui, comme son nom l’indique publie les aventures du héros d’Hergé. En 1946, après avoir fait obtenir à l’auteur un certificat de civisme et s’être assuré le soutien des éducateurs, notamment les directeurs d’établissements scolaires 57 (s’accordant ainsi le lectorat écolier, le plus important), Leblanc fait paraitre le numéro 1. Ce journal sortant le jeudi joue sur la notion de divertissement sérieux en publiant des aventures documentées. On y retrouve Blake et Mortimer, Alix , Michel Vaillant, Ric Hochet , Chevalier Ardent ou encore Corentin pour ne citer qu’eux. Dès les débuts, le périodique existe sous une deuxième version : Kuifje, en langue néerlandaise, pour gagner une ampleur nationale.
Du côté de l’opposition, la maison Dupuis de Marcinelle privilégie une autre ligne éditoriale ; celle de l’humour, de l’imagination, de la modernité et du dynamisme58. Le journal de Spirou accueille Lucky Luke, Johann et Pirlouit, Tif et Tondu , les Schtroumpfs et le célèbre Gaston Lagaffe, personnage pour qui son créateur Franquin avait un faible 59. Ce dernier fut aussi aux commandes de la série -titre Spirou et Fantasio pendant plus de deux décennies. L’aventure n’est toutefois pas en reste chez Dupuis avec les séries Jerry Spring, La patrouille des castors, Buck Danny et Marc Dacier.
L’émulation de Tintin et Spirou ; des approches différentes, le développement d’écoles
Dans la conscience collective, les politiques éditoriales des journaux Tintin et Spirou s’opposent (ou se complètent selon les points de vue). Tintin est le porte-drapeau de la BD sérieuse et réaliste alors que Spirou incarne un registre plus comique et fantaisie. Bien sûr, cette dichotomie est une caricature et il convient de la nuancer pour coller à la réalité.
Les deux journaux se distinguent par la philosophie de leur production, mais ils se démarquent parallèlement dans l’approche du dessin. À l’image d’autres arts graphiques, certains auteurs créent des styles et sont suivis par des « disciples ». Avec le recul, on parlera d’ « écoles ». La bande dessinée évolue ainsi suivant un schéma tel qu’il a déjà été vu au sein d’arts plus traditionnels.
C’est pourquoi l’on utilisera parfois l’expression « école de Bruxelles » (du lieu de localisation de la rédaction60) ou « école hergéenne », tant Georges Rémi61 est une locomotive pour toute la production du journal Tintin. En tant que directeur artistique à partir duquel Leblanc a créé l’hebdomadaire, il participe au recrutement des auteurs et dessinateurs voulant entrer dans la maison62 du Lombard63.
Hergé a développé un trait dont le succès fait apparaitre plus tard la qualification « ligne claire ». L’expression trouve son origine en 1977 lors de l’exposition « Tintin à Rotterdam ». Le dessinateur néerlandais Joost Swarte emploie la terminologie klare lijn pour qualifier le travail du père de Tintin64. Il s’agit d’un dessin visant la plus grande lisibilité dans la simplicité, c’est une approche graphique épurée – ce qui ne signifie toutefois pas que les autres styles sont incompréhensibles.
Les illustrations d’Hergé (puis de ses suiveurs) sont construites sur le même principe créatif. Un trait léger trace les contours et les formes, puis les couleurs sont posées en aplats uniformes à l’intérieur de ces espaces. Le volume et la profondeur sont donnés bien sûr par les règles de perspectives, mais aussi grâce aux ombres (en aplats noirs) et à des traits (secondaires) immiscés sur les aplats, tels que les plis de certains tissus ou les gouttes de pluie.
Cependant l’origine de la ligne claire est à chercher dans les inspirations d’Hergé, notamment chez les anciens. Alain de Saint-Ogan, Joseph Pinchon et Benjamin Rabier présentent des dessins dont l’efficace sobriété est vue de nouveau chez Tintin, Quick et Flupke ou Jo, Zette et Jocko. On la retrouve aussi chez Calvo qui fait vivre des personnages anthropomorphiques comme le faisait Rabier. Dans La bête est morte ! (1944), les animaux incarnent systématiquement les nationalités ; les anglais sont des chiens, les allemands des loups etc.
Le style « ligne claire » est donc plus ancien que Tintin. Cette clarté de dessin rend réalistes des personnages mis en forme par seulement quelques traits, ce qui participe à l’idée que Tintin est un journal qui sait rester sérieux malgré le divertissement qu’il représente.
Dès les années 1940, Hergé est aidé par des assistants. Naturellement, ceux-ci seront les plus fidèles suiveurs de la ligne claire. C’est dans ce style qu’E.P. Jacobs mettra en scène Blake et Mortimer. Cette série d’aventures historico-scientifiques pour laquelle il quitta Hergé, après que ce dernier avait refusé de lui faire cosigner Tintin, eu un succès qui vint concurrencer celui du maitre de Milou.
Bob de Moor prendra la place de premier assistant et restera un fidèle d’Hergé. Toutefois c’est dans ses ouvrages propres (le Lion de Flandre, 1950) que se voit l’influence du style hergéen. À ce propos, Franquin s’exprimait ainsi « ce phénomène [de la reprise] a existé dans tous les arts graphiques: il y a toujours eu des ateliers avec des élèves qui commencent par faire gentiment ce que leur patron leur demande, et qui, s’ils ont un talent, se révèlent et surpassent même leur maître… »65.
La ligne claire traverse les âges et inspire les dessinateurs. Une anecdote l’illustre. Jijé66se voit reprocher par Hergé de s’être un peu trop inspiré de Tintin pour un personnage, celui-ci lui répond par un triple dessin représentant la Bécassine de Pinchon, puis le même visage sans couvre -chef et enfin de nouveau le même, coiffé d’une simple houppette, laissant ainsi apparaitre… Tintin, preuve que le style n’appartient à personne. Hergé ne répondra pas (ill. 2).
On distingue classiquement trois phases dans la production de dessins : l’apprentissage technique, l’imitation des précédents et la révélation d’un style propre.
De nombreux dessinateurs se formeront au style de l’école de Bruxelles ou l’adapteront à leur trait dès les années 1950 : Jacques Martin pour Alix et Lefranc, Jean Graton pour Michel Vaillant, Paul Cuvelier pour Corentin, Willy Vandersteen pour Bob et Bobette, Tibet pour Ric Hochet et Chick Bill, François Craenhals pour Chevalier Ardent et Les 4 as. Si cela assure au périodique une certaine unité, il convient de faire attention à ne pas perdre les traits propres à chacun. Franquin exprimera cette idée en une phrase : « J’aime bien la ligne claire… mais celle d’Hergé ! »67.
Depuis la fin des années 1970, André Juillard s’affirme comme un héritier majeur de la ligne claire, ayant entre autres repris Blake et Mortimer et s’étant fait spécialiste de sagas historiques. Il a aussi dessiné Arno, épopée se déroulant à l’époque napoléonienne et scénarisée par Jacques Martin, qui se revendique le pionnier de la BD historique68. Cette relation vient d’une part démontrer la continuité des styles à travers les générations et d’autre part présenter la ligne claire comme idéale pour les BD aux dessins réalistes et qui veulent aussi l’être dans les scenarios.
Dans le même temps, à côté de Charleroi se développe l’ « école de Marcinelle », lieu du siège des éditions Dupuis et donc du Journal de Spirou . Le concurrent de Tintin présente aussi des aventures réalistes, particulièrement sous le trait de Jijé et se diversifie en mettant en avant un humour qui en fait sa marque de fabrique. Franquin devient alors l’auteur clé du périodique. Son Gaston Lagaffe évolue dans des histoires-gags tenant en une planche, et les aventures de Spirou se renouvèlent quand il en prend la charge par l’arrivée de personnages dont la présence facilite les scènes humoristiques tels que le Marsupilami, le comte de Champignac ou le maire.
Le dessin de Franquin est énergique, empli de mouvements, il montre une dynamisation qui devient caractéristique chez Dupuis. Les traits paraissent plus nerveux, plus bruts, au contraire du Journal Tintin dont on retient un dessin plus travaillé, calme. On retrouve ce dynamisme notamment chez Jean Roba (Boule et Bill), Tillieux (Gil Jourdan), Morris (Lucky Luke) ou encore Peyo (les Schtroumpfs).
Cependant, il ne faut pas considérer Tintin et Spirou comme des publications adversaires que tout oppose. Il est important de soulever l’existence de plusieurs points communs aux deux périodiques, encouragés par l’accord tacite passé par les deux éditeurs. Ce gentleman-agreement avait pour règle principale de ne pas essayer de débaucher un auteur au concurrent, afin de préserver les relations de travail propres à chaque rédaction.
En prenant du recul, on s’aperçoit que les héros centraux Tintin et Spirou vivent paradoxalement dans des schémas similaires, en dépit de toutes leurs différences. Ce sont des personnages relativement transparents et neutres (malgré leurs actions et décisions) ; et c’est grâce aux ensembles de personnages gravitant autour d’eux que se créent les émotions et le ressort comique des histoires. Tournesol est sourd et distrait, Champignac farfelu, mais leur science est appréciable ; les animaux Milou et Spip communiquent aux autres animaux et comprennent l’action autour d’eux ; le maire et les Dupond-t ont des expressions alambiquées ; Haddock et Fantasio provoquent par leurs agissements voire comportements une partie des rebondissements de l’histoire69…
Autre point commun aux deux écoles : l’utilisation des moyens graphiques propres à la BD donnant vie aux situations vécues par les personnages.
Il s’agit d’une part des onomatopées accompagnant les mouvements. On observe de grandes variations selon les auteurs qui les représentent, révélatrices du style qu’ils pratiquent : taille de l’onomatopée dans la case, multiplication à travers les pages, intégration dans les lignes figurant les mouvements etc. Alors qu’Hergé peut donner un coup de feu visuellement discret (ill. 3) –un sobre « pan » dans la fumée – Franquin sait couvrir une planche d’onomatopées, celles-ci participant au ressort comique (ill. 4). Son talent permettant de ne pas alourdir la lecture.
D’autre part, les dessinateurs se servent de différents signes pour rendre vivants les personnages couchés sur le papier. Les gouttes partant de la tête montrent la stupéfaction ou la surprise, les étoiles des chocs, les spirales l’étourdissement, des traits répétés expriment les tremblements et mouvements etc. D’autres symboles sont utilisés à l’intérieur des phylactères pour faire ressortir la colère ou l’énervement du personnage. On retrouve principalement Illustration 4: Franquin, Gaston Lagaffe des signes de ponctuation épaissis et de couleur vive, des griffonnages noirs, des éclats, des caractères d’alphabets étrangers (le lecteur ne sachant pas lire un idéogramme chinois, cela fait ressortir l’incompréhension de ce que dit le personnage qui éclate de colère).
Ces signes ont l’avantage de présenter clairement et sous une forme comique la pensée d’un personnage, mais aussi celui d’éviter l’emploi du langage familier ou d’expression d’adultes, ce qui laisse la BD accessible aux lecteurs de tous âges.
C’est notamment par l’emploi de ces moyens que se distinguent les styles de dessin. Ils sont sobres et discrets (mais pas moins efficaces) chez les adeptes de la ligne claire, et beaucoup plus volumineux et présents chez les dessinateurs de « gros nez » ; expression parfois employée pour désigner le style en arrondis, très présent chez Dupuis, illustré à merveille par le physique de l’agent 212. ( ill. 5 – où il croise Cédric, autre héros du journal de Spirou, aussi mis en forme par un trait rond).
Enfin, puisqu’ils sont contemporains, les deux périodiques sont influencés par leur époque en ce qui concerne la pédagogie. C’est un rôle primordial pour des publications destinées à la jeunesse, elles ne peuvent pas n’être qu’un divertissement. Ainsi, transparaissent à la fois une morale scoute et une tradition catholique qui se rejoignent et sont très présentes dans la Belgique du milieu du XXe siècle. Hergé s’est fait connaitre par ses illustrations dans un père jésuite en cas de doute sur le contenu d’un numéro de Spirou à publier71. Dans les deux maisons, l’on demandait à ses auteurs de s’autocensurer et ils connaissaient généralement ce qui pouvait passer ou non. De plus, Tintin comme Spirou ont publié des numéros spéciaux « Noël » ou « Pâques », exprimant de façon claire la pensée à laquelle ils adhéraient. C’était aussi l’affichage de cette morale qui permettait aux parents de faire confiance à l’éditeur et aux enfants de lire le journal ouvertement. Et par là même de l’acheter.
Une dernière remarque vient démontrer l’influence de la mentalité des années 1950 sur les parutions d’alors : il n’y a pas de femmes. Ce constat n’est pas limité à l’école belge ; mais cette dernière profite d’une telle domination sur l’Europe de la BD qu’elle se rapproche d’une situation de monopole.
Toutes les séries n’évoluent pas pour autant dans la même situation radicale que le village schtroumpf (unique touche féminine : la Schtroumpfette, qui apparait en 1967 – la série a démarré en 1958 – et qui est une création du sorcier Gargamel) mais les personnages féminins sont systématiquement secondaires ; limités aux rôles d’éternelle fiancée (telle Nadine dans Ric Hochet) ou de mère au foyer (Boule et Bill). Deux autres situations se distinguent ; les femmes dont la présence n’est que figuration (une hôtesse ici, une infirmière là) et le cas particulier de la Castafiore. Personnage récurrent de l’univers de Tintin, leur première rencontre remonte à 1939 ( Le sceptre d’Ottokar). Mais sa présence ne contrevient à aucune « norme » sociale. En tant qu’artiste de scène (cantatrice), elle est cantonnée à un rôle et ses nombreux voyages sont dus aux spectacles qu’elle donne. Son statut de star justifie sa vie mouvementée. Pour Hergé, elle est une « caricature »72, et selon lui la faible quantité de femme ne s’explique pas par misogynie mais parce qu’elles n’ont « rien à faire dans un monde comme celui de Tintin : c’est le règne de l’amitié virile »73 (et comme on peut s’y attendre, « elle n’a rien d’équivoque cette amitié »74).
Par une crainte absolue de la censure suite à de premiers commentaires négatifs, Jacobs ne mettra pas de femme en scène75 dans Blake et Mortimer. Au milieu du XXe siècle, la place de la femme est à la maison, pas en vadrouille pour vivre des aventures. Cette mentalité évoluera avec les arrivées des premières grandes héroïnes, adultes, Natacha et Yoko Tsuno, respectivement en 1965 et 1970.
La censure peut donc brider l’imagination de certains auteurs. Celui de Lucky Luke, Morris, résume comment : « En réalité, les problèmes de censure ont surtout commencé lorsque la censure française est apparue [par la loi du 16 juillet 1949, ndlr]. Celle-ci était particulièrement sévère à l’égard des bandes dessinées qui venaient de Belgique; c’était une forme de protectionnisme »76 . De fait, le marché français était trop intéressant pour que les journaux belges se permettent de le nier. L’adaptation était nécessaire et, par peur de voir ses journaux interdits « Dupuis a instauré une censure plus grande »77. Une anecdote de Morris en explique le fonctionnement : Quelquefois, par défi envers moi-même, je mettais des filles assez dévêtues dans les cadres qui ornaient mes saloons […] Cela faisait partie du côté parodique de la série, mais tout cela était invariablement gommé ou gouaché avant la publication… C’est pour cela qu’il y a tous ces cadres vides dans mes histoires du temps de chez Dupuis78.
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I – La BD comme phénomène littéraire historique
Prolégomènes historiques à l’apparition de la bande dessinée
Chapitre 1 – Le XIX e siècle, un contexte favorable à l’émergence de la bande dessinée
A- L’image comme outil pédagogique
B- L’apparition du strip dans la presse
C- La figure précurseur de Rodolphe Töpffer
D- Le « boom » des années 1890, les États-Unis s’emparent du phénomène
Chapitre 2 – La reprise de la bande dessinée par l’Europe
Un nouveau média parmi d’autres, les relations inter-médiatiques
Chapitre 3 – L’annonce d’une future industrie
A- L’apparition d’une reconnaissance artistique a posteriori
B- La mise en place des écoles belges
Chapitre 4 – L’apogée belge des années 1950
L’émulation de Tintin et Spirou ; des approches différentes, le développement d’écoles
Chapitre 5 – La modernisation des années 1960
PARTIE II – La BD en tant que neuvième art
Chapitre 1 – Le processus d’artification
La bande dessinée dans l’art, les relations inter-artistiques
Chapitre 2 – À l’époque de l’émergence de la bande dessinée
La figure de l’artiste multidisciplinaire
Chapitre 3 – Les Trente Glorieuses, une période faste
A- Le manifeste du « 9è art »
B- L’action initiatrice de la bédéphilie
1- La poussive reconnaissance de la presse artistique
2- La double quête de la professionnalisation et de la reconnaissance académique
C- La consécration institutionnelle
1- La légitimation par la création d’institutions dédiées
2- La légitimation par l’acceptation de l’institution muséale
D- La reprise de la BD par l’art
1- La nouvelle dimension : Lichtenstein
2- Une autre vision de la narration en image : la Figuration narrative
3- L’adoption de la BD par l’art contemporain de Keith Haring
Chapitre 4 – Le rayonnement contemporain de la bande dessinée
A- La quête de renouvellement, la fin du XX è siècle
B- L’illustration du « 9 e art », le cas du graphic nove l
C- L’exploration du champ créatif, à la recherche des limites graphiques
1- Les défis de l’Oubapo
2- La variation de concepts créatifs
D- Bande et ciné
1- Le recrutement de la BD par le cinéma
2- La BD comme source pour le cinéma
PARTIE III – La BD adoptée par les salles des ventes
Chapitre 1 – L’apparition d ’ un marché : la BD, un bien patrimonial
A- Patrimonialiser la bande dessinée
B- L’émergence d’une nouvelle profession : l’expert en bandes dessinées
C- Enchères et en hausse
D- L’évolution de l’auteur en artiste
Chapitre 2 – La confirmation d’un engouement
A- L’incroyable intensification des enchères de bandes dessinées
Un marché portant sur plusieurs supports
État des lieux du record
La maison de ventes Tajan
B- Mise en pratique, la vente du 12 mars 2016 chez Tajan
La préparation, du vendeur à l’exposition
La vacation, de la salle à l’acheteur
Chapitre 3 – Le marché aujourd’hui, un parallèle indéniable avec l’art contemporain
A- Une réalité économique double, plaisir et spéculation
Une échelle de prix élargie
B- La particularité des artistes encore vivants
C- D’aujourd’hui à demain
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES ILLUSTRATIONS
ANNEXE