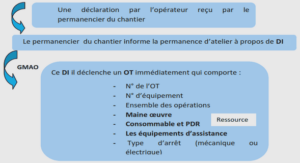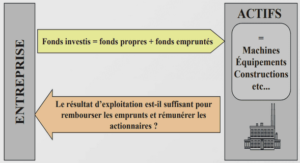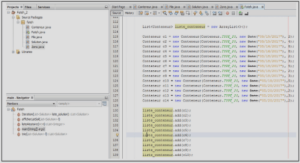Toute entreprise est animée d‟un dessein de la recherche d‟un haut rendement quantitatif. Lorsque ce but n‟est pas atteint, elle est confrontée à un échec. Le système éducatif, de son côté, en respectant toutes les spécificités, se dévoue pour mission de porter l‟enfant d‟un état de nature en un état secondaire de perfection relative, suivant l‟éthique du pays, suivant son idéal de vie. Et comme toute entreprise, il est régi par cette règle de dichotomie que la réussite et l‟échec. Pendant la première République, Madagascar était l‟un des rares pays en voie de développement du continent africain à avoir atteint un taux de scolarisation appréciable pour l‟enseignement. En outre son enseignement supérieur était reconnu par de nombreux pays voisins. Dix ans plus tard la qualité de l‟enseignement et de la formation s‟est gravement détériorée suite aux problèmes sans doute économiques et à un mauvais choix politique.
La commune urbaine de VAVATENINA
Situation géographique
La commune urbaine de Vavatenina est l‟une des dix communes dans le district de Vavatenina. Le district est localisé dans la région Analanjirofo, province de Toamasina, il a une superficie de 360 km². Il est limité au Nord par le district de Fénérive Est, au sud par Toamasina II, à l‟ouest le district d‟Amparafaravola et Ambatondrazaka, à l‟Est une partie du territoire du district de Fénérive Est et une partie de celle Toamasina II et Nord Ouest le district d‟Andilamena.
De la grande ville d‟Antananarivo, si on visite le chef de la commune Urbaine de Vavatenina, on doit emprunter trois routes nationales (RN) qui sont respectivement la RN2, reliant Antananarivo et Toamasina I avec une distance 360 km, cette route est goudronnée et en bon état. Ensuite on prend la RN5 reliant Toamasina et Fénérive Est distant de 100km toujours goudronnée en mauvais état. Mais avant d‟arriver à Fénérive-Est à 90 km de Toamasina, on passe par un village dénommé Antsikafoka où il y a une bifurcation sur RN5 vers Vavatenina. Et enfin la RN 22 qui relie Antsikafoka et Vavatenina avec une distance de 38Km. Cette route est goudronnée mais en mauvais état également .
Bref, Vavatenina est distant de 488 km de la capitale et les voies de communication sont en mauvais état et en goudronnées.
Population
▶ Situation démographique :
Vavatenina est une commune qui compte plus de 37 000 individus, avec une densité de 187,5 Habitants par km². La densité de la population dans les autres Fokontany se situe entre 40 à 120 habitants par km² et pour Vavatenina, elle compte à lui seule environ 10 000 habitants, soit une densité approximative de 900 habitants par km². La concentration de la population s‟observe dans les chefs-lieux de Fokontany situés dans la partie orientale et la partie centrale sud de la commune. Le tiers de la population est regroupé dans le chef-lieu de la commune. Peu de villages sont densément peuplés. En effet, seuls 25% des villages ou hameaux de la commune ont plus de 500 habitants. Sur le plan sociodémographique, la structure par sexe indique une légère domination des femmes (50,41%) par rapport aux hommes (49,59%). La population active (âgée de 18 à 60 ans) compte 13,647 habitants soit 40% de la population totale, plus de la moitié de lapopulation soit 53,23% sont âgées de 18 ans au plus indiquant une population jeune et une perspective d‟abondance de main d‟œuvre élevée .
Ethnies
Le peuplement de la commune urbaine de Vavatenina est relativement ancien. En effet, presque tous les villages de la commune ont été créés avant 1800. Les restes ont été créés durant le XXème siècle . L‟origine des communautés autochtones et des groupes ethniques est très diverse : Les Betsimisaraka forment la population d‟origine de la région dont la majorité venait des zones situées au Nord-Est de la commune (Fénérive Est, SonieranaIvongo) et dans l‟ouest (Ambatondrazaka). Quelques populations ont pour origines la région de Toamasina I et II . Ainsi, la population de la commune Rurale de Vavatenina est composée essentiellement de Betsimisaraka. Quelques migrants Merina, Betsileo, Sihanaka et Antandroy affluent depuis la colonisation et sont encore présents.
Les activités économiques de la population
Dans cette commune, l‟activité économique de la population est caractérisée par la domination de l‟agriculture (culture vivrière et culture de rente), suivre de l‟élevage, du commerce et de l‟artisanat. Par contre, on n‟a pas de l‟industrie pour le secteur de transformation sauf les petits métiers de fabrication de « toakagasy », «betsabetsa» et des essences de girofle au moyen de l‟alambic.
L’agriculture
On connait en premier lieu la culture du riz. En plus de la riziculture irriguée, les paysans pratiquent encore la riziculture pluviale (tavy).Car c‟était une habitude ancestrale et persiste jusqu‟à l‟heure actuelle, même s‟il n‟existe plus de forêts dans la commune. Le plus souvent, la famille défriche et incinère deux à trois hectares de savane et attendrait 30 sobika qui correspondrait 200 à 250 kg /ha. Or une personne mange trois fois par jour, cela veut dire qu‟on a consommé 12kg par mois de riz blanc . Mais la production est insuffisante pour le paysan .Ainsi pour faire face à cette insuffisance, les ménages modifient leurs consommations en réduisant la quantité consommée, d‟où la sous – alimentation .
Dans le cas de culture sur brûlis, le champ libéré après la récolte est utilisé une dernière fois pour la culture de manioc, du maïs, des haricots ou de patate douce. Et ce champ fini par être infertile ne se recouvre plus de végétaux qu‟après quatre ans ou plus. Les cultures de rente, caractéristiques de la région sont le poivre, la cannelle la vanille et surtout le café et le girofle. On connait le mois de récolte de population pour la pratique de ces filières par la suite de leur baisse de prix et par les méfais du dégât cyclonique, ceci est illustré par le renouvellement moins fréquent des cultures ravagées. Pour la cannelle c‟est son écorce qu‟on vend. Dans ce cas les paysans abattent l‟arbre pour décortiquer, le sous-produit (sous-produit des récoltes) les sert pour bois de chauffage. Dans la commune les fruits produits localement existent toujours tout au long de l‟année, mais ce sont leurs types qui varient selon la raison. Seules les bananes et les jaquiers persistent pendant toute l‟année. Parmi ces fruits on connait bien le letchi qui caractérise la région Est de Madagascar et la Commune Vavatenina est connue parmi les productrices de letchi dans la province de Toamasina. Dommage après sa maturité ces fruits ne persistent qu‟un mois ou un mois et demi donc c‟est une ressource financière temporaire pour les paysans. De plus, son prix s‟abaisse au cours de la campagne.
Quant à la culture maraîchère, le sol et le climat dans la commune sont favorables à cette catégorie de culture. Mais, lors de la période de pluie de novembre à mars, les habitants sont obligés d‟importer des légumes parce que leur terroirs sont souvent inondés. Pendant la saison pluvieuse du mois d‟avril à octobre, certains paysans pratiquent ce type de culture. Quand même, la production reste encore insuffisante. De ce fait, ils sont obligés d‟importer encore des légumes venant d‟autres régions administratives comme AlaotraMangoro, Analamanga.
INTRODUCTION GENERALE |