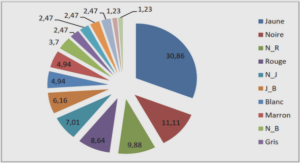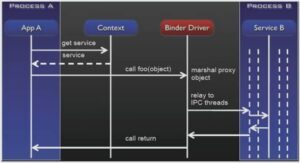Le Wolaita dans la nation éthiopienne
Le Wolaita au bord de la nation ?
En 1999-2000 dans le sud-ouest de l’Éthiopie, les habitants de la région du Wolaita se sont soulevés contre l’introduction d’une nouvelle langue administrative et scolaire, le WoGaGoDa, un « espéranto » créé à partir des quatre langues parlées dans la zone du Sämén Omo (Omo du nord). Nom quelque peu étrange, WoGaGoDa est l’acronyme de Wolaita, Gamo, Goffa et Dawäro. Cette réforme à la fois linguistique, scolaire et politique est survenue après six années d’utilisation de la langue wolaita dans l’administration et les écoles, dans le sillage de la nouvelle politique linguistique établie par la Constitution fédérale de 1994. Parti des principales villes du Wolaita, les premières à avoir reçu les manuels scolaires imprimés dans la nouvelle langue, le mouvement s’est répandu comme une traînée de poudre à travers le réseaux des écoles pour gagner la majeure partie de la population. Les pétitions adressées alors au gouvernement mettaient en avant le respect de la nouvelle Constitution qui garantissait à chaque « nation, nationalité et peuple d’Éthiopie » le droit de promouvoir sa culture. L’utilisation de leur langue dans l’administration et l’éducation était considérée par les pétitionnaires wolaita comme un point absolument essentiel de la concrétisation de ce droit. Ils expliquaient que l’introduction du WoGaGoDa allait à rebours de l’histoire, alors qu’ils avaient enfin obtenu, après un siècle d’oppression, la place qui leur était due au sein de l’espace national. Ils mettaient en avant la violence de la conquête, en 1894, de leur royaume par les armées de l’empereur éthiopien Menilek II (1891-1913), de même que l’oppression et la marginalisation vécues sous le régime de Haylä Sellasé (1930-1974). Leur statut n’avait été amélioré que très récemment : d’abord sous le régime militaire marxiste-léniniste du Därg6 (1974-1991), enfin sous le régime fédéral mis en place par le Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple Éthiopien. Les auteurs des pétitions précisaient que, en dépit de ces décennies d’oppression, les Wolaita avaient toujours servi l’Éthiopie : « De la campagne de l’empereur Menilek à aujourd’hui, le peuple wolaita a vécu en croyant pleinement à son identité éthiopienne et est resté ferme dans l’unité malgré le fait qu’il ait été 6 Le Därg, « comité » en amharique, était le nom du comité militaire qui a pris progressivement le pouvoir à la favieur de la révolution populaire qui a renversé, en 1974, le régime de Haylä-Sellasé. Il désigne, par extension, le gouvernenement militaire dirigé Mängestu Haylä-Maryam (1974-1991). 15 maintenu sous un régime d’oppression par ceux qui croyaient en la supériorité de l’Éthiopie [du nord]. La nationalité qui porte le nom de »Wolaita » est ancienne. […] Aujourd’hui, il se trouve en Éthiopie, dans différents secteurs d’activité, de très nombreux intellectuels et combattants [wolaita] qui tombent sur le champ de bataille7 ». Ils réaffirmaient ainsi leur appartenance à la nation, tout en rappelant que cette appartenance exigeait le respect de leur identité. En somme, en s’appuyant sur l’évolution de leur statut depuis l’intégration à l’Éthiopie en 1894 et sur l’affirmation d’une identité à la fois éthiopienne et wolaita, ils posaient la question des modalités de leur existence au sein de la nation. Ce sentiment de double appartenance s’est formée en 50 ans, entre l’accélération de la centralisation par Haylä Sellasé à partir 1941 et la chute du Därg en 1991. Toutefois, la conception linéaire – de la négation à la reconnaissance progressive de leur identité – présentée par les pétitionnaires (comme stratégie pour revendiquer le retrait du WoGaGoDa) cache une trajectoire plus complexe. Les relations entre le Wolaita et l’Éthiopie – son État central, son administration locale, sa culture dominante – ont été faites de convergences, de divergences, de négociations, de tâtonnements, d’hésitations. Il est difficile de voir se dessiner une vision d’ensemble tant l’hétérogénéité domine. D’abord parce qu’une « nationalité » n’est pas homogène, même si des élites nationalistes peuvent la présenter comme telle pour avancer des revendications. Elle a ses hiérarchies sociales, sa distribution du pouvoir, ses niveaux de richesses, ses classes sociales, ses religions, ses hommes, ses femmes ; c’est-à-dire des individus et des groupes plus ou moins proches du pouvoir, armés de capitaux politiques, culturels, sociaux et économiques inégaux, qui n’ont pas de ce fait les mêmes possibilités, aspirations et intérêts. Ensuite, car les politiques des différents gouvernements n’ont pas été univoques. Enfin, car la société du Wolaita a été travaillée en profondeur pendant 50 ans. Les hiérarchies sociales, les critères de distinction et les rapports de domination internes à la société locale se sont transformés sous l’effet de dynamiques et de contraintes venues de l’extérieur – nationales et internationales – et de leurs propres tensions. Ces transformations ont renouvelé les manières de se représenter la communauté politique nationale, d’être et d’agir en son sein.
Sur la nation et sa « modernité »
Le concept – ou plutôt l’idée protéiforme – de nation est au cœur de ce travail. Non pas pour écrire un « roman national » de plus qui aurait pour seule originalité d’utiliser l’école comme porte d’entrée ; mais parce que la nation a été l’objet de tensions incessantes, un défi pour les gouvernements qui se sont succédé depuis l’extension des frontières, à la fin du XIXe siècle, au-delà des hauts-plateaux. Ce processus a renforcé la diversité d’un royaume déjà hétérogène8 . Comment faire « tenir » cet ensemble ? Sur quelle matérialité et quel imaginaire appuyer son existence ? Sous Haylä Sellasé, être Éthiopien signifiait parler amharique, adopter la religion orthodoxe et se reconnaître dans les mythes de l’Éthiopie du nord. Le Därg a assoupli les critères culturels d’appartenance à la nation en affirmant vouloir mettre un terme à « l’oppression des nationalités ». Se revendiquant du marxisme-léninisme, il a redéfini la nation de manière égalitaire. La langue, la religion, la culture et la « nationalité » n’étaient plus, en théorie, des facteurs discriminants. La nation devait prendre corps dans les masses unies par la solidarité de classe et la lutte contre les ennemis intérieurs et extérieurs de la « mère-patrie révolutionnaire ». Les deux régimes ont utilisé deux stratégies différentes pour cimenter horizontalement la population et l’agréger verticalement à l’État. Tout en partageant un souci commun d’unité nationale, ils ont appuyé leur pouvoir sur des définitions distinctes de la nation. Dans ce mouvement, si la centralisation est allée croissante, le mode de domination politique, économique et culturelle du centre sur les périphéries a changé de nature. Les historiens qui ont tenté de théoriser la nation se sont heurtés au caractère évanescent du concept qui échappe à toute tentative de définition qui en épuiserait la signification. Comme le dit Eric Hobsbawm, « on n’a trouvé aucun critère satisfaisant qui permette de décider lesquelles des nombreuses collectivités humaines pourraient porter le titre de nation ». Il est impossible de donner une définition universelle, fondée sur des critères « objectifs » tels que la langue, le territoire commun, l’histoire commune ou les traits culturels10. En eux-mêmes « flous », « mouvants » et « ambigus »11, ces critères ne se recoupent jamais intégralement. À défaut de définition, il s’est donc agi d’élaborer des outils qui permettent l’interprétation. Les approches subjectives fondées sur les représentations sont apparues comme les plus opératoires. La plus célèbre, et la plus usitée, est celle proposée par Benedict Anderson : les nations sont des « communautés imaginées », « parce que même les membres de la plus petite des nations ne connaîtront jamais la plupart de leurs concitoyens […] bien que dans l’esprit de chacun vive l’image de leur communion12». Cette perspective invite à penser les nations comme des entités en perpétuelle construction. Comment les imaginaires nationaux se forment et se reproduisent-ils ? Devant être vivante dans les esprits des membres qui la compose, prendre corps dans les individus, la nation fait l’objet d’une pédagogie politique constante. Celle-ci peut provenir, dans le cas d’un groupe aspirant à son propre État, de l’action délibérée « de pionniers et de militants de l’idée nationale et par le début d’une campagne politique autour de cette idée13 ». Construire la nation est, par ailleurs, le fait des États déjà constitués qui œuvrent à ce que « l’unité politique et l’unité nationale se recouvrent14», c’est-à-dire à devenir des États-nations. C’est pourquoi les nationalistes et les États cherchent à fonder la nation sur des critères objectifs et/ou à l’affirmer comme une donnée primitive, à la fois a-temporelle (elle est naturelle) et ultratemporelle (elle existe depuis toujours). Une approche de la nation en terme de construction et de pédagogie politique implique, de plus, une histoire sociale consacrée à l’étude de « l’interpénétration du quotidien et du national comme [.] processus d’incorporation et [de] production d’un sentiment d’appartenance15». C’est ce que fait brillamment Benedict Anderson lorsqu’il analyse l’élaboration de l’imaginaire national à travers la littérature, la presse – dont la large diffusion est permise par ce qu’il nomme le « capitalisme de l’imprimé » –, les monuments et les musées.
L’école : imaginaire et matérialité de la nation
Si le milieu scolaire du Wolaita a été prompt à contester le WoGaGoDa, c’est parce que les élèves et les enseignants étaient parmi les premiers concernés par la réforme, mais aussi car l’école est un lieu de contact entre la société et l’État. Les acteurs scolaires se situent à l’articulation, au point de confluence entre des dynamiques locales, nationales, internationales – pour ne citer que trois niveaux des cercles concentriques dans lesquels l’activité sociale des individus et des groupes est insérée. L’éducation scolaire gouvernementale est un instrument emblématique des pratiques politiques et culturelles d’un gouvernement vis-à-vis de ses administrés, en même temps qu’un lieu de négociations où les aspirations symboliques et matérielles des gouvernants et des gouvernés, leurs interprétations respectives de ce qu’est et devrait être le monde social, se rencontrent, se confrontent, se transforment. L’école, en tant qu’instrument de légitimation du pouvoir et de normalisation qui s’applique à modeler des manières de penser et des façons d’être, est utilisée par l’État pour assurer la matérialisation de sa conception de la nation. D’abord, comme l’a souligné Pierre Bourdieu, « les institutions scolaires ont pour mission majeure de construire la nation comme population dotée des mêmes »catégories », donc du même sens commun». Ensuite, l’éducation scolaire impose des critères linguistiques, religieux et culturels qui attribuent une identité délimitée à la nation, à travers la langue (ou les langues) d’enseignement, l’histoire, la géographie, l’éducation civique et, de manière plus allusive, la littérature. Enfin, l’école veille à ce que les élèves deviennent de futurs gouvernés habitant « le temps de la nation » : elle enseigne un passé commun réorganisé ou inventé pour inscrire la communauté politique dans la longue durée ; en véhiculant le mythe du progrès, elle s’attache à inculquer l’idée d’une communauté de destin. Comme le résume Partha Chatterjee en s’appuyant sur Homi Bhabha : « dans le premier temps, le peuple est objet de pédagogie nationale parce qu’il est toujours dans une phase de fabrication, dans un processus de progrès historique qui reste à parachever pour que la nation réalise son destin ; dans le second, l’unité du peuple, son identification permanente à la nation, doivent être continuellement signifiées, répétées, performées 30». Unie, la nation doit être placée sur la voie du progrès, étiqueté sous les rubriques de « modernisation » et de « développement »31. En somme, le rôle de l’école est de créer un imaginaire national et, dans le même mouvement, de porter l’idée du progrès. Dans cette perspective, recevoir une éducation scolaire signifie à bien des égard avoir reçu le baptême de la modernité. L’école porte en elle la division binaire entre tradition et modernité et, dès lors, celle de la nation en deux parties, dont l’une est « moderne » et l’autre « à moderniser ». Moderne et traditionnel polarisent des discordances sur ce que doit être la nation en tant que communauté en devenir. Après avoir expliqué que la nation procède d’un acte d’imagination, Benedict Anderson ajoute « [qu’] au-delà des villages primordiaux où le face-à-face est de règle (et encore…), il n’est de communauté qu’imaginée32». L’histoire de l’éducation invite à retenir cette idée tout en lui apportant quelques remaniements ou, pour le moins, d’atténuer l’exclusivité accordée à l’imagination. Christine Chivallon a remarqué que, si Benedict Anderson démontre de manière remarquable que la création de l’imaginaire s’appuie sur une série de supports matériels – des livres, des journaux, des musées, des monuments etc. –, il n’inclut pas la matérialité de la nation à son élaboration théorique33. Or, s’intéresser au lien entre l’institution scolaire et la construction de la nation implique de ne pas dissocier imaginaire et matérialité. L’école est un instrument de façonnement de l’imaginaire à travers l’histoire, les mythes, les savoirs enseignés en général. Elle est, aussi, doté d’une forte matérialité à travers ses livres, ses classes, son enceinte close, ses heures d’entrée et de sortie34. Elle exerce une action pédagogique et des contraintes – bien loin d’être imaginaires – sur les esprits et les corps des élèves. Ses bâtiments, inscrits dans le paysage, marquent la présence physique de l’État et de la nation en des points dispersés du territoire administré. Enfin, si le sentiment d’appartenance commune repose sur l’imagination, l’entrée dans la nation n’est pas un acte purement imaginaire, situé dans les nuées de l’univers discursif. Pour les Wolaita dominés, elle signifie, très concrètement, une émancipation de rapports de production fondés sur l’exploitation et un affranchissement de relations de pouvoir oppressives. Le rapport à la nation et à l’école s’inscrit profondément dans la réalité sociale concrète, psychologiquement et physiquement vécue, des rapports de pouvoir. « Réel » et imaginaire ne sont pas dissociables.
Remerciements |