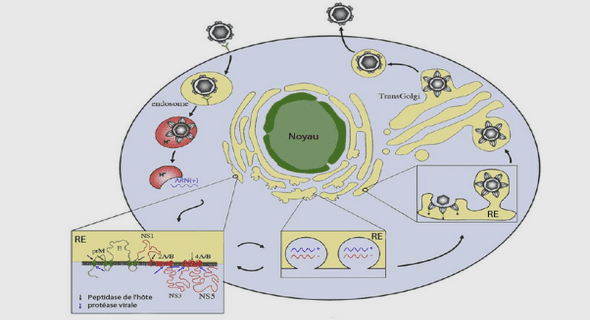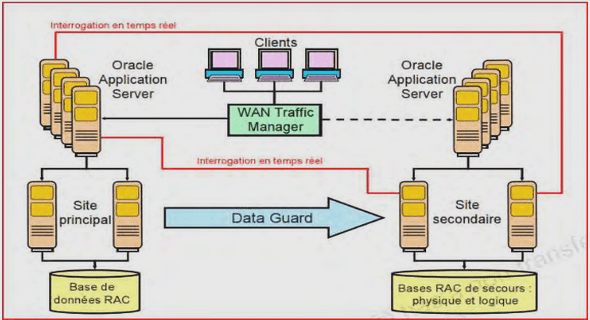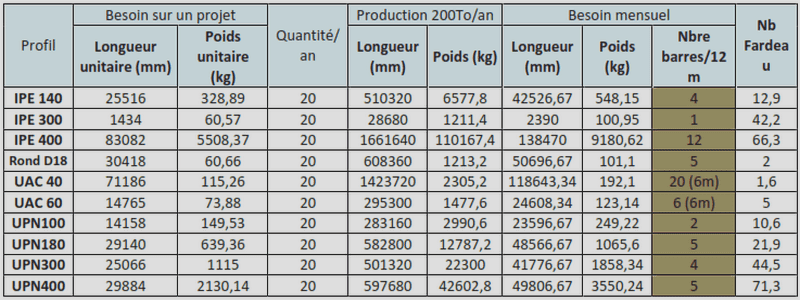Baisse de la natalité et de la fécondité
La natalité en Russie commence à décroître à partir les années 1920 alors que le pays entre dans une période d’industrialisation et d’urbanisation accélérée (Vichnevski 2009, p.7). Dans les années 1960, l’indice conjoncturel de fécondité (le nombre moyen d’enfants par femme) chute brutalement en passant pour la première fois en dessous du seuil de remplacement des générations : entre 1961 et 1968, il passe de 2,6 à 1,9 enfant par femme (Avdeev & Monnier 1994, p.865). Cette baisse se poursuit progressivement dans les années 1970, puis s’inverse pendant une brève période (entre 1980 et 1985) pour chuter à nouveau à la fin des années 1980. C’est après l’effondrement de l’URSS que cette tendance s’aggrave. En 1992, le taux brut de natalité est un des plus faibles jamais observés en Russie (10,8 pour ‰) (Monnier & De Guibert-Lantoine 1993, p.1051). L’indice conjoncturel de fécondité (le nombre moyen d’enfants par femme) atteint son point le plus bas en 1999 (1,2 naissances par femme) et reste jusqu’à aujourd’hui en dessous du seuil de remplacement des générations :
La chute spectaculaire de la natalité dans les années 1990 est imputée à deux phénomènes propres à la Russie : 1) une diminution du nombre de femmes en âge de procréer (20-29 ans) après la faible natalité enregistrée dans la deuxième moitié des années 1960 (Monnier & De Guibert-Lantoine 1993, p.1051) ; et 2) des mesures natalistes adoptées en 1984 incitant les couples à avoir des enfants plus rapidement, réduisant ainsi l’intervalle entre les naissances sans changer la descendance finale (Monnier & De Guibert-Lantoine 1993, p.1052, Zakharov & Ivanova 1997, p.74).
Toutefois, Vichnevski (2006, p.149, 2008, p.22) et Zakharov & Ivanova (1996, p.27) montrent que cette baisse de la fécondité en tendance est principalement le résultat d’un long processus propre aux pays développés. En effet, les mêmes tendances sont observées dans la majorité des pays d’Europe : l’indice conjoncturel de fécondité y baisse de façon similaire tout au long du XXème siècle :
Selon Karatchourina 2007 (citant un « Rapport mondial des Nations Unies », 2000), la Russie ne se distingue que par une accélération du processus due à la crise économique des années 1990, qui se traduit par la chute radicale du niveau de vie et l’appauvrissement général de la population (Lefèvre 2003a, p.85, Kortchagina et al. 2005, p.219). Kharkova & Andreïev (2000, p.230), arguent que, en l’absence de crise économique, la natalité aurait fini par baisser 10 à 15 ans plus tard.
Même si l’indice conjoncturel de fécondité passe de 1,3 à 1,8 enfant par femme entre 2005 et 2016 (voir 58), il baisse à nouveau en 2018 en passant à 1,6 enfant par femme (Rosstat 2019). La même année, la fécondité assure le remplacement des générations dans seulement six régions de Russie (60) : Tchétchénie (2,6 enfants par femme), Altaï (2,4 enfants par femme), Touva (2,9 enfants par femme), Bouriatie (2,1 enfants par femme), Tchoukotka (2,1 enfants par femme) et Nénétsie (2,2 enfants par femme) : Source des données : Rosstat 2019, www.gks.ru, consulté le 20.08.2019. Réalisation : S. Russkikh.
Pour résumer, la faible fécondité russe suit un processus que l’on retrouve dans la majorité des pays européens. Toutefois, elle se distingue en ce qu’elle s’accélère sous l’effet de la crise économique des années 1990 et s’accompagne d’une mortalité élevée, particulièrement chez les hommes d’âge actif.
Hausse de la mortalité
Le deuxième facteur de la crise démographique en Russie est sa mortalité élevée. Alors qu’après la guerre le pays connaît une augmentation considérable de son espérance de vie, qui passe de 42 ans à 68 ans entre 1926 et 1961 (Rosstat, 2018), notamment grâce à l’introduction des antibiotiques et de la vaccination à grande échelle (Shkolnikov et al. 1995, p.909), on observe un ralentissement dans le milieu des années 1960 dû à un investissement moindre de l’État dans la baisse générale de la mortalité (Vichnevski 2009, p.11)38. La Russie entre alors dans une crise sanitaire (Raison, 1998, p.207) : l’espérance de vie commence à baisser progressivement, à l’exception de quelques hausses temporaires sous les gouvernances de Gorbatchev et d’Eltsine (Lefèvre & Blum 2006, p.2, Shkolnikov et al. 2014, p.6).
Cette tendance s’aggrave dans les années 1990, principalement au sein de la population masculine. Entre 1990 et 1994, l’espérance de vie des hommes passe de 63 ans à 58 ans alors qu’elle passe de 74 ans à 72 ans chez les femmes (61). L’écart entre les hommes et les femmes se creuse donc pour atteindre près de 14 ans en 1994 et reste encore important aujourd’hui (près de 10 ans pour l’année 2017) :
À partir de l’année 2005, l’espérance de vie remonte progressivement et passe à 67,8 ans pour les hommes et 77,8 ans pour les femmes en 2018 (61). Elle reste pourtant faible par rapport à plupart des pays du Nord. Comme le montre le tableau (62), l’espérance de vie augmente progressivement entre 1965 et 2015 dans la plupart des pays en Europe, au Japon et aux États-Unis. La Russie se distingue par une augmentation très faible. Entre 1965 et 2015, les femmes gagnent environ 3 ans et les hommes seulement 2 ans (voir la troisième colonne).
Le recul de l’espérance de vie en Russie est intimement lié à la hausse de la mortalité chez les hommes en âge actif (Raison 1998, p.2012, citant Meslé & Shkolnikov 1995). En 1995, les hommes meurent 4,5 fois plus souvent que les femmes de maladies infectieuses et parasitaires, 2,4 fois plus souvent de maladies respiratoires, et 4 fois plus souvent de causes extérieures (Rosstat, 2019).
Cette surmortalité masculine s’explique avant tout par l’alcoolisme direct (intoxications et empoisonnements à l’alcool frelaté)39, l’alcoolisme indirect (maladies liées à la surconsommation de l’alcool), et à des causes extérieures (homicides, accidents de travail, accidents de la route, suicides et violences domestiques) (Nemtsov 2004, Vichnevski 2009, p.14-15, Rochtchina 2012, p.240, Radvanyi et al. 2016, p.41, entre autres).
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la consommation d’alcool pur au-delà de 8 litres par an représente un danger pour la santé et la vie humaine (Rochtchina 2012, p.238). En 2016, la consommation d’alcool pur par la population âgée de 15 et plus en Russie est d’environ 18 litres pour les hommes et 5 litres pour les femmes (« Rapport de l’Organisation mondiale de la santé » 2018 p.285). Selon Nemtsov (2004, p.143-144), 67% des décès dus à une cirrhose du foie, 60% de ceux dus à une pancréatite, et 23% de ceux dus à des maladies cardiovasculaires sont liés à l’alcool. L’auteur montre par ailleurs que 72% des homicides et 42% des suicides sont également le résultat d’une consommation excessive d’alcool. Par conséquent, l’alcoolisme est un facteur majeur de la mortalité en Russie.
En résumé, la mortalité élevée s’ajoute à la faible natalité comme principal facteur de la crise démographique en Russie. Cette mortalité est en lien avec les faibles dépenses publiques, la consommation excessive d’alcool et les maladies cardio-vasculaires. Je montre maintenant que l’immigration compense en partie les pertes démographiques, mais ne permet pas de renverser le processus de dépopulation.
La crise démographique et l’immigration
Après la chute de l’Union soviétique, la Russie devient un pays d’immigration et accueille un flux important de plus de 10 millions de personnes sur son sol entre 1991 et 2003 (Zajonckovskaja & Visnevskaja 1995, p.82, Laruelle 2006, p.3, Peyrouse 2007, p.47). De 1991 à nos jours, le solde migratoire (c’est-à-dire la différence entre le nombre d’immigrants et le nombre d’émigrants) reste positif (63). Cette stabilité relative atténue la baisse de la population en compensant environ un tiers des pertes démographiques dans le creux de la crise, entre 1993 et 2006 (Messiaen 2016, p.27).