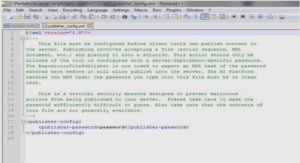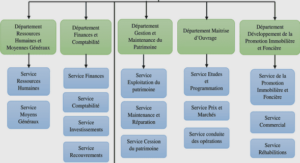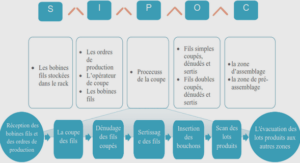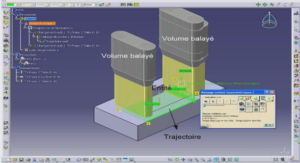Le timbre, objet et fonction
Emergence du timbre dans la musique du XXe siècle
Depuis la fin du XIXe siècle, l’emploi de plus en plus fréquent des percussions permet à la fois de retrouver ce côté « primitif » (au sens d’un rapport immédiat entre un geste et le son qui en résulte) de la production sonore, et de se familiariser avec de nouveaux timbres pour lesquels la notion de hauteur, élément jusqu’alors central dans la musique occidentale, n’est plus nécessairement pertinente. C’est l’occasion de prendre conscience que la mise en vibration d’un instrument produit d’abord un effet acoustique qui s’adresse à la perception, et qui avant le XXe siècle dépasse toute organisation formelle du matériau musical. Un second apport, dans les années 20, viendra des premiers instruments électroniques tels que le Thérémine ou l’Onde Martenot. Ces inventions, qui offrent la possibilité de produire un « continuum de hauteurs », ont une incidence profonde sur les compositeurs. Plus que renouveler l’effectif orchestral, elles introduisent des timbres « inouïs », jamais entendus jusqu’alors, profilant ainsi une nouvelle dimension dans l’imaginaire sonore. Enfin, sous l’impulsion de certains compositeurs comme Strauss, Bartók ou Varèse1 , les instrumentistes eux-mêmes affichent peu à peu un goût pour l’exploration du vocabulaire acoustique de leurs instruments, et le langage musical va progressivement s’étoffer avec les pratiques nouvelles que constituent les modes de jeu2 . Aujourd’hui, les pizzicati Bartók, jeux d’archets battuto, sul ponticello, sul tasto ou encore col legno tratto, le slap, le growl, le souffle aéolien ou encore les doigtés microtoniques font partie intégrante du discours musical contemporain. Tandis qu’est redécouvert le « son réel » des instruments se dévoile donc progressivement un éventail de sonorités nouvelles, reléguant au second plan l’organisation traditionnelle des hauteurs. Les instruments produisent des sons et le rôle du compositeur consiste à les combiner, telle est l’image de la nouvelle pensée musicale qui s’instaure au début du XXe siècle
Paradoxes et polysémies
Qui tente de formuler une définition juste du timbre se heurte immanquablement à un certain nombre de difficultés, tant l’usage systématique du mot a fini, en multipliant les significations, par le vider de sa substance. Pour preuve la définition négative du timbre qu’on rencontre habituellement : « ce qui n’est ni hauteur, ni durée, ni intensité ». L’American Standard Association le définit en 1960 comme « ce par quoi on peut distinguer deux sons de même hauteur et même intensité ». Le timbre serait donc une propriété intrinsèque à l’instrument, interviendrait dans des tâches de différenciation (voire de catégorisation ou de reconnaissance), mais ne serait pas exprimable positivement pour autant. Quoique regrettable, ce point de vue n’est pas blâmable. N’oublions pas qu’à l’origine, le timbre désignait la corde en boyau mise en double au-dessous de la caisse d’un tambour pour mieux le faire résonner, à l’instar du treillis métallique aujourd’hui fixé sous les caisses claires. Dès le départ, le timbre est donc quelque chose de fixé, d’indissociable de l’instrument, et qui lui donne une « couleur » particulière. Avant le XXe siècle, il n’y a pas, rappelle Hugues Dufourt, d’autre science acoustique que celle des hauteurs ; aussi n’est-il guère étonnant qu’à l’époque, « le timbre [ne soit] pas [encore] une fonction du langage [musical], il n’est qu’une matérialité obligée du processus producteur de la vibration sonore. [. . .] En l’absence d’un rôle fonctionnel musical explicite [. . .] il est tout naturel que le concept de timbre tende à renvoyer [. . .] à la cause productrice du son : l’instrument. » (Claude Cadoz, Timbre et causalité, in [Bar85]). Il semble que ce soit ce lien primitif6 à l’instrument qui soit à l’origine de la définition négative du timbre, témoin muet du lien entre le son et sa cause qui se dérobe de l’intérieur aux catégories abstraites et organisables de hauteur, de durée, d’intensité. A l’inverse, on trouve dans l’Harmonielehre de Schoenberg [Sch11] les propos suivants : « Je ne peux accepter sans réserve la distinction entre couleur sonore et hauteur, telle qu’on l’exprime habituellement. Je pense que la hauteur devient perceptible grâce à la couleur sonore dont une des dimensions est la hauteur. La couleur sonore est donc la catégorie principale, la hauteur, une subdivision. La hauteur n’est pas autre chose que la couleur sonore mesurée selon une direction7 . » L’opposition entre ce point de vue et la définition négative du timbre qui précède illustre la difficulté pour la pensée musicale au début du XXe siècle de qualifier le timbre avec le vocabulaire dont elle dispose. Pour certains, le timbre est le « secret ineffable » de l’instrument alors que pour d’autres, c’est une totalité brute dont procède tout objet sonore. Tantôt reste hors-langage, une fois le sonore épuisé par le vocabulaire musical, tantôt objet supra-langagier, total, qui transcende les catégories de la pensée musicale traditionnelle, le timbre est simultanément en exclusion interne et externe par rapport au langage : il ne se donne aux mots que par passage à la limite.
Le timbre comme langage
S’il est courant de rencontrer le terme de « langage musical », qu’entend-on exactement par là ? Sans entrer dans un débat de linguiste ou de sémiologue de la musique, nous nous contenterons de constater un certain nombre de points communs entre musique et langage. Tous deux se déroulent dans le temps, communiquent par le canal auditif et sont constitués d’entités élémentaires transcriptibles dont la notation renvoie à des phénomènes sonores identifiés et reproductibles. Ainsi hauteurs, durées, intensités, articulations, accents sont des éléments du langage musical. En est-il de même du timbre ? Oui, écrit Erickson [Eri75] : « De même que les unités élémentaires du discours sont les phonèmes, de même les timbres constituent les unités élémentaires du discours musical. » Il est une condition nécessaire au langage : c’est la circulation, la mobilité de ces éléments, et cette fluidité requiert une certaine neutralité des phonèmes. Un son ne peut fonctionner comme phonème que déchargé de toute signification a priori. En d’autres termes, la fonction de « consistance » du timbre doit être brisée, le timbre ne pouvant faire langage tant qu’il renvoie de manière univoque à l’instrument qui le produit. « La standardisation [des instruments] a appauvri, dans un certain sens, la famille des timbres, mais elle leur a permis de communiquer entre eux. [. . .] Cette transformation va se refléter dans le timbre, qui ne sera plus considéré comme un principe de l’identification mais comme un principe de transition, sinon de confusion. [. . .] On convient de dire que l’orchestre moderne est né avec le XIXe siècle ; il est né, en effet, de cet emploi mobile de l’instrument. [. . .] Le rôle [des instruments] va évoluer de l’identifiable au méconnaissable à cause de la brièveté des mélanges. [. . .] L’instrument est recherché pour ses possibilités de fusion, de neutralité, de perte d’une identité excessive qui, 8La rupture de ce principe est tardive. Elle n’advient qu’au début du XXe siècle avec la nouvelle école de Vienne et la « Klangfarbenmelodie ». 2.4. FONCTIONS DU TIMBRE : CONTRASTE ET CONTINUITÉ 33 évidemment, empêcherait les phénomènes de fusion. A partir de Schoenberg, en particulier, l’instrument sera de plus en plus considéré comme partie d’une texture [. . .] à saisir chaque fois dans un contexte différent. » (Pierre Boulez, Le timbre et l’écriture, le timbre et le langage, in [Bar85]) On retrouve là les deux fonctions du timbre mentionnées au paragraphe 2.2 : dissociation et unification. C’est par ce double mouvement permanent que le langage produit des signifiants et les agrège en de nouvelles significations. De même le « forçage » du tempérament aurat-il permis, en séparant le ton de l’instrument qui le jouait, l’éclosion du langage tonal, de même le « retour au réel sonore » de l’instrument n’était-il que le premier pas vers un langage possible pour le timbre. Quant à s’entendre sur le choix, sans même parler d’une notation, d’un vocabulaire, c’est là un autre débat qui sera discuté en 7.1.1.
Fonctions du timbre : contraste et continuité
Depuis Berlioz, le timbre entre dans le langage musical, s’organisant en un ordre complexe qui s’érige au dessus du système instrumental. Le définir comme un ensemble de sonorités à disposition du compositeur ou comme le produit d’un mélange est une chose, tenter de cerner sa fonction dans le processus de composition en est une autre. Jean-Claude Risset [Ris86] ouvre la voie : « La notion de timbre implique la fusion, elle correspond à la qualité sonore d’un ensemble de composantes intégrées en une entité auditive et assignées à une même source sonore réelle ou virtuelle. » Le concept de timbre serait donc corrélatif de celui de fusion instrumentale, phénomène sonore perçu comme un tout, unique et cohérent. Cet agrégat sonore n’est pas nécessairement statique, il peut évoluer dans le temps. Le timbre comme langage transpose le concept de « consistance subjective » de l’instrument, vers la mixture. « La notion de cohérence du comportement ne se limite pas nécessairement à la source du son ; elle peut, en effet, s’appliquer à des groupes de sons, comme les accords ou les complexes de timbres, où plusieurs sources forment une image musicale unique. » (Stephen McAdmas et Kaija Saariaho, Qualités et fonction du timbre musical, in [Bar85]). C’est une des fonctions remplies, en orchestration, par les doublures. Est-ce là tout ? Le timbre comme langage n’a-t-il d’autre fonction dans l’écriture que d’organiser la fusion instrumentale, que d’agencer les phonèmes pour produire de nouveaux objets sonores ? Ce serait oublier la fonction autogénérative du langage, lequel ne se contente pas d’agencer les signifiants, mais en produit également de nouveaux. Varèse, parlant de ses procédés de composition, utilise les termes de « masses sonores », « interactions », « projections », « pénétrations », « opacités », « raréfactions », « oxygénations ». . . tout un monde de mouvements, d’agitations dont la fusion instrumentale n’est qu’un état parmi d’autres. Aussitôt le timbre hybride formé, pourquoi ne pas le fragmenter en sous-ensembles, le faire s’entrechoquer avec une autre masse, ou encore l’incorporer dans une mixture plus vaste ? Voyons Erickson [Eri75] : « Varèse ne travaille pas seulement avec des timbres fusionnés, mais avec l’intervalle complet de la séparation à la fusion, et le mouvement entre ces états est fondamental dans son art. » De même que le langage se constitue sur le couplage des fonctions dissociante et unifiante, de même Erickson en vient à identifier les deux fonctions du timbre dans le processus compositionnel : contraste et continuité. « Tous les exemples que j’ai commentés peuvent être analysés en termes de contraste et continuité de timbre. Ces deux fonctions de timbre ne peuvent jamais être tout à fait dissociées, bien qu’il y ait des situations musicales dans lesquelles le timbre agit davantage comme porteuse (cf. 2.2) et d’autres pour lesquel l’intérêt réside dans les agrégats de timbres. » Continuité et contraste, vision duale, temporelle de l’opposition boulézienne entre « articulation et fusion [. . .,] les deux pôles extrêmes de l’emploi du timbre dans le monde instrumental. » (Pierre Boulez, Le timbre et l’écriture, le timbre et le langage, in [Bar85]) .