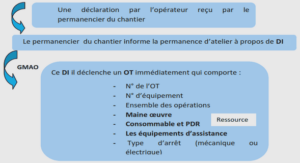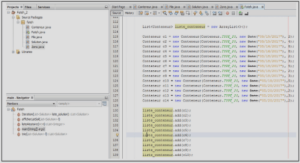Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Réalité insaisissable
Plongé dans le « Swinging London », nous avons pourtant l’impression d’être en même temps dans un univers bien particulier. Comme le remarque Cesare Garboli, Londres semble être un « protagoniste masqué en gros plan ». Il écrit : [Antonioni] choisit son habitat, il élit le domicile de ses récits […], et, comme les fins limiers, il se laisse posséder, il se plonge dans une atmosphère, s’en imprègne, il en flaire les variations imperceptibles […]. Puis, quand tout est prêt, quand il pourrait nous offrir un documentaire sans bavures sur son habitat et sur son milieu, […], alors il gomme tout ; il altère, il invente, il démantèle.44
Charles Thomas Samuels fait encore remarquer : « Dans la perspective néo-naturaliste, Blow up choque parce qu’il manipule les éléments du Londres contemporain, pour exprimer non pas la ville mais la version qu’a Antonioni de la vie moderne »45. On peut lire aussi que la vie quotidienne est rendue sous la forme « d’une mascarade fantasmagorique »46.
Comme nous l’avons déjà évoqué, Antonioni lui-même soulignait que son principal souci n’était pas de faire un film sur Londres. Blow up est avant tout l’histoire d’un photographe qui croit prendre en photo l’idylle d’un couple dans un parc mais qui s’aperçoit qu’il s’agissait en fait d’un meurtre. En essayant de mieux voir et en agrandissant les clichés, la forme qu’il croit être celle d’un cadavre se perd et devient abstraite. Antonioni dit à propos de Blow up : Je ne sais pas comment est la réalité. La réalité nous échappe, elle ment continuellement. Lorsque nous pensons l’avoir saisie, elle est déjà différente. Je me méfie toujours de ce que je vois, de ce qu’une image nous montre, parce que j’imagine ce qu’il y a au-delà, et nous ne savons pas ce qu’il y a derrière une image. Le photographe de Blow up, qui n’est pas un philosophe, veut aller voir de plus près, mais, lorsqu’il l’agrandit, l’objet lui-même se décompose et disparaît. Il y a donc un moment au cours duquel l’on saisit la réalité, mais le moment d’après, elle nous a déjà échappé. Voilà, un peu, quel est le sens de Blow up »47.
Cette citation contient plusieurs idées : d’une part que la réalité nous reste insaisissable, d’autre part qu’il faut se méfier de l’image et de son rapport à la réalité. Mais il y a aussi l’idée d’une recherche, l’idée d’aller voir derrière les choses. Nous retrouvons ce désir de recherche dans son expérience picturale sur les Montagnes Magiques. Parti d’un portrait qu’il avait déchiré, le cinéaste avait recollé les morceaux donnant naissance à une montagne. « Et comme j’ai toujours envie de voir la face cachée de ce qu’on voit à l’œil nu, raconte le cinéaste, j’ai décidé de le photographier et de l’agrandir, avec un procédé qui rappelle celui que j’ai utilisé dans Blow up. L’agrandissement photographique modifie certains effets, certains rapports ».
Pour nous faire éprouver le caractère insaisissable de la réalité, Antonioni nous transforme en funambule. La réalité pourrait être comme un fil ténu et mouvant sur lequel nous vacillons sans cesse, entre réel et irréel, où l’équilibre parfait, la présence tangible du réel sous nos pas ne dure qu’une fraction de seconde. Il y a à la fois dans Blow up un caractère impalpable, improbable par une insistance sur la présence de l’image et par un sentiment de suspension, et, en même temps, par moment, un aspect profondément réaliste.
Dans la réflexion du cinéaste sur la saisie de la réalité, la question de l’image est primordiale. Pour Antonioni, l’image reste limitée et peut être trompeuse par rapport à la réalité.
Dans Blow up, le cinéaste insiste sur la fabrication de l’image. Dès le générique, nous sommes dans un monde qui engendre sans cesse des images : le monde de la mode. Le héros, Thomas, est un photographe professionnel, donc un « faiseur » d’images. Antonioni a apporté une grande attention à son travail et à son matériel. Les multiples appareils, objectifs, trépieds, fonds, sa façon de « mitrailler » très vite, sur le vif Veruschka ou le couple dans le parc afin d’amasser un maximum de matériau. Lors de la séquence des agrandissements, le cinéaste filme minutieusement toutes les étapes du développement. Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’une grande majorité du temps du film se passe dans le studio de Thomas, endroit de construction de l’image. Cette grande précision sur le travail du photographe s’inscrit dans la réflexion plus vaste sur la saisie de la réalité. Cette attention sur le processus met en évidence toutes les transformations entre la prise de la photographie sur le vif et le résultat, l’image. Elle révèle la grande distance entre la photographie toujours qualifiée de reproduction objective et instantanée de la réalité et toute l’élaboration qui suit. Et ces objectifs, appareils, images sur papier sont la manifestation de cette séparation, cette frontière entre l’homme et la réalité, qui devient d’autant plus intouchable, impalpable.
D’ailleurs la présence de l’image est très fortement marquée dans la façon de filmer d’Antonioni. Beaucoup d’images tendent vers l’abstraction Ainsi la toute première image de Londres est une image envahie par le béton, presque plane par les perspectives écrasées. Déstabilisé par le manque de recul, le spectateur ne retrouve ses repères qu’une fois la voiture des jeunes gens entrée dans le champ. Pendant la séquence dans le parc, certaines images sont envahies par le vert, les perspectives écrasée projetant vers l’avant les grandes étendues de gazon. Nombreuses sont les images de surfaces indéfinies dont la lisibilité est suspendue par le manque d’indication de l’échelle ou de l’angle de prise de vue jusqu’à l’entrée dans le champ d’un indice. Ce type d’images, regroupées sous la catégorie « des plans à appréhension décalée » par Noël Burch, font subtilement ressentir au spectateur le caractère malléable et transformable de l’image, la liberté qu’elle peut prendre par rapport à la réalité. Par ailleurs, ces plans enlèvent la tangibilité, la matérialité de la réalité, la rendent là encore impalpable.
Sans aller jusqu’à l’abstraction, de nombreux plans ont un cadrage très élaboré, tendant vers le pictural et semblant se rapprocher de tableaux. Ainsi dès la deuxième séquence, alors que Thomas sort de l’asile de nuit, toutes les images ont un cadrage très pictural. On pense par exemple au premier plan sur la sortie des hommes de l’asile – cadrage à travers des grilles, sorte de mise au carreau du tableau, avec barres de portail comme lignes de forces de la composition, à ce flux d’hommes se dirigeant vers la sortie, pris entre deux murs blancs, deux lignes de fuite ou encore ce plan sur eux se dispersant sous un tunnel, arcade supérieure noire rappelant les lunettes de décors de la Renaissance. Tous ces plans fixes avec des personnages en mouvement semblent être comme des tableaux animés, qui rendent abstraite la réalité, lui enlève sa matérialité et donne une impression d’irréalité.
Dans cette séquence, Antonioni fait se heurter idée de reportage et présence de l’image. Toutes les images allient à la fois un profond réalisme – visages sombres d’hommes en habits miséreux, dos voutés et fatigués, quartiers mornes et gris, luisants d’humidité – et ce cadrage pictural qui révèle la présence de l’image, comme pour montrer que même s’il est possible de ressentir un lieu, un milieu, de toute façon, la réalité a toujours en elle quelque d’inaccessible. Nous sommes à la fois proches d’un cinéma social, mais en même temps tiré de la réalité par ces cadrages. Thomas prépare un ouvrage sur Londres. C’est pourquoi que nous le voyons sortir de l’asile de nuit avec son appareil photo. Plus tard, dans la séquence du restaurant, nous verrons certains des clichés qu’il a pris. Ces photographies de misère sont aussi des images aux cadrages et points de vue étudiés, aux contrastes et tonalités travaillées. L’intention du photographe était aussi de faire quelque chose d’artistique. Dans cette séquence où nous voyons défiler toutes ces belles photographies, Antonioni semble s’interroger sur ce qu’est une image de reportage, et sur le problème de la recherche esthétique, limite ou ouverture à la réalité. Puis la caméra s’attarde sur les yeux mélancoliques de Thomas qui regarde ensuite par la fenêtre Londres à travers la grille des stores, mélancolie de cette réalité si difficile d’accès. Puis nous le voyons écarter les stores comme pour voir derrière le cadre, cherchant au delà.
Antonioni « abstractise » Londres, non seulement par ces images qui tendent vers l’abstraction mais aussi par les cadres à l’intérieur du cadre : vues à travers des fenêtres, des pares brises, toutes les poutres et linteaux de l’appartement de Thomas : des lignes de force qui cadrent les personnages. Cadres qui font prendre conscience du statut de l’image comme étant quelque chose d’abstrait à la réalité. Mais qui insiste aussi sur le caractère limité du champ de vision d’une image. Un exemple marquant est le plan sur l’entrée de Thomas dans le magasin d’antiquités. Sur sa gauche, nous apercevons une statue de jeune femme en porcelaine. Le cadrage s’élargissant révèle qu’elle n’a plus de tête. Cette idée de vision restreinte se retrouve dans la découverte de la ville presque exclusivement au travers de trajets. La caméra ne se détache presque jamais des personnages en déplacement, ne permettant pas ainsi d’avoir une vision plus large et globale. La caméra n’est pas contemplative, elle reste concentrée sur le mouvement. On pense par exemple à la première séquence lorsque la voiture des jeunes gens circule parmi les immeubles et lorsqu’ils courent dans la rue. La caméra ne se sépare pas d’eux et ne prend pas de recul, nous offrant une vision partielle des alentours. De même, lorsque Thomas est en voiture, la caméra, embarquée ou non, ne perd jamais de vue le véhicule et son occupant. Presque chaque plan comprend au moins un fragment du véhicule, ou de la tête du personnage. Ainsi la ville devient très souvent un arrière-plan, aperçue derrière une tête, ou à travers un pare-brise. Et même si parfois la caméra se détache pour fixer un plan d’ensemble (ainsi lorsque la caméra s’attarde sur le chantier par exemple, elle retrouve très vite son cadre : le pare brise), le paysage reste perpétuellement découvert en mouvement, en passage. Ainsi le spectateur prend-il conscience du caractère limité de sa vision, ayant presque envie de saisir la caméra pour pouvoir avoir une vision plus globale. L’image peut aussi être obstruée et la vision empêchée. Dès le générique, Antonioni crypte l’image, inverse les rapports, met le fond au premier plan et l’action au second. Le spectateur est incité à aller voir derrière les choses, derrière le fond vert, à travers les ouvertures que constituent les noms du générique. Beaucoup de choses s’interposent entre notre regard et la figure. Grille, paravent, stores, pare-brise sale et incurvé déformant la réalité, obscurité, plaques de plexiglas comme différents filtres (on pense à la prise graduelle de densité tandis que Thomas et la jeune femme avancent vers l’escalier du studio et que s’ajoutent le nombre de plaques). Antonioni semble se demander combien d’écrans empêchent la vue.
Lorsque Thomas examine plus précisément les photographies prises dans le parc
– le couple, puis la jeune femme s’enfuyant – il s’aperçoit de la présence d’un homme dans les fourrés, puis d’un cadavre au pied d’arbustes. Antonioni répand ces ambiguïtés dans d’autres plans du film. Soit dans le même ordre d’idée en faisant disparaître des personnes, qui restent pourtant présentes dans le champ : ainsi la jeune femme que la caméra suit dans l’appartement de Bill. On la voit avancer, passer derrière une poutre, mais à cet instant précis, elle n’est plus à l’image. La réalité est dans l’image mais on ne la voit pas. Il y aussi l’exemple inverse. Ainsi, quand Thomas entre dans son atelier où l’attend Veruschka, nous voyons le reflet de la jeune femme présent dans l’image, alors qu’elle même n’est pas présente dans le champ. Reflet qui attente à la réalité et à la tangibilité de la jeune femme. La pichenette désinvolte de Thomas révèle d’ailleurs le support et rend l’image mouvante encore plus insaisissable.
En jouant sur les données de l’image, en aplatissant ou allongeant les perspectives, en jouant sur l’échelle et le point de vue, Antonioni nous fait vivre l’expérience de Thomas. Découvrir qu’une photographie, une image peut être trompeuse, prendre conscience de ses limites et éprouver le caractère insaisissable de la réalité. Dans Blow up, le cinéaste a voulu insister sur la présence de l’image, et par de multiples moyens bouleverser les repères du spectateur le forçant ainsi à une plus grande attention, à le mettre lui aussi, tout comme Thomas, dans une démarche de recherche. Antonioni veut nous transformer en funambule, vacillant sur le fil ténu et mouvant que semble être la réalité. D’ailleurs l’idée de fil, qui est à la fois un support mais aussi une frontière entre deux états, est présente dans Blow up. Lors de la deuxième séance de pose des mannequins, alors que la caméra effectue un travelling, on découvre une ligne de séparation entre ce que l’on vient de voir à travers une plaque de plexiglas et ce que l’on voit à présent à découvert. Le plus touchant, le plus marquant, c’est la ligne entre les deux, le moment où l’on saisit le changement. Pendant toute la séquence des agrandissements, au moment où les certitudes de Thomas vont basculer, le fil est matériellement présent. Lorsque Thomas se rend dans son atelier de développement, la caméra s’arrête sur un mur parcouru en son milieu par une ligne, un fil. Cette ligne peut être celle du policier, fil d’Ariane, celui qu’il faut suivre pour sortir du labyrinthe, mais il peut être aussi le fil sur lequel, devenu funambule, nous allons vaciller. Fil aussi, le rouleau de négatifs que Thomas sort de la trieuse, succession d’images retraçant les événements où Thomas va découvrir la vraie nature de la scène matinale. Enfin, le fil permettant l’accrochage des photos, fil que Thomas touche alors qu’il regarde la photo avec la loupe et qu’il va apercevoir le cadavre. Après être aller dans le parc et avoir vu le corps, revenant dans son atelier, il ne reste plus que les pinces accrochées au fil qui se meuvent légèrement dans l’air. L’amie de Bill mettra le doigt sur ce fil comme pour en faire éprouver sa mobilité et sa fragilité alors que Thomas lui explique sa découverte.
Devenus funambules, nous sommes laissés en suspend. Antonioni cherche à nous déstabiliser et à créer une atmosphère particulière, pleine de mystère. Dans un texte écrit durant le tournage du film, le cinéaste évoque la scène du parc, moment où la réalité va se manifester et il la décrit comme se déroulant « dans la clarté mystérieuse des enseignes lumineuses de Londres ».
Ainsi Antonioni laisse t-il l’identité des personnages, des sentiments et des évènements incertaines. Dès le début, Thomas – qui n’est d’ailleurs jamais nommé, de même que tous les personnages, sauf Ron – s’avère être différent de ce qu’il avait l’air de prime abord. Clochard, il devient le propriétaire d’une Rolls Royce. Un peu plus tard, nous comprenons qu’il est photographe. Un appareil, furtivement aperçu dans un sac à l’arrière de sa voiture nous avait mis sur la piste. Lorsqu’il ressort de son atelier et se rend dans une maison à coté, on ne sait pas trop s’il est chez lui ou chez son ami Bill et qui est la jeune femme qui lui caresse les cheveux et que nous verrons coucher avec Bill à la fin du film. Notre jugement reste en suspension, de même qu’en ce qui concerne les évènements. Il y a eu meurtre. Nous voyons le corps. Mais le principal soucis de Thomas n’est pas d’appeler la police comme lui suggère l’amie de Bill, mais de comprendre comment il a pu photographier la scène et ne pas voir. Puis lorsque le corps disparaît, que Thomas prends une balle imaginaire et qu’il disparaît à son tour, Antonioni semble nous laisser seuls maîtres de savoir ce qui existe ou non.
Il y a aussi le problème de l’identification de la ville. Comme le fait remarquer Andréa Martini, « il se produit pour les lieux ce qui se produit sur le plan du récit filmique. L’identification des premiers nous échappe, tout comme nous échappe la vérité des seconds. Nous ne savons jamais ce qu’il y a derrière les choses». Pas de monuments historiques marquants, de clichés, d’images pittoresques. Le générique ne révèle rien. Les premières images de Londres sont celles d’immeubles modernes en béton gris, puis de bâtiments en briques grises vus à travers des grilles sous un ciel morne, des maisons de banlieue ternes et des rues luisantes d’humidité. Des lieux neutres, sans véritable identité. Le cinéaste laisse en pointillés quelques indices plus ou moins évocateurs et aperçus pour la plupart tellement rapidement que l’on doute même de les avoir vus. Premiers indices, une inscription sur un camion : Road Transport, dans la rue où courent les jeunes gens, indiquant simplement que nous sommes dans un pays anglo-saxon, et une Rolls Royce, voiture anglaise, passant rapidement à travers le champ. Les deux seuls panneaux de signalisation, véritables indications d’un lieu, laissent le spectateur entre le trop précis : Consort Road (nom d’une rue) et le trop vague : Keep Left. C’est une image, celle d’un garde royal vu assez rapidement, qui est la plus explicite, Antonioni remettant en cause ce qui fait sens. Puis nous apercevrons une cabine téléphonique et des bus rouges. Mais rien n’est fixé avant que Thomas ne dise à Ron dans le restaurant : « j’en ai marre de Londres cette semaine » après quarante minutes de film. Disant cela, il regarde la ville à travers les stores par la fenêtre, image grise d’immeubles de briques. Rien de vraiment typique. Il convient d’ailleurs de noter qu’il y a relativement peu de prises extérieures (environ trente minutes sur les cent dix du film). La majorité de ce temps (un peu plus de vingt minutes) se déroule dans un parc, que certains ont identifié comme étant Hyde Park, alors qu’il s’agit d’un parc beaucoup moins connu s’appelant Maryon Park. En dehors des séquences du parc, nous découvrons la ville au travers de trajets : celui des jeunes gens en voiture puis à pieds au début du film, ceux de Thomas en voiture allant d’un endroit à un autre. Londres devient donc des routes, des maisons vues à travers des pare-brises, des voitures et des autobus, des immeubles en béton « universels », des banlieues et des rues communes : des lieux « anonymes ». Reste quelques éclairs d’identité – inscriptions et signes – garde royal, cabine téléphonique, bus rouges, Carnaby Street en gros plan, enseigne furtive du Ricky Tick, aussitôt disparus.
Antonioni nous laisse en suspension dans un espace-temps brouillé. Parfois des coupures relient deux temps qui ne sont pas continus dans le récit. Par exemple, lors de la deuxième séance de pose, Thomas rectifie les positions des mannequins. Puis nous voyons un plan sur son visage. Mais le plan suivant montre une mise en scène, un décor et des costumes totalement différents. Autre exemple lors des trajets de Thomas, des coupures inattendues rompent la continuité du cheminement, brouillant notre appréhension de l’espace parcouru et de la durée du trajet. Lorsque Thomas part du magasin d’antiquités, la caméra suit de très près sa voiture. Nous la voyons se diriger vers des arbres, puis après une coupure, les arbres ont disparus, et nous nous retrouvons devant des immeubles.
Antonioni nous plonge dans une atmosphère mystérieuse, en suspension. Il fait naître en nous un sentiment d’attente, une perte de repère qui nous rend plus conscients, nos sens plus alertes et disponibles. Il nous fait ressentir une sorte de vertige comme une prédiction de l’intrusion du réel, une suspension qui nous laisse en attente d’un surgissement du réel. Car même si la réalité nous reste insaisissable, Antonioni sait nous faire sentir que derrière toute image, derrière tout ce que nous voyons, il y a quelque chose qui gronde, le réel, qui peut apparaître tel un éclair tout de suite disparu. Ainsi tout au long du film, loin de nous plonger dans un univers complètement irréel, Antonioni nous fait osciller entre impalpable et sentiment de profond réalisme. Réalisme que l’on ressent dans l’intérêt d’Antonioni pour la société anglaise, les quartiers pauvres au début du film, le travail d’un photographe de mode du Swinging London, les modes de vie,… Mais aussi sentiment de profond réalisme obtenu par la façon de filmer. Quelle présence des sens par exemple dans cet arbuste chétif qui bouge au vent sur le ciel gris lorsque Thomas longe le terrain vague pour rejoindre sa voiture au début du film. Il y a une dimension sensorielle très importante, dans l’humidité, le vent, le bruit des pas sur le pavé, celui des oiseaux dans les arbres, dans la lumière du soleil sur la voiture de Thomas, blanche, éblouissante. Les bruits semblent toujours annonciateurs de quelque chose, lié à l’émergence du réel. Ainsi le chant répétitif des oiseaux dans le parc, le bruit de l’eau qui ruisselle dans le studio – élément perpétuellement insaisissable – alors que Thomas développe et agrandit en recherchant ce qui l’intrigue dans l’image. De même lors de la reconstitution de la scène du parc dans l’atelier, alors que la caméra glisse de photos en photos, Antonioni remet la bande son du parc : le vent dans les branches des arbres comme un souffle mystérieux annonçant l’imminence de quelque chose.
Antonioni nous entraîne dans des plongées très réalistes, souvent grâce à la caméra portée : on pense aux trajets de Thomas en voiture ; dans Carnaby Street par exemple où la caméra bouge tellement, « s’envole » presque même à un moment, donnant vraiment une sensation de vertige, comme une bouffée de réalité, même si la vision est altérée par la vitesse. Lorsque la caméra s’attarde ensuite sur le terrain vague, il semblerait que l’on soit face à un document d’actualité, lent constat tremblant. Antonioni joue aussi sur des points de vues insolites qui place le spectateur dans des endroits tellement inattendus qu’il ressent plus « matériellement » sa place, sa vision devenant plus consciente et attentive. Comme lorsqu’il se retrouve tout à coup au dessus de Thomas par une prise en plongée au dessus de la voiture du héros à la sortie d’un tunnel, le soleil venant aussi tout à coup frapper les yeux après l’obscurité. Ou bien alors que Thomas agrandit les photos dans son studio, la caméra et le spectateur se retrouvent tout à coup sur une poutre. La caméra parfois est aussi tellement proche d’un personnage, que le spectateur se retrouve comme pris dans la scène, devenant un personnage. On pense par exemple à certaines prises sur l’arrière de la tête de Thomas dans sa voiture comme si nous étions à bord.
Table des matières
Introduction
I : « Reportage » et Enquête Philosophique au coeur des révolutions contemporaines
A. Blow Up : « Swinging London » et réalité insaisissable
1. Le bouillonnement culturel et social du « Swinging London »
2. Réalité insaisissable
B. Zabriskie Point : Un poème sur l’Amérique
1. Signes et Symboles de l’Amérique à travers Los Angeles, La Révolution Estudiantine et la Vallée de la Mort
2. Entre imaginaire et réel
C. Profession : Reporter : Un décadrage continuel
1. Le Tchad, L’Angleterre, L’Allemagne, l’Espagne et la carte du trafic d’armes
2. « Une épiphanie sans épiphanie »
II : Vers le Désert
A. Vers un paysage de mort ?
1. La mort en différé : glissement de la mort
2. Un équilibre délicat entre vie et mort
B. Vers le Vide
1. Paysages désertiques
2. Des images « vides »
C. Vers un espace nomade
1. Personnages nomades
2. Espaces lisses
Conclusion
Bibliographie
Filmographie
Télécharger le rapport complet