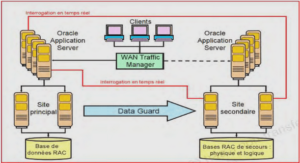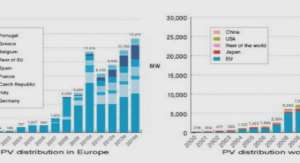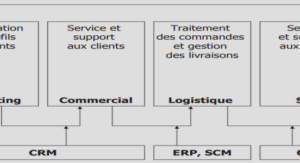Le substrat géologique
Les formations géologiques des iles Karones et plus généralement de la basse Casamance appartiennent à la partie méridionale du bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien. Ce bassin sénégalo-mauritanien qui s’est mis en place avec l’ouverture de l’Atlantique central au Jurassique, présente une couverture sédimentaire diversifiée. Il est d’âge méso-cénozoïque, et repose sur un substratum d’âge Précambrien à Paléozoïque. Il s’étend du Cap Blanc en Mauritanie au Cap Roxo en Guinée Bissau; et continue en mer entre le 10ème et le 21ème parallèle, sur une bande de 200 km en moyenne, avec une largeur maximale de 560 km sur la latitude de Dakar. Sa superficie est d’environ de 610.000 km² et recouvre les 3/4 des séries paléozoïques du Sénégal Leprieur (1829), Etienne (1898). La série sédimentaire va sans interruption du Trias-Lias au Quaternaire sur une épaisseur de 12 000 m en Casamance, où la subsidence est la plus forte. Les sédiments présentent des faciès détritiques grossiers avec l’influence littorale à l’Est du bassin, qui deviennent de plus en plus fins vers l’Ouest, avec une influence marine. Au sein de cette méga séquence sédimentaire (on parle de méga séquence car au niveau du paléozoïque, il existerait aussi un autre bassin sédimentaire), le socle plonge doucement vers l’Ouest, pour s’effondrer brusquement à la faveur de failles de direction N-S aux environs de 16° W Meunier (1898 et 1906) Chautard (1905, 1906 et 1907) Hubert (1917). Ceci provoque un changement d’épaisseur caractérisé par la subsidence de la marge continentale à l’Ouest (Liger, 1979)
La partie supérieure est constituée par des niveaux détritiques subhorizontaux, gréso-argileux désigné par le terme générique de « continental terminal ». Leur principal facies est un gré hétérométrique, argileux, bariolé (Michel, 1973 cité par Jean Albergel et al 1991). Il s’agit de formation tertiaire dont l’origine serait l’altération de sédiments marins sablo-argileux, glauconieux mis en place à une période allant du crétacé au miocène (Chauvel, 1977). Ces formations gréseuses sont caractérisées dans la partie supérieure par un gré argileux blanc présentant des volumes rougeâtres (taches contenant des oxydes de fer). Des niveaux indurés ferrugineux d’épaisseur supérieure au mètre se sont formés parfois à plusieurs endroits (Jean Albergel et al 1991). Nés d’une altération ferralitique, ces matériaux contiennent un petit nombre de minéraux stables associés à de faibles quantités de minéraux lourds. Des grains de quartz émoussé, de taille variable mais surtout petit sont cimentés par une argile kaolinique (Chauvel, 1977). Les sesquioxydes de fer sont associés soit à l’argile soit aux éléments quartzeux sous forme d’incrustation. Ces constituants relativement résistants ont été réorganisés par des processus de différenciation pédologique. Ces grés constituent le matériau originel à partir duquel se sont formés les sols (Michel, 1973).
Au cours du quaternaire récent une pédogénèse ferralitique en période humide s’est développée donnant naissance à une couverture pédologique profonde (plusieurs mètres) Jean Albergel et al, 1991).
Durant la même période, les variations du niveau marin et les modifications climatiques ont façonnés le paysage actuel de la basse Casamance. Le creusement des vallées, l’édification de cordons littoraux, le comblement des estuaires par des dépôts marins au cours de transgressions successives, sont les événements majeurs de la géomorphologie de cette partie du Sénégal dont appartiennent les iles Karones (Kalck, 1978). Sont aussi apparues des terrasses sableuses situées en bordure de plateaux et des vasières formées par des sédiments fins, colonisés par la mangrove et associés à des zones salées sans végétation appelées vasières dénudées
La géologie
L’histoire de la géologie des iles Karones se résume à l’étude des formations et dépôts éocène et post éocène et aussi des formations du Quaternaire récent période de structuration de la forme actuelle de toute la commune de Kafountine dont font partie les iles Karones et Bliss. La géologie de notre site, comme celle du bassin versant de la Casamance qui est un peu singulier du fait de la position géographique de la région sud, s’est érigée du Paléozoïque au Jurassique sous la forme de structure de marge passive (Dacosta, 1989). Son socle métamorphique paléozoïque est constitué de schistes, de gré et de quartzite. Ce socle se situe d’après les recherches géophysiques et les forages pétroliers à plus de 7000 m (Dacosta, 1989). L’ère secondaire est caractérisée par une importante série de transgression marine qui est à l’origine de la mise en place de facies marin dans le bassin de la Casamance (Diallo I, 2005 cité par Diatta B, 2008).
Le Jurassique marque le début de la mise en place de matériaux sédimentaire essentiellement constitués de sable, d’argile et de marne alternant avec du calcaire. Ces matériaux seront affinés par les épisodes transgressifs entre le cénomanien supérieur et le turonien avec des dépôts plus gros.
Au Maestrichtien le niveau de la mer à montait et avait envahi le bassin. À son retrait il a laissé des dépôts dont l’épaisseur varie entre 600 m et 130 m parfois même allant jusqu’à 30 m d’épaisseur par endroit (Albergel et al 1991).
Les formations et dépôts Éocènes et poste Éocènes
Ces formations sont marquées par des dépôts de calcaires alternant avec des facies de calcaire phosphaté à des facies marno-calcaire. Au Miocène la mer en formant un golfe en basse Casamance a causé une tectonique dont les réseaux de fractures sont direction nord. Après le retrait de la mer au poste Miocène, un dépôt de sédiments détritique dont le facies est fait de grés hétérométrique, argileux, bariolé du nom de continental terminal s’est déposé le long du littoral de la basse Casamance (la présence de ces dépôts est notée à Saloulou) Kalck 1978.
Le Quaternaire récent
Cette période est la phase de l’évolution géologique de la basse Casamance témoin de la mise en place de notre site d’étude. Le Quaternaire récent marqué par la transgression marine du Nouakchottienne, est essentiellement caractérisé par des phases d’entaille du réseau hydrographique actuelle observé sur toute la zone de Kafountine et par des épisodes de remaniement éolien. Cette période occupe une place de choix dans la dynamique du bassin versant de la Casamance et plus exactement dans partie estuarienne où des dépôts vaseux superficiels et des dépôts sableux ont été notés. C’est pendant cette période que les cuirasses latéritiques sommitales du Continental Terminal se sont formées. Tous ces dépôts résultent des changements climatiques et des fluctuations eustatiques de ces périodes (Kalck 1978).
En résumé, de tous ces mouvements, on note quatre phases dans l’évolution de la dynamique des unités morphologiques des iles Karones.
La première phase s’est déroulée au maximum du Nouakchottienne en 5500 ans BP. l’estuaire de la Casamance tel qu’on le connait aujourd’hui était occupé par le golf de la Casamance largement ouverte sur l’océan atlantique.
Le début du retrait de la mer (régression) avait coïncidé avec une houle vers 4000 ans BP qui avait abordé la cote suite à une incidence oblique qui avait causé une dérive littorale vers le sud. En 4310 BP, la flèche littorale parallèle à trois des îles du Bliss, aide au colmatage des seuils sous-marin du golf de la Casamance qui aurait une profondeur de -11 m vers 3000 ans BP. C’est le début de la mise en place de la flèche et des îles.
La troisième phase a démarré avec un remblaiement de l’estuaire et l’édification des toutes premières vasières à mangrove dans les îles. cette phase est aussi marquée par un retrait de la mer qui avait conditionné des pulsations arides qui correspondent aux changements de directions des courants littoraux.
Ces changements ont entrainé la formation des cordons, des terrasses, et des plateaux. Ils ont aussi donnés naissance à « une nouvelle sédimentation responsable de la vasière à mangrove sillonnées par des chenaux profonds et anastomosés aux méandres caractéristiques » (Vieillefon 1975). Cette phase est désignée comme étant le bloc terminal de la formation qui a donné à toutes les îles de la communauté rurale de Kafountine mais aussi à la flèche de cette même CR leur forme physique actuelle parsemée par beaucoup de bolongs et des îlots de mangrove.
Les unités géomorphologiques
Les études géomorphologiques réalisées par Vieillefon ont montré l’existence de sept (7) unités géomorphologiques dans la CR de Kafountine dont six qui concernent notre site. Ces unités sont : la terrasse supérieure, la terrasse des 4 m, la terrasse des 2 m, la basse terrasse, les amas coquilliers et les cordons littoraux et dépressions.
La terrasse supérieure inchirienne
La transgression de l’inchirienne dont le maximum est noté à l’an 33000 BP serait la période de la mise en place de la terrasse supérieure qui couvre les plateaux du continental terminal en Casamance (Vieillefon, 1975). Cette terrasse qui couvre l’axe Kafountine-Hillol mais aussi les villages de la partie continentale de la CR, est localisée dans le Bliss où elle est présente sous une forme circulaire. Les sols de cette terrasse sont peu évolués. Cependant ils ont un facies ferrugineux.
La terrasse des 4 m
Aussi appelée la haute terrasse, la terrasse des 4 m est fortement présente dans notre site d’étude. Elle forme un rideau entre le sud du Bliss et le sud du petit Kassa. La terrasse des 4 m est assez aplanie et caractérisée par des sols de couleurs blanchâtres et par une végétation mono spécifique de Parinari Macrophylla plus visible dans l’île de Saloulou (Viellefon 1975).
La terrasse des 2 m ou la moyenne terrasse
Cette terrasse est surtout présente au sud des îles Karones, dans le petit Kassa où elle rencontre la terrasse des 4 m en forme de delta renversé. Elle aussi présente en arrière des cordons littoraux de la zone. La terrasse des 2 m évoque plus nettement des lignes de cordons littoraux.
La basse terrasse
Elle affleure dans plusieurs endroits de la commune de Kafountine. Dans le Bliss elle couvre une partie de la terrasse supérieure. Dans la partie du Karones, elle constitue la limite sud de la terrasse supérieure inchirienne. La basse terrasse est aussi présente dans la partie sud de l’île de Couba. Elle forme une succession de tache d’huile dans la partie orientale du petit Kassa. Les basses terrasses formées sur d’anciens schorres évolués en tannes ont été mis en place au cours du retrait de la mer après le maximum Nouakchottien (Vieillefon, 1977)