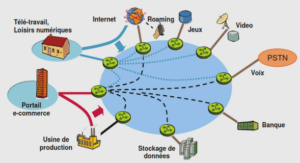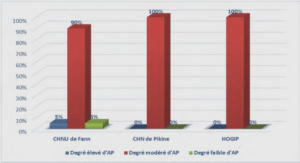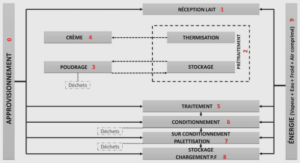LE MÉTIER ET LA VOCATION DE SAVANT
Vous m’avez demandé de vous parier du métier de savant. Or nous autres économistes, nous avons l’habitude d’une certaine pédanterie, à laquelle je voudrais rester fidèle : nous commençons toujours par examiner les conditions extérieures d’un problème ; je poserai donc ici la question : comment se présente le métier de savant, au sens concret du mot ? Pratiquement cela revient à dire aujourd’hui : com-ment se présente la, situation d’un étudiant qui a terminé ses études et qui est décidé à faire de la science son métier, dans le cadre de la vie universitaire ? Pour comprendre combien particulière est sur ce point la situation allemande, il est utile de procéder par comparaison et de rappeler comment les choses se passent à l’étranger, là où le régime accuse les différences les plus nettes avec le nôtre sous ce rapport, je veux dire aux États-Unis.
Chez nous – chacun le sait – le jeune homme qui se consacre à la science commence normalement sa carrière par le poste de Privatdo-zent. Après avoir conféré avec le spécialiste de la discipline qu’il a choisie et après avoir obtenu son consentement, il se fait habiliter pour l’enseignement supérieur en présentant un ouvrage et en se sou-mettant aux épreuves d’un examen, le plus souvent formel, devant le jury de la faculté [54] d’une université. Désormais il pourra donner des cours en choisissant lui -même son sujet dans le cadre de sa venia legendi. Mais il ne perçoit aucun traitement, il n’a d’autre rémunéra-tion que la contribution des étudiants [Kolleggeld]. En Amérique on débute d’une tout autre façon dans la carrière : on y est d’abord enga-gé comme « assistant ». D’une manière assez voisine, par exemple, de celle qui a ordinairement cours dans nos grands Instituts des Facultés des sciences et de médecine où l’habilitation formelle comme Privat-dozent n’est convoitée que par une fraction des assistants et souvent tardivement. Cette différence avec le système américain signifie pra-tiquement que chez nous la carrière d’un homme de science est édi-fiée somme toute sur des bases ploutocratiques. En effet, il est extrê-mement risqué pour un jeune savant sans fortune personnelle d’af-fronter les aléas de la carrière universitaire. Il doit pouvoir subsister par ses propres moyens, du moins pendant un certain nombre d’an-nées, sans être aucunement assuré d’avoir un jour la chance d’occuper un poste qui pourra le faire vivre décemment. Aux États-Unis par contre règne le système bureaucratique. Dès son entrée dans la carriè-re, le débutant touche un traitement, il est vrai médiocre, puisque la plupart du temps il correspond à peine au salaire d’un ouvrier non qualifié. Néanmoins il débute en occupant une situation apparemment stable, étant donné qu’il touche un traitement fixe. Il est toutefois de règle qu’on peut lui donner congé, comme à nos assistants en Alle-magne, s’il ne répond pas aux espoirs mis en lui ; il doit même s’y attendre assez souvent, sans compter sur aucun ménagement. Que signifient ces « espoirs » ? Tout simplement qu’il fasse « salle plei-ne ». Pareille mésaventure ne menace point le Privatdozent. Une fois en place, on ne peut l’en déloger. Certes, il ne formule aucune reven-dication. Mais il pense pourtant, chose humainement [55] compré-hensible, qu’il possède une sorte de droit moral à des ménagements lorsqu’il a exercé des années durant. On tient également compte de cette situation acquise – et cela est souvent important – au moment de l’« habilitation » éventuelle d’autres Privatdozenten. D’où le problème : faut-il en principe accorder l’« habilitation » à tout jeune savant ayant donné les preuves de ses capacités ou bien faut-il prendre en considération les « besoins de l’enseignement » et donner ainsi aux Dozenten en place le monopole de l’enseignement ? Cette question pose un pénible dilemme qui est lié au double aspect de la vocation universitaire dont nous parlerons tout à l’heure. La plupart du temps on se décidé en faveur de la seconde solution. Mais elle ne fait qu’augmenter certains dangers. En effet, en dépit de la plus grande probité personnelle, le professeur titulaire spécialiste de la discipline en question est malgré tout tenté de donner la préférence à ses pro-pres élèves. Si je me réfère à mon expérience, j’avais adopté le prin-cipe suivant : je demandais à l’étudiant qui avait fait sa thèse sous ma direction d’aller se faire agréer et « habiliter » par un professeur d’une autre université. Il en est résulté qu’un de mes élèves, et des plus mé-ritants, a été éconduit par mes collègues parce qu’aucun n’ajoutait foi aux motifs allégués.
Il existe une autre différence avec le régime américain. En Alle-magne le Privatdozent a en général moins de cours à faire qu’il ne le désire. En droit, il peut certes faire tous les cours de sa spécialité. Mais une pareille façon de faire est considérée comme une indélica-tesse inouïe à l’égard des Dozenten plus anciens ; en conséquence les « grands » cours sont réservés au professeur et le Dozent se contente des cours secondaires. Il y trouve l’avantage, peut-être involontaire, de pouvoir disposer pendant sa jeunesse de loisirs qu’il peut consacrer au travail scientifique.
En Amérique, l’organisation est fondamentalement différente. C’est précisément pendant ses jeunes années que l’assistant est littéra-lement surchargé de travail, justement parce qu’il est rémunéré. Dans le département d’études germaniques par exemple, le professeur titu-laire fait environ trois heures de cours sur Gœthe, et c’est tout – alors que le jeune assistant s’estime heureux si, au cours de ses douze heu-res hebdomadaires, on l’autorise à faire, à côté des travaux pratiques d’allemand, quelques leçons sur des écrivains d’un plus grand mérite que, disons, Uhland. En effet, ce sont les instances officielles de sa spécialité qui fixent le programme et l’assistant doit s’y plier tout comme chez lions l’assistant d’un Institut.
Or nous pouvons observer clairement que, dans de nombreux do-maines de la science, les développements récents du système univer-sitaire allemand s’orientent dans la direction du système américain. Les grands instituts de science et de médecine sont devenus des en-treprises du a capitalisme d’État ». Il n’est plus possible de les gérer sans le secours de moyens considérables. Et l’on voit apparaître, comme partout ailleurs où s’implante une entreprise capitaliste, le phénomène spécifique du capitalisme qui aboutit à « couper le tra-vailleur des moyens de production ». Le travailleur – l’assistant – n’a d’autre ressources que les outils de travail que l’État met à sa disposi-tion ; par suite il dépend du directeur de l’institut de la même façon qu’un employé d’une usine dépend de son patron – car le directeur d’un institut s’imagine avec une entière bonne foi que celui-ci est son institut : il le dirige clone à sa guise. Aussi la position de l’assistant y est-elle fréquemment tout aussi précaire que celle de toute autre exis-tence « prolétaroïde » ou celle de l’assistant des universités américai-nes.
Comme les autres secteurs de notre vie, l’université allemande s’américanise sur d’importants chapitres. Je suis convaincu que cette évolution touchera même des disciplines dans lesquelles le travailleur est personnellement propriétaire de ses moyens de travail (essentiel-lement de sa bibliothèque). Pour le moment le travailleur de ma spé-cialité est encore dans une large mesure son propre maître, à l’instar de l’artisan d’autrefois dans le cadre de son métier. Mais l’évolution se fait à grands pas.
On ne peut nier les avantages techniques incontestables de cette évolution comme dans n’importe quelle autre entreprise ayant à la fois les caractères capitaliste et bureaucratique. Mais le nouvel « es-prit » est bien différent de la vieille atmosphère historique des univer-sités allemandes. Il y a un abîme, extérieurement et intérieurement, entre le chef de cette sorte de grande entreprise universitaire capita-liste et l’habituel professeur titulaire du vieux style. Cela se traduit même dans le comportement intime. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. L’ancienne constitution universitaire est devenue fictive aussi bien dans son esprit que dans sa structure. Néanmoins, il est un aspect propre à la carrière universitaire qui n’a pas disparu et qui se manifeste même d’une façon encore plus sensible : le rôle du hasard.
C’est à lui que le Privatdozent et surtout l’assistant doivent de parve-nir éventuellement un jour à occuper un poste de professeur titulaire à part entière on surtout celui de directeur d’un institut. Bien sûr, l’arbi-traire ne règne pas seul dans ce domaine, mais il commande pourtant dans une mesure inhabituelle. Je ne connais guère de carrière au monde où il joue un si grand rôle. Je puis en parler d’autant mieux que personnellement je dois à un concours de circonstances particu-lièrement heureuses d’avoir été appelé très jeune à occuper une chaire de professeur titulaire dans une spécialité où des camarades de mon âge avaient indubitablement [58] produit déjà beaucoup plus que moi-même. Fort de cette expérience, je crois posséder un oeil plus pénétrant pour comprendre le sort immérité de nombreux collègues à qui la fortune n’a pas souri et ne sourit pas encore et qui, avec ces procédés de sélection, n’ont jamais pu occuper, malgré tout leur ta-lent, le poste qu’ils méritaient.
Si le hasard et non la seule valeur joue un si grand rôle, la faute n’en incombe pas uniquement ni même surtout aux faiblesses humai-nes qui interviennent évidemment dans cette sélection comme dans toute autre. Il serait injuste d’imputer aux petits personnages des fa-cultés ou des ministères la responsabilité d’une situation qui fait qu’un si grand nombre de médiocres jouent incontestablement un rôle considérable dans les universités. Il faut plutôt en chercher la raison dans les lois mêmes de l’action concertée des hommes, surtout dans celle de plusieurs organismes, en l’espèce dans la collaboration entre les facultés qui proposent les candidats et le ministère qui les nomme. Nous pouvons en trouver un parallèle dans l’élection des papes qui nous a fourni depuis de nombreux siècles l’exemple manifeste le plus important de ce type de sélection. Le cardinal que l’on indiquait comme « favori » avait très rarement la chance d’être élu. En règle générale elle comblait le candidat numéro deux ou trois. On constate le même phénomène lors des élections présidentielles aux États-Unis. Ce n’est qu’exceptionnellement que le candidat numéro un et aussi le plus marqué est « désigné » par les conventions nationales des partis : la plupart du temps on choisit le candidat numéro deux et souvent le candidat numéro trois. Les Américains ont déjà même créé des ex-pressions techniques et sociologiques pour caractériser ces catégories de candidats. Il serait évidemment intéressant d’examiner d’après ces exemples les lois d’une sélection opérée par acte de volonté collective, mais ce n’est pas notre [59] affaire aujourd’hui. Ces mêmes lois s’appliquent aussi aux élections dans les assemblées universitaires. Ce dont il faut s’étonner, ce n’est pas que des méprises arrivent sou-vent dans ces conditions ; mais plutôt que, toutes proportions gar-dées, l’on y constate malgré tout un nombre aussi considérable de nominations justifiées. Ce n’est que dans les quelques pays où le Par-lement a son mot à dire ou encore dans ceux où les monarques inter-viennent pour des raisons politiques (le résultat est le même dans les deux cas), ainsi que cela arrivait fréquemment en Allemagne jusqu’à ces derniers temps et à. nouveau de nos jours avec les détenteurs du pouvoir révolutionnaire, que l’on peut être certain que les médiocres et les arrivistes ont seuls une chance d’être nommés.
Aucun professeur d’université n’aime se rappeler les discussions qui eurent lieu lors de sa nomination, car elles sont rarement agréa-bles. Je puis pourtant dire que parmi les nombreux cas qui me sont connus j’ai constaté sans exception l’existence d’une bonne volonté soucieuse de ne faire intervenir dans la décision que des raisons pu-rement objectives.
Il faut en outre comprendre clairement que les défaillances dans la sélection opérée par la volonté collective n’expliquent pas à elles seu-les le fait que la décision concernant les destinées universitaires est livrée dans une grande mesure au « hasard ». Tout jeune homme qui croit avoir la vocation de savant doit se rendre compte que la tâche qui l’attend présente un double visage. Il doit posséder non seulement les qualifications du savant, mais aussi celle du professeur. Or, ces ceux aspects ne coïncident absolument pas. L’on peut être un savant tout à fait éminent et en même temps un professeur terriblement médiocre. Je songe à l’activité professorale d’hommes tels que Helmholtz ou Ranke qui ne constituent certainement pas des exceptions. En vérité [60] les choses se présentent de la façon suivante nos universités, par-ticulièrement les petites universités, se font entre elles la concurrence la plus ridicule pour attirer les étudiants. Les locataires de chambres d’étudiants, bornés comme des paysans, organisent des fêtes en l’hon-neur du millième étudiant, et de préférence une retraite aux flambeaux pour saluer le deux millième. Le revenu que constitue la contribution des étudiants est, il faut bien l’avouer, conditionné par le fait que d’au-tres professeurs qui « attirent un grand public d’étudiants » occupent les chaires dans les spécialités voisines. Même en faisant abstraction de cette circonstance, il reste vrai que le nombre des auditeurs est un critère numérique tangible de la valeur, alors que la qualité du savant est du domaine de l’impondérable. Il arrive fréquemment (ce qui est tout à fait naturel) qu’on conteste justement celle-ci aux novateurs au-dacieux. C’est pourquoi tout est presque toujours subordonné à l’ob-session de la salle pleine et des bienfaits qu’elle apporte. Lorsqu’on dit d’un Dozent qu’il est un mauvais professeur, cela revient la plupart du temps à prononcer une sentence de mort universitaire, fût-il le tout premier savant du monde. On tranche donc la question des bons et des mauvais professeurs par l’assiduité dont Messieurs les étudiants veu-lent bien les honorer. Or c’est un fait que les étudiants font affluence chez un professeur pour des raisons qui sont dans une très large mesu-re -si large même qu’on a peine à y croire – étrangères à la science comme le tempérament ou l’inflexion de la voix. Une expérience per-sonnelle, déjà suffisamment riche, et une réflexion exempte de toute illusion, m’ont conduit à me méfier fortement des cours suivis par une masse d’étudiants, bien que sans doute pareille aventure soit inévita-ble. Mais il faut mettre la démocratie là où elle convient. En effet l’éducation scientifique telle que nous devons la donner par tradition dans les universités [61] allemandes est une affaire d’aristocratie spi-rituelle . Il est vain de vouloir se le dissimuler. Or il est également vrai d’autre part que, de toutes les tâches pédagogiques, la plus difficile consiste à exposer les problèmes scientifiques de telle manière qu’un esprit non préparé mais doué puisse les comprendre et se faire une opinion propre – cela constitue pour nous le seul succès décisif. Per-sonne ne le contestera, mais ce n’est point le nombre des auditeurs qui décide de la solution de ce problème. Et – pour revenir à notre sujet – cet art dépend d’un don personnel et ne se confond absolument pas avec les qualités scientifiques d’un savant. Contrairement à la France, nous n’avons pas de compagnie d’Immortels de la science, mais ce sont les universités qui ‘doivent par tradition répondre aux deux exi-gences de la recherche et de l’enseignement. C’est pur hasard si cette double aptitude se rencontre en un seul homme.