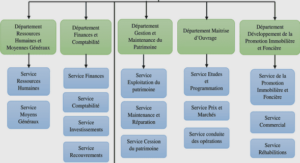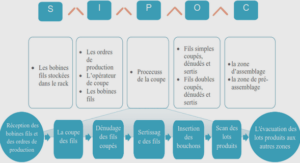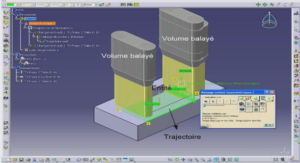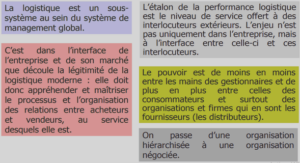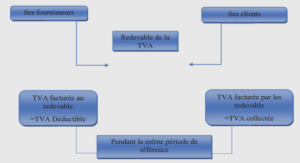Cette thèse est née d’un double étonnement. Etonnement empirique, tout d’abord, devant l’incapacité à retrouver, au cours de mes déambulations quotidiennes, l’Istanbul mise en mots par les écrivains et les poètes, immortalisée par les photographes ou les cinéastes, étudiée, analysée et parfois décriée par de nombreux journalistes et chercheurs, tant vantée par les dépliants touristiques. La ville « au ras du sol » semble en effet bien éloignée de l’hydre urbaine, de la « ville sans limite », de la métropole globale décrite, à raison pourtant, par les textes qui lui sont consacrés. Chez ses habitants, l’appartenance à une métropole de plus de treize millions d’habitants façonnée par des vagues migratoires successives est un sentiment finalement irréel, eux pour qui Istanbul se réduit à quelques fragments de l’espace urbain sur lesquels s’imprime la marque de leurs pratiques et de leurs sociabilités quotidiennes. Etonnement théorique, ensuite, face au peu d’intérêt des sciences sociales pour des phénomènes migratoires intérieurs qui, loin de se circonscrire au cas stambouliote, ont pourtant participé du façonnement de la plupart des ensembles urbains du monde. Dans un contexte scientifique de plus en plus marqué par la question des mobilités et de la place de l’individu dans ces dynamiques, la faiblesse quantitative de travaux à leur propos peut surprendre.
Ce manque interpelle d’autant plus que l’attention portée aux phénomènes mobilitaires constitue aujourd’hui un champ de recherche particulièrement dynamique de la recherche en sciences sociales et particulièrement en géographie. La volonté scientifique contemporaine de décloisonner les catégories traditionnelles au profit d’une analyse systémique articulant les différentes formes prises par les phénomènes migratoires et mobilitaires explique en partie cette situation de relégation (Salt et Kitching, 1992 ; King, Skeldon et Vullnetari, 2008). Il est vrai que les tentatives pour élaborer une lecture globale, dialectique et dynamique des différents types de mouvements humains, désormais synthétisées par la notion de mobilité, permettent de créer une grille de compréhension articulant les différentes échelles d’expression des phénomènes sociospatiaux liés au mouvement des hommes. Avec l’emboîtement des dimensions internationales et intérieures au sein des parcours migratoires individuels, avec les modalités d’évolution des mobilités résidentielles, ou celles associées aux pratiques de sociabilité et de loisir, l’analyse des mobilités se construit comme un système dialectique et interactif. Plus généralement, l’ambition de cette approche cherche à éclairer les stratégies élaborées par les individus mobiles pour s’inclure, agir et interagir au sein de leur(s) territoire(s) réels et symboliques d’action et, dans le contexte urbain qui retiendra ici notre attention, pour saisir comment ces derniers développent des pratiques et une identité citadines. L’hypothèse qui régit l’ensemble de ces travaux consiste à voir dans ces mobilités un outil explicatif des activités et des représentations qu’ont les citadins de leur espace vécu. Pour comprendre les rapports pratiques et idéels que les citadins entretiennent avec leurs lieux de vie, ces auteurs proposent un élargissement de l’échelle d’analyse de ces mobilités, intégrant des variables comme l’expérience migratoire antérieure, les singularités des parcours personnels ou encore les représentations et significations qui président à l’établissement et à la mise en œuvre de projets individuels.
Malgré les déclarations théoriques de principe, le cas des mouvements migratoires internes à un même Etat demeure pourtant le parent pauvre d’un champ de recherche de plus en plus tourné vers la dimension inter- et transnationale des phénomènes migratoires. De plus en plus assimilées à une forme particulière de mobilités résidentielles, quand elles ne sont pas tout simplement jugées obsolètes et anachroniques par certains auteurs (Simon, 2008), les migrations intérieures renvoient pourtant à un type particulier de migrations, certes moins « visible » que son pendant international, mais tout aussi important dans le fonctionnement des espaces urbains, en particulier dans le contexte géographique des pays ayant nouvellement achevé leur transition démographique ou ceux dans lesquelles elle est toujours en cours. Ce désintérêt pour l’échelon national est d’autant plus surprenant que ces phénomènes migratoires font eux-aussi émerger des lieux regroupés au sein de réseaux plus larges, irrigués de mobilités multiples, tant dans leur nature que dans leur intensité. Il apparaît en effet qu’une part importante des apports théoriques et conceptuels élaborés à partir des migrations internationales trouve dans les mouvements intérieurs un champ pertinent d’application : certaines notions comme celles de champ migratoire, de trajectoires ou encore de circulations, forgées à partir d’exemples internationaux et qui ont permis de décrire des systèmes au sein desquels interagissent plusieurs lieux peuvent-elles permettre de nourrir une réflexion actuelle sur les phénomènes migratoires internes aux Etats.
Au sein de ce champ de recherche particulièrement vaste, le choix d’une entrée par les pratiques alimentaires des populations immigrées ambitionne d’analyser une dimension fondamentale des processus collectifs et individuels d’identification à l’intersection du biologique, de l’économique, du social et du culturel (Fischler, 1990 ; Poulain, 2005 ; Fumey, 2010). Partagé par l’ensemble des mangeurs de la planète, ce caractère identitaire de l’alimentation acquiert pourtant, en situation de migration, une importance accrue et sous-tend la mise en place de stratégies pour gérer matériellement et symboliquement la distance spatiale et alimentaire qui s’instaure entre les mangeurs et leur(s) système(s) alimentaire(s) de référence. Dans ce contexte, cette thèse ne considère pas l’alimentation comme un simple symbole de dynamiques sociales et culturelles plus profondes et sous-jacentes : elle nous apparaît, au contraire, comme un instrument de base convoqué par les immigrés pour s’inclure à la société d’arrivée, y construire leurs pratiques et leurs représentations, mais aussi pour y affirmer leurs singularités. L’approche développée dans cette recherche est donc dialectique puisqu’elle cherche à croiser des travaux et des observations portant sur les pratiques alimentaires d’un groupe immigré à d’autres portant sur les pratiques et modes d’appropriation de leur territoire(s) de vie par les citadins. Il s’agit d’étudier des immigrés/migrants « de l’intérieur » en menant une analyse éclairant leurs comportements alimentaires actuels et localisés, en tenant compte, d’une part, des contextes socio-spatiaux dans lesquels ils s’expriment, mais aussi des rapports qu’ils entretiennent avec les systèmes alimentaires de référence et/ou hérités.
Ce choix amène logiquement à aborder la question de la distance et de ses multiples expressions. Notion centrale de la discipline géographique, la distance Dans sa dimension spatiale, celle-ci suppose l’élaboration de stratégies pour remédier aux contraintes matérielles et idéelles qu’elle engendre. Sociale, elle s’exprime à travers un éloignement, subi ou volontaire, par rapport aux proches et à la famille. A l’intérieur même de la société d’installation, elle peut se traduire à travers les modalités d’interaction entre immigrés/migrants et autochtones, dans la mesure où les premiers peuvent incarner une figure de l’étranger acceptée ou au contraire rejetée (Simmel, 1999, cité par Dubucs, 2009 : 2). Cette distance sociale se double alors d’une distance identitaire, de par la nécessaire adaptation des comportements et des pratiques quotidiennes aux systèmes de référence dominants au sein de la société d’installation. A la suite des multiples recherches centrées sur un aspect singulier de la notion de distance, mais témoignant de la polysémie du terme – distance spatiale et économique dans le cas des travaux hérités de la théorie anglosaxonne push/pull appréhendent les phénomènes migratoires à travers le prisme de la rationalité économique (Mabogunje, 1970) ; distance sociale et identitaire dans ceux consacrés à la gestion et la synthèse, réelle et symbolique, du jeu entre plusieurs systèmes de référence (Ma Mung et Simon, 1990 ; Raulin, 2000 ; Fliche, 2007) ; distance sociale dans l’étude des stratégies individuelles et collectives d’inclusion des populations immigrées et/ou migrantes à une nouvelle société de résidence (Béteille, 1974 ; Karpat, 1976) – le paradigme contemporain postule désormais leur nécessaire prise en compte au sein de systèmes globaux d’analyse, ces différentes dimensions et les questions qu’elles soulèvent trouvent un terrain d’observation pertinent dans l’étude des pratiques alimentaires des populations immigrées et/ou migrantes. Celui-ci cristallise en effet ces dynamiques socio-identitaires et donne lieu, dans le cas de certains mangeurs, à l’élaboration de stratégies visant à convoquer l’alimentation comme instrument permettant de réduire la distance vécue et perçue, soit par la préparation et la consommation de plats et de produits jugés « traditionnels », soit par la fréquentation d’établissements commerciaux et/ou de restauration dont l’offre s’inscrit dans un renvoi partiel ou total à la région d’origine.
Le choix d’un tel terrain s’explique par la géohistoire du contexte urbain stambouliote, dans lequel la question des migrations intérieures se pose avec une acuité particulière : le profil démographique actuel de l’agglomération stambouliote a en effet été façonné par la réception, à partir de la fin des années 1940, de vagues migratoires successives en provenance de l’ensemble des régions du territoire turc, mais aussi de l’étranger. Anatolienne par sa population, Istanbul est aussi une métropole aux ambitions mondiales cherchant de plus en plus à polariser les flux de personnes, de capitaux et d’informations en provenance du monde entier. Nouveau paradigme qui dépasse le cas unique d’Istanbul (Ghorra-Gobin, 2010), l’attention portée à la dimension métropolitaine d’un certain nombre d’espaces urbains tendrait pourtant à reléguer au second plan l’échelle locale des individus et de la quotidienneté. Notre réflexion s’inscrit donc dans une volonté de comprendre en quoi les pratiques alimentaires des immigrés intérieurs et les spatialités qu’elles engendrent, reformulent et adaptent, sans pour autant les affaiblir, les déclinaisons spatiales, sociales et symboliques de la distance à laquelle leur expérience migratoire les confronte. Une telle démarche sous-entend toutefois que l’investigation soit menée auprès d’individus dont le parcours est marqué par une confrontation significative avec la distance, quelle que soit son acception. Cette nécessité méthodologique nous a conduits au choix des immigrés gaziantepli résidant dans le département d’Istanbul comme objet précis de notre recherche. Il s’agit en effet d’immigrés et de migrants originaires d’un département assez éloigné d’Istanbul, appartenant à une région orientale au niveau de développement économique et aux pratiques socio-culturelles différentes de celles dominantes à Istanbul (Bazin, 1995 ; Pérouse, 2004). Le choix du groupe originaire de Gaziantep s’explique aussi par son « image de marque » reposant en partie sur la richesse de sa tradition culinaire. Cet élément nous apparaît particulièrement important puisque l’alimentation représente, du moins à première vue, un élément important du discours identitaire individuel et collectif, largement véhiculé par une communication agressive de la municipalité de Gaziantep, bien aidée en cela par la région du sud est anatolien. Il s’agit ainsi de confronter ce discours identitaire à la réalité des pratiques et des représentations de la population gaziantepli immigrée à Istanbul.
INTRODUCTION GENERALE |