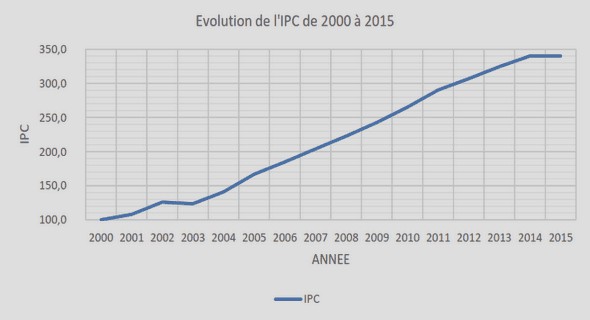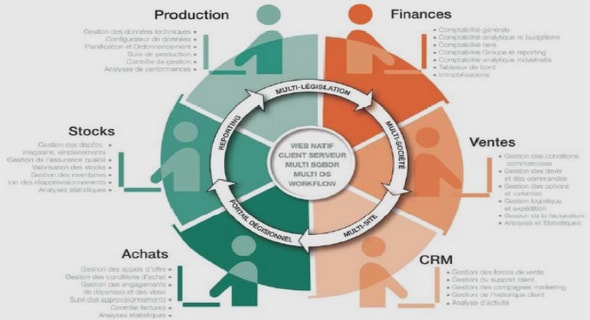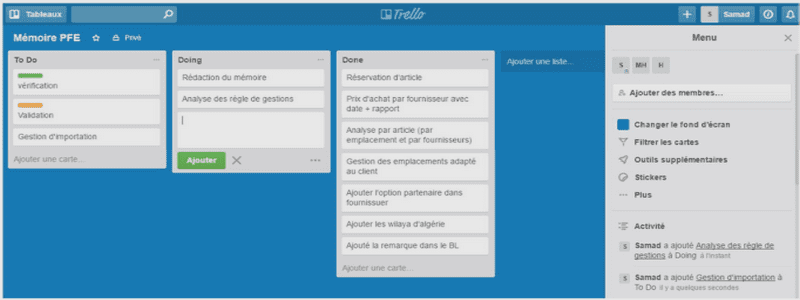Plus libres, mais plus seuls
Pourquoi agir sur les comportements
1. Aventures sur l’Orénoque, Alain KERJEAN (avec A. Rastoin), Robert Laffont, 1981.
La piste interdite de Tombouctou, Alain KERJEAN, Flammarion, 1983.
2. Le Retour du courage, Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER, Fayard, 1986.
En quittant en 1980 le confort d’une « bonne situa-tion » et d’un « avenir tout tracé de fonctionnaire » catégorie A « pour explorer les forêts de l’Orénoque » dans les pas d’Alexandre de Humboldt, ou « La piste interdite de Tombouctou » à la suite de René Caillié1, je pressentais que le monde stable et définitivement structuré pour lequel j’avais été formé était en train de s’effondrer et qu’il fallait s’armer d’autres qualités pour faire face à un monde incertain. Je crois que c’est cela que je cherchais dans mes expéditions, et que c’est ce qui expliquait l’engouement du public à ce moment-là pour l’aventure par procuration. Un petit groupe de grands voyageurs, devenus des amis, entre-tenait cet intérêt : Philippe de Dieuleveult, Gérard d’Aboville, Martine de Cortanze, Evelyne Coquet, Patrick Boivin, Patrice Franchesci… Enfants du « baby boom », nous n’avions pas connu la guerre, les priva-tions ou l’injustice qui avaient marqué les générations précédentes. Nous avions parcouru le monde et béné-ficié des avantages du progrès. De quoi se plaindre ? Lorsque je décidai en 1986 de créer une école qui for-merait ces qualités de caractère désormais si sollicitées, j’ai trouvé dans un livre court mais fort, publié la même année, une nouvelle justification de ce choix. Dans Le retour du courage2, Jean-Louis Servan-Schreiber annonçait que le courage, discrètement, était revenu parmi nous. J’ai eu envie de connaître
« JLSS », patron du magazine économique L’Expansion, et c’est grâce à lui que je trouvai un par-tenaire pour diffuser dans les entreprises un an plus tard nos premiers séminaires.
Nous venons de décrire le chaos que connaissent les entreprises, et voici que nous prétendons avec JLSS que notre époque est formidable, si l’on veut bien voir que huit cavaliers de malheur lancés à nos trousses donnent des marques d’essoufflement : la misère, la maladie, l’arbitraire, la guerre, l’ignorance, la religion, la morale, l’idéologie. Ce n’est qu’un paradoxe de plus de notre société post-industrielle, à moins que l’on démontre que c’est parce que ces oiseaux de mauvaise augure se sont éloignés qu’a pu émerger un nouveau modèle d’organisation accordant une plus grande place à la liberté, au courage, à la responsabilité.
Les quatre premiers cavaliers de malheur en voulaient à notre corps : le Quart-Monde, le chômage et la pré-carité existent, mais la misère est devenue marginale, alors qu’elle touchait au début du XIXe siècle 90 % de la population française. À ma naissance en 1951, le revenu moyen par tête d’habitant, en termes réels, était seulement le tiers de ce qu’il est aujourd’hui. La maladie recule au point que mon espérance de vie est de plus de 75 ans, alors qu’elle aurait été de 50 ans en 1940. L’arbitraire aussi a diminué dans nos démocra-ties, et nous avons le sentiment d’être des privilégiés sur une planète où l’on persécute largement en raison de sa race, de ses idées politiques ou de son orienta-tion sexuelle. Certes on a l’impression quelque fois d’être revenu à l’époque des coquins et des vilains cari-caturés par Daumier, mais il y a aussi une presse pour les dénoncer et des lois pour se défendre. Depuis l’effondrement du communisme, l’espoir d’un siècle sans guerre en Europe est raisonnable. Notre intervention dans les Balkans se fait sans déclaration de guerre, et on a l’impression, aux côtés des Américains, d’être les chevaliers blancs du bon droit contre le chevalier noir qui n’a pas encore compris que la dictature stalinienne ou fasciste n’avait plus court sur notre continent.
Les quatre autres cavaliers de malheur en voulaient à notre tête : depuis Jules Ferry, l’ignorance a reculé. Alors qu’en 1900 un écolier sur mille obtenait son bac, nos gouvernements veulent atteindre les 80 % d’une classe d’âge. Même si cela n’empêche pas des records de chômage des jeunes, et si notre système éducatif est de plus en plus décalé par rapport à la réalité, la formation est désormais une priorité reconnue. La reli-gion occupe une place centrale, depuis vingt mille ans, dans notre comportement. Elle se présente sous trois formes distinctes, rappelle JLSS : l’Église, la doctrine et la spiritualité. Les deux premières, extérieures, varient radicalement suivant les époques et les contrées. Elles ne devraient avoir comme finalité que la satisfaction des besoins spirituels de l’être humain face au destin. Mais, dans toutes les sociétés organisées, elles ont eu tendance à occuper toute la place, à éclipser, voire même évincer le spirituel. L’Église est une structure de pouvoir, avec toutes les compromissions qui en décou-lent. La doctrine, à quelque religion qu’elle appar-tienne, ne peut, au fil du temps, que devenir ou être ressentie comme un carcan de préceptes. Les dogmes sont par essence rigides, or tout bouge. Il n’est donc pas étonnant que ce prêt-à-penser se lézarde. Il fallait réduire la puissance des églises et combattre l’influence prééminente des doctrines pour faire de nous des individus autonomes.
« Dans la précipitation, on a jeté le spirituel avec l’eau bénite, ce qui semble laisser comme un sacré vide », écrit JLSS.
La laïcisation très récente des systèmes politiques et des modes de vie reste une étape fondamentale de la libération de l’homme moderne. La morale aussi n’est plus ce qu’elle était. Malgré tout, la doctrine imprègne les esprits longtemps après l’effondrement des pra-tiques religieuses.
« Il est plus facile de transformer une église en grange ou en garage que de changer dans sa tête ses principes moraux. »
D’où l’importance du dépassement des tabous sexuels avec leur cortège d’hypocrisies, de blocages et de culpabilités. Cette révolution n’est pas encore achevée et certains s’accrochent pathétiquement à l’ordre ancien, comme on l’a vu au Parlement à propos du Pacte civil de solidarité. Mais il ne sert à rien de ne pas reconnaître la réalité : l’homme est en train de se réconcilier avec lui-même. Enfin les idéologies ne sont plus de mode depuis que les dictatures fascistes et communistes ont échoué dans leur tentative de rem-placer Dieu par le culte du chef. Déconsidérés par le crime, minés par les rigidités économiques, ces sys-tèmes ont encore quelques nostalgiques à circonvenir par la « communauté internationale » et sa force de maintien de l’ordre. Où sont passés ces intellectuels marxistes qui encombraient nos sciences et notre cul-ture jusqu’au milieu des années 70 ? Certains, mal informés ou orphelins de leurs idéologies mortes, croient voir dans le libéralisme une idéologie, mais une idéologie politique structure et organise ; le libé-ralisme vise d’abord à laisser faire, c’est donc l’idéolo-gie de l’anti-idéologie.
Les cavaliers de malheurs s’éloignent, il faut s’en réjouir. Plus libres mais plus seuls, ne sommes-nous pas libérés de la peste du Moyen-Âge pour tomber dans le choléra d’un monde incertain ? Libérés de nos carcans, ne sommes-nous pas désarmés et nus pour affronter d’autres menaces, avant même d’avoir pu nous forger une carapace psycho-sociale ?
Le passage du groupedémocratie, le citoyen ne se sent pas libéré ; malgré la à l’individuprospérité, il ne se trouve pas comblé ; malgré l’assouplissement des codes moraux, le mal de vivre progresse. Ce n’est pas un échec du national et du social, au contraire, puisqu’ils ont réussi à éloigner les huit cavaliers de malheur. C’est une étape nouvelle de la conscience humaine. Servan-Schreiber ne voit pas une impasse mais des questions existentielles que se posent non pas seulement les « esprits forts » et quelques héros de théâtre, mais toute une population :
« Nous voici enfin libres d’être libres, et ça nous fait un peu peur. Aussi tout examen de la condition humaine contemporaine pose-t-il en préalable la question du courage. Non qu’il en faille aujourd’hui davantage qu’hier, c’est simplement la forme que doit revêtir actuellement le courage ; c’est parce que la vie est désormais plus facile que l’existence devient le problème. »
Nous avons enfin la capacité de mener une existence autonome, de choisir des valeurs, d’inventer notre propre doctrine, de prendre des risques, mais nous hésitons à quitter le cocon protecteur de notre confort et de nos certitudes. Valeur ringarde autrefois, le cou-rage est de retour pour affronter la solitude et le stress3.
Aujourd’hui plus qu’hier on doit vivre seul, et c’est probablement un progrès selon JLSS : « Si les temps sont venus pour moi de faire ma trace et de m’assumer pleinement, il est évident que nul ne sau-rait le faire à ma place. »
3. Lire à ce sujet La Fatigue d’être soi, d’Alain EHRENBERG, Odile JACOB, 1998 : le déprimé ne se sent pas à la hauteur des exigences qu’il s’impose.
Il nous faut redécouvrir le « À toi-même sois fidèle » de Shakespeare. Cela renvoie au psychologue social Carl Rogers qui écrit dans Le développement de la personne. Le processus de « la vie pleine » implique le courage d’exister. Il signifie qu’on se jette en plein dans le courant de la vie. Ce qu’il y a de passionnant chez les humains est que lorsque l’individu devient libre, c’est cette « vie épanouissante » qu’il choisit comme processus de devenir. À la solitude philoso-phique qui n’est pas nouvelle, s’ajoute de nos jours une solitude de vie qui confère à notre aventure, sui-vant Le retour du courage, un réalisme accentué, sinon confortable. Ce qui caractérisait un individu, ses appartenances, a perdu de sa force. Les liens se disten-dent. L’individu est prêt à larguer les amarres et à affronter l’incertitude de la haute mer. Il n’y a plus ni lieu ni rituel périodique permettant de retrouver ses proches, ses voisins. À peine un Européen sur dix a une “ Valeur ringarde autrefois, le courage est de retour pour affronter la solitude et le stress. ”
pratique religieuse régulière, et ce sont surtout les plus âgés. Il n’y a plus que les musulmans ou presque pour se définir par rapport à leur religion. On se dit Français ou Hollandais, mais l’identité nationale s’es-tompe au profit d’un sentiment d’appartenance à l’Union européenne.