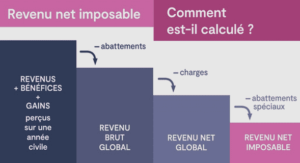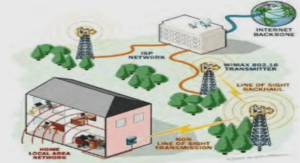Spinoza et Jonas : comment penser une éthique pour la vie par temps de crise environnementale
Le phénomène de la crise environnementale
Approche définitionnelle Qu’est-ce que l’environnement ?
Selon Michel Serres, la notion d’environnement suppose que l’homme est au centre d’un système de choses qui gravitent autour de lui, nombril de l’univers. Cette notion dans ce sens ne serait pas, selon lui, appropriée pour désigner le monde, car elle place l’homme au milieu des choses ou à leur achèvement. La nature, ce n’est donc pas ce qui nous environne, mais ce dans quoi nous sommes et sans quoi nous ne pouvons exister, « de sorte qu’il faut bien placer les choses au centre et nous à leur périphérie, ou mieux encore elle partout et nous en leur sein, comme des parasites ». Cette méfiance pour la notion d’environnement vient de son étymologie latine « virare », c’est-àdire « tourner » qui tient lui-même du terme grec gyros (cercle, tour). Le préfixe « en » s’est ajouté pour donner « environ » (entour, autour). D’environ, on est passé à environner (faire le tour) puis à l’environnement pour exprimer doublement l’action d’environner et le résultat de cette action. Durant ce processus d’évolution étymologique le radical vir a toujours exprimé la forme du tour et de l’arrondi traduisant au mieux l’idée d’alentour ou d’autour. Le rapport avec le concept de milieu fait qu’on parle de « ce qui fait le tour », « ce qui forme le tour » et « ce qui est dans l’entour ». Or dans l’idée d’environner ce qui est environné, est au centre de ce qui tourne autour. Voilà pourquoi Serres estime que cette notion ne permet pas de se rendre compte de l’anthropocentrisme qu’il conserve. Vue ainsi, il serait mieux de parler de « crise de la nature » plutôt que de crise de l’environnement. Qu’entend-t-on par « crise de la nature » ? Une recherche (très) rapide fait remonter le concept de « crise de la nature » à Montesquieu ; Lettres Persanes, 39. Il l’utilise pour décrire des grands événements terrestres (tremblement de terre…), signes annonciateurs de la naissance d’hommes extraordinaires « il me semble, écrit l’un de ses personnages, qu’il y a toujours des signes éclatants, qui préparent la naissance d’hommes extraordinaires ; comme si la nature souffrait une espèce de crise ». Ce phénomène auquel Montesquieu fait ironiquement allusion par le concept de « crise de la nature », est différent d’une « crise de la nature » au sens actuel qui désigne une situation d’épuisement de la nature. Pour Michel Serres, parler de « crise de la nature » permet de sortir du vaste champ de « ce qui environne » avec ce qu’il a d’anthropocentré et de considérer singulièrement le monde non humain de la nature. La même réserve est faite par Gérald Hess qui estime aussi que le terme d’environnement renvoie à ce qui environne l’homme, au sens où l’environnement est réductible à l’homme ; puisque quand il s’agit de faune, on parle plutôt de milieu. Or en réalité, tous les êtres vivants ont un milieu qui leur est propre, leur environnement. Mais le fait qu’au sens ordinaire l’environnement renvoie à ce qui environne l’homme, l’incline à préférer le vocable de « nature » qu’il trouve moins équivoque, car il ne préjuge pas d’une séparation a priori entre une nature humaine et non humaine. Au contraire écrit-il, la notion de nature suggère une communauté d’êtres et l’idée que les hommes font partie intégrante de cette communauté. Toutefois, bien qu’ayant un caractère polysémique, le terme d’environnement est couramment employé aujourd’hui pour désigner les conditions naturelles (physiques, biologiques et chimiques) ainsi que les ressources naturelles biotique (faune, flore) et abiotique (air, eau, sol) et leurs interactions réciproques susceptibles d’agir sur tous les organismes vivants et leurs activités. Finalement on retient que le mot environnement est parti de l’idée de tourner à celle d’exprimer la forme d’anneau ou de contour, pour désigner en fin de compte le mouvement et le contenant ainsi que le contenu des éléments d’un milieu donné. Sous cet angle, l’environnement intègre – et est intégré dans – l’ensemble des éléments physiques, chimiques ou biologiques, naturels qui déterminent la présence et l’existence des êtres vivants. C’est donc indifféremment que nous emploierons les expressions de « crise de la nature » et de « crise de l’environnement », pour désigner le phénomène de dégradation de la nature, donc des conditions de vie des êtres naturels, en l’occurrence, celles des êtres humains. Selon le dictionnaire La philosophie de A à Z, le mot crise, du grec krisis, désigne au départ un moment d’instabilité et de trouble qui appelle une prise de décision immédiate, fondée sur un jugement rapide et approprié (sagacité). Par la suite, le terme, utilisé principalement dans le domaine médical, est devenu dans l’usage courant synonyme de situation périlleuse et déterminante. Dans son étude « La problématique de la crise dans la philosophie de Robert Misrahi », Véronique Verdier explique que le concept de crise dans la philosophie de R. Misrahi revêt une réalité qu’il ne faut pas réduire à sa négativité. Certes, G. HESS, Éthiques de la nature, Puf, , p.. www.techno-science.net, Vie et terre. une crise indique une contradiction entre un état actuel d’une chose et l’exigence d’une situation qui lui serait préférable, assurément, la crise désigne le point culminant d’une tension ; mais, selon R. Misrahi qu’elle commente, la crise ne constitue pas une simple dégradation dans la mesure où elle signifie nettement qu’une limite extrême est atteinte : celle de l’intolérable. La crise n’est donc pas une fatalité, mais un moment crucial, qui permet de prendre conscience qu’une limite au-delà de laquelle les choses ne peuvent plus continuer à l’identique est atteinte – elle porte avec elle un sentiment de dénouement imminent puisqu’elle place celui qu’elle atteint face à une alternative : se laisser déborder par elle, ou tenter de réagir ? Les questions qui s’imposent face à une crise étant toujours : comment en sortir ? Et comment faire en sorte de ne pas aller de crise en crise ?. Si la crise est un révélateur d’une situation désastreuse qui indique que l’état actuel est au bord de la ruine, elle est alors l’indicateur qui oblige à changer de perspective et de se reconstruire suivant d’autres principes. Cette compréhension du concept de crise, est celle qui guide l’esprit des réflexions qui se développent en rapport avec la crise environnementale, puisqu’il s’agit, dans ces réflexions, non pas de considérer la crise comme une fatalité, sinon la réflexion n’aurait plus lieu d’être, mais comme un indicateur que quelque chose ne va plus dans nos vieux modèles de penser et d’agir ; et qu’il faut un bouleversement total : une conversion des pensées et des manières d’agir. 1.2 Crise de la nature Parler de crise, suppose donc au préalable un état « sain », qui se serait dégradé progressivement, par l’intrusion dans le corps en crise, d’un phénomène parasite, qui bouleverse considérablement l’état de fonctionnement d’origine. Par conséquent dans le domaine de la nature, la crise écologique désigne une dégradation largement avancée de la biosphère. Elle se traduit par le dérèglement alarmant des phénomènes naturels, impacté par l’action humaine. La manifestation inhabituelle des choses qui, jusque-là, semblaient aller de soi, que l’on pouvait ignorer : « l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons […] les prairies ou les forêts qui nous entourent, tout cela semblait devoir être toujours là, ressources inépuisables, sur lesquelles nous avions peu de pouvoir ». Elle désigne l’irrégularité observée dans l’apparition des phénomènes qui, autrefois se produisaient avec une régularité quasi constante. C’est aussi le déclin de la diversité du vivant. V. VERDIER, Robert Misrahi pour une éthique de la joie, op. cit., pp.63-64. C. LARRERE, Les philosophies de l’environnement, Paris, Presses universitaires de France, 97, p.. Cette situation de dégradation de la nature, d’après les environnementalistes, est liée à la nouveauté des formes de l’action humaine, occasionnée par une représentation erronée de la nature. On apprend dans le livre de Christian Godin, La haine de la nature, que la Terre a connu déjà cinq extinctions massives, dont la plus célèbre à la fin du crétacé et au début de l’ère tertiaire, il y a 65 millions d’années, est la dernière. L’extinction d’espèces serait un processus naturel au même titre que l’apparition de la vie elle-même. S’il est vrai, remarque Virginie Maris, que le déclin de la biodiversité s’est accéléré à mesure qu’augmentait la puissance technologique dont disposent les êtres humains, force est de reconnaître que les disparitions d’espèces sont liées à la loi de la sélection naturelle. Pendant la plus grande partie de la Préhistoire, globalement des origines à l’apparition d’homo sapiens, les milieux ont été relativement peu affectés, l’évolution de l’homme, d’abord biologique, mais surtout culturelle, avec l’accumulation des acquis techniques et idéologiques, lui a permis par la suite d’exercer une influence croissante sur l’environnement ( ). Toutefois, accordons-nous à dire que personne ne nie que des espèces aient disparu avant l’apparition de l’homme, c’est plutôt l’accélération de ce processus, qui est attaché de façon générale aux activités anthropiques. Pourquoi dit-on actuellement que la nature est vulnérable ? Lorsque Rousseau écrit en 55 le Discours sur l’origine l’inégalité, il n’est pas encore question des problèmes philosophiques et moraux que pose le développement technique, mais pourtant, il observe clairement que : la quantité d’arbres et de plantes de toute espèce, dont étaient remplies presque toutes les îles désertes qui ont été découvertes dans ces derniers siècles, et par ce que l’histoire nous apprend des forêts immenses qu’il a fallu abattre par toute la terre à mesure qu’elle s’est peuplée ou policée.[…] La destruction du sol, c’est-àdire la perte de la substance propre à la végétation doit s’accélérer à proportion que la terre est plus cultivée et que les habitants plus industrieux consomment en plus grande abondance ses productions de toute espèce (). Rousseau décrit clairement dans ce propos le déclin de la diversité du vivant et l’appauvrissement des sols causé par l’occupation spatiale des hommes. Comme quoi, l’homme par son organisation a de tout temps modifié la nature. Ou peut-être devrait-on voir V. MARIS, Philosophie de la biodiversité : petite éthique pour une nature en péril, Paris, Buchet-Chastel, , p. 55. J.-J. ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les arts Discours sur l’origine de l’inégalité. Chronologie et introduction par Jacques Roger., Paris, Garnier-Flammarion, 71, p.3. là les prémisses de la crise, mais que l’homme n’a pas su prendre la mesure de la chose dès ses débuts. Pour analyser l’état de la nature, Jonas part d’un constat tiré d’une comparaison entre l’état de la nature avant l’ère technologique et industriel et celui de l’ère technologique et industrielle. Sa démarche est analogue à celle du médecin, qui ausculte son patient, établit un diagnostic et formule un pronostic vital. Examiner la nature dans cette perspective, c’est l’ausculter, pour en diagnostiquer les symptômes qui révèlent les maladies dont elle est infectée afin de déterminer la cause, ainsi que le remède capable de la sauver de la destruction vers laquelle l’inclinent inexorablement les maux qui l’affectent. Pour réaliser ce diagnostic, on suppose un état d’être de la nature qui correspond à la « santé ». Même si un individu bien portant est un malade qui s’ignore selon une expression de Jules Romain devenue populaire, nous pouvons dire que tant qu’une maladie n’a pas commencé à causer des désagréments à l’individu, ce dernier est apparemment en bonne santé. Les symptômes, comme le dit Sylvain Pourchet dans la préface de L’euthanasie par compassion ? constituent la première source d’inconfort pour le malade et d’inquiétude pour l’entourage. Par conséquent, la consultation médicale, exceptée la préventive, est souvent la conséquence d’un mal être. On a donc supposé que cet état « sain » fut celui des anciens, état dans lequel la nature fut considérée comme en équilibre, capable de se régénérer d’elle-même, puissante et invincible. En effet, nombreux sont les éthiciens de l’environnement qui, comme Hans Jonas, considèrent que la naissance de la science moderne au XVIIe siècle est le tournant à partir duquel la fracture dans la relation de l’homme et de la nature s’opère. Avant cet évènement, ils considèrent qu’aucun changement majeur n’est intervenu dans le processus de l’évolution de la nature qui soit imputable aux cultures précédentes. La naissance de la science moderne a donc déclenché une dynamique de développement qui modifie de façon profonde le commerce de l’homme avec la nature. Jonas commence par exposer la relation de l’homme à la nature avant la science moderne, et montre que les techniques qui ont cours aux siècles antérieurs n’ont pas engendré des grandes irrégularités dans le système atmosphérique. Au rythme où vont les choses, certains spécialistes, affirment que nous sommes en train d’assister à la sixième extinction. Selon les chiffres donnés par Christian Godin, « 50 à 70 espèces disparaissent chaque jour. Le processus s’auto-entretient : du fait de la solidarité objective entre espèces, les extinctions sont des coextinctions, comme des dominos, les espèces tombent les unes après les autres ». L’accélération du développement technologique (si l’on se place du point de vue de la diversité biologique), ne permet plus de distinguer les disparitions d’espèces qui résultent d’un processus naturel (à l’exemple de celui décrit par Darwin), et celles qui résultent des processus technologiques. Selon Virginie Maris, il n’y a plus de doute que le rythme actuel des extinctions soit particulièrement élevé. L’étude des fossiles, montre que le taux d’extinction était relativement stable dans le passé géologique. Il s’échelonne, selon les groupes taxinomiques, d’une extinction pour un million d’espèces par an à une extinction pour dix millions d’espèces par an. Ce taux est qualifié de taux naturel d’extinction. Il se distingue des taux d’extinctions extraordinaires qui marquent les transitions entre les grandes périodes géologiques, les épisodes d’extinctions de masse. Or aujourd’hui, continue-t-elle, le taux d’extinction estimé selon les différentes méthodes, parmi lesquelles se trouvent les plus optimistes, est de cent mille fois plus élevé que le taux naturel, ce qui correspond à un sixième épisode d’extinctions de masse. À la vitesse où vont les choses, si la tendance ne s’inverse pas ou du moins ne se stabilise pas, la sixième extinction, à la différence des cinq précédentes, serait une tragédie absolue, puisqu’elle provoquerait la quasi-extinction de l’humanité. La question de la disparition des espèces nous semble décrire au mieux l’idée de crise de la nature, car elle représente l’appauvrissement croissant de la biodiversité, des différentes forces qui la constituaient. Or cet appauvrissement comme nous pouvons le déduire des travaux de Darwin, résulte de plusieurs facteurs. L’un d’eux est l’explosion démographique humaine dont le corrélat est l’explosion des activités anthropiques. Par ses activités industrielles, l’homme introduit dans la nature de nouveaux agents chimiques, des gaz toxiques qui mettent à mal la santé des organismes vivants. Rousseau aurait donc eu raison de croire qu’on ferait aisément l’histoire des maladies humaines en suivant celle des sociétés civiles. Pour résumer disons avec Virginie Maris, que « Par sa volonté de maîtriser et d’asservir le monde naturel, par son insatiable désir de terre et de richesses, par son obsession de la croissance, l’homo oeconomicus contemporain précipite le monde naturel dans un chaos […] Le diagnostic est sans appel : l’humanité est la cause d’une crise écologique sans précédent » : les catastrophes naturelles à répétition sont les signes les plus évidents d’une fragilité de la nature. Symptômes d’une lente mais inexorable agonie. C. GODIN, La haine de la nature, op.cit., p.. V. MARIS, Philosophie de la biodiversité, op.cit., pp.43-44. Id., p.43. Il est difficile d’affirmer qu’il fut un temps où l’action de l’homme n’eut pas d’incidence sur la nature. Comme le rappelle Virginie Maris, dès les débuts de la vie humaine, les activités aussi courantes que se nourrir, boire, se protéger, se loger, se déplacer, et se reproduire, impliquent que l’homme agisse sur l’environnement, de même qu’elles ont été et demeurent encore conditionnées par l’environnement. Toutefois, si personne ne nie cette évidence, force est de reconnaitre que c’est sous le règne de la technologie, que la vulnérabilité de la nature se fait jour, cette « vulnérabilité qui n’avait jamais été pressentie, avant qu’elle ne se soit manifestée à travers les dommages déjà causés », conduit au concept et au début d’une science de l’environnement, de l’écologie. C’est donc la découverte que la production des phénomènes naturels n’est pas tout à fait indépendante de l’agir humain, qui révèle la fragilité de la nature. La nature sous le règne de la technologie n’est plus ce qu’elle était : elle est de moins en moins la grande puissance mythique sur laquelle l’homme n’a aucune prise et qui le renvoie inexorablement aux limites de son pouvoir. Si les découvertes scientifiques et techniques sont un processus naturel dans lequel l’homme s’est trouvé entraîné par la nécessité profonde de se prémunir contre les dangers qu’il rencontre dans la nature, et pour se créer des conditions de vie humainement commodes, il apparaît aujourd’hui que ce qui était une nécessité vitale a pris des proportions extraordinaires qui tournent au cauchemar. Selon les propos de Jonas, c’est le rêve d’un monde sans misère, qui aurait conduit l’homme à ne pas fixer des limites au développement du progrès. Citant Francis Bacon, Jonas dit que ce dernier « proclama que la connaissance est un pouvoir, et que c’est le but de la connaissance de faire progresser la condition de l’homme sur la terre, de conquérir la nécessité et la misère humaine en assujétissant la nature à son usage le plus complet ». Cette Déclaration de Bacon, fait écho à l’appel de Descartes qui ayant expérimenté quelques connaissances en physique constata combien l’application pratique des connaissances est fort utile à la vie. À ce propos, Descartes déclare que : au lieu de cette philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent aussi distinctement…, nous les pourrions employer à même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices… mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien, et le fondement de tous les autres biens de cette vie (). La connaissance des propriétés des choses, des lois par lesquelles elles produisent des effets, est le moyen par lequel l’homme acquiert le pouvoir de les manipuler de sorte à produire des effets qu’il souhaite et qu’il estime bénéfiques pour lui. L’amélioration continue de ses commodités de vie, passe inévitablement par la modification du milieu naturel (déforestation, assèchement des zones humides, aménagements ruraux etc. et par l’utilisation des ressources naturelles : exploitation du charbon, du pétrole, des mers, etc.) Aujourd’hui, on constate que les ressources naturelles ne sont pas aussi inépuisables qu’on l’a cru dans le passé. L’utilisation intensive de ces dernières et les transformations sans cesse de l’environnement, sont actuellement la cause du mal qui affecte la nature et menace la qualité de vie sur terre. Hans Jonas réagit à cette situation, et écrit un livre devenu crucial dans l’histoire de la pensée. Ce livre met en cause le pouvoir de l’homme sur la nature notamment avec l’essor de la technologie. Pour lui, ce n’est pas que la technique est apparue brusquement dans la vie de l’homme, elle y a toujours constitué son mode d’existence, mais la modalité de son usage s’est considérablement transformée. Comme le dit Lucrèce, « […] Lois, armes, routes, vêtement, et toutes les autres inventions de ce genre, et même celles qui donnent à la vie du prix et des plaisirs délicats, tout cela a été le fruit du besoin, de l’effort et de l’expérience ; l’esprit l’a peu à peu enseigné aux hommes dans une lente marche du progrès38 ». Certes, l’homme agit et a toujours agi dans la nature, mais son mode d’action s’est transformé sous le règne de la technologie. Pour la définir succinctement, disons que la technologie, c’est le résultat de l’effort du travail humain sur les objets, plus précisément, c’est la connaissance des propriétés de la matière, leurs manipulations et applications dans des domaines variés de l’existence humaine. En un sens convenu, écrit Jonas, la technologie désigne la conception et la construction d’artefacts matériels complexes destinés à un usage humain […] La raison sous-jacente en est toujours l’usage au bénéfice d’un utilisateur, c’est-à-dire au bénéfice d’un supposé bien humain, dût-il même s’agir du fait que certains soient tués par d’autres, ou beaucoup par quelques-uns . Le titre du premier chapitre du Principe responsabilité « La transformation de l’essence de l’agir humain » est très évocateur. Ce titre énonce clairement que l’essence de l’agir humain s’est transformée. Cette affirmation pose donc qu’il y avait une manière d’agir propre à l’homme ancien qui n’est plus celle de l’homme actuel. Selon H. Jonas, entre la technique moderne et la technique ancienne, il y a une différence de degré qui est telle que la technique moderne est destructrice plutôt que bienfaisante comme l’était la technique ancienne. Avant notre époque, il semblerait que l’agir de l’homme dans la nature, était essentiellement de nature superficielle et sans pouvoir de perturbation sur l’équilibre arrêté. Bien que l’écart entre les deux formes de techniques soit abyssal, l’auteur observe que ce regard de l’homme sur ces interventions dans la nature n’était pas exact, car un « regard rétrospectif découvre que la vérité [sur les actions de l’homme] ne fut pas toujours aussi inoffensive40 ». Mais même en affirmant que les interventions de l’homme dans la nature ont toujours été offensives pour la nature, l’auteur de ce propos pointe plutôt du doigt la technique moderne qui, visiblement, conduit dangereusement vers une extinction de la vie humaine. Michel Serres affirme que nous faisons « face à un problème causé par une civilisation en place depuis maintenant plus d’un siècle, elle-même engendrée par des cultures longues qui la précèdent ».
Le paradoxe du progrès technique
Hans Jonas affirme clairement que « le danger a son origine dans les dimensions excessives scientifique-technique-industrielle42 ». Ainsi déclare-t-il : « nous vivons dans une situation apocalyptique, c’est-à-dire dans l’imminence d’une catastrophe universelle, au cas où nous laisserions les choses actuelles poursuivre leur cours43 ». En effet, l’utilisation intensive des ressources naturelles est cause de la pollution de l’air, du réchauffement climatique, de l’épuisement des énergies fossiles, du déséquilibre des écosystèmes. Or, tous ces maux conduisent inexorablement vers une destruction totale de la vie humaine. Ce changement ne va pas dans le sens voulu par le projet de la science, mais dans le sens inverse. La critique qui est adressée ici à la technologie est analogue à celle que Rousseau adresse à l’état civil, dans le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes. De même que le passage de l’état sauvage à l’état civil qui se caractérise par la propriété privée est pour l’origine de tous les maux de l’homme, de même, pour Jonas, le passage de la technique archaïque à la technique moderne qui se caractérise par le degré de puissance des outils modernes, est l’origine de la crise de l’environnement. Selon Rousseau, la perfectibilité qui est la faculté propre de l’homme est, pour ainsi dire, la source du mal humain. Il serait triste dit-il, pour nous d’être forcés de convenir, que cette faculté distinctive, [perfectibilité] et presque illimitée, est la source de tous les malheurs de l’homme ; que c’est elle qui le tire, à force du temps, de cette condition d’origine, dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents ; que c’est elle qui faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même et de la nature (44 ). L’interrogation qui précède ce propos dans le texte, « pourquoi l’homme seul est-il sujet à devenir imbécile45 », laisse entrevoir clairement la thèse de l’auteur. La perfectibilité est en réalité dégénérescence puisqu’elle déprave ce que la nature a su si bien faire. De même, on lit dans Le principe responsabilité que le méliorisme étant la source de la démesure, est la cause de la crise environnementale. Ainsi, dit-il, « à l’immodeste fixation de ses buts, qui fait fausse route tant du point de vue écologique que du point de vue anthropologique […] le principe responsabilité oppose la tâche plus modeste que nous ordonnent la crainte et le respect 46 ». Ce que nous voulions faire ressortir à travers cette analogie, c’est que finalement le progrès sonne comme une dégénérescence, puisqu’il dégrade la qualité des conditions de vie humaine. Et risque même de détruire carrément la vie. La dynamique mondiale du progrès technologique semble oublier la nécessité des équilibres naturels, ce qui fait dire à Jonas qu’elle contient en elle un utopisme implicite par sa tendance, si ce n’est par son programme47. Il faut alors poser la question : qu’est-ce qu’une utopie ? Généralement ce mot s’emploie pour désigner un idéal abstrait, une réalité transcendante à toute réalité donnée. Définie comme une chimère, un âge d’or où coulent à profusion le lait et le miel pour l’homme, l’utopie désigne un projet dont les conditions de réalisation sont nulles, donc impossibles à réaliser. Selon Hans Jonas ces idéaux abstraits exprimaient simplement les plus vieilles espérances ou les plus vieux rêves de l’humanité, dont le plus vieux, est d’échapper à la malédiction de la mortalité. La condition la plus misérable de l’homme, et contre laquelle il n’a aucun remède comme on peut le lire dans le . chant d’Antigone, où l’homme est présenté certes comme le plus ingénieux de tous, mais vulnérable cependant face à la mort : « contre la mort seule, il n’aura jamais de charme permettant de lui échapper, bien qu’il ait déjà su contre les maladies les plus opiniâtres imaginer plus d’un remède48 ». Si l’homme est armé contre tout sauf contre la mort, alors son défi le plus vieux serait aussi de s’armer contre la mort. Dans la perspective de Hans Jonas, l’utopie, ou ce qu’il appelle la dérive intrinsèquement utopique de nos actions, c’est la possibilité que ce qui n’était que simple rêve, soit rendu disponible par les avancées de la science. Autrement dit, que ce qui n’était qu’un idéal abstrait, soit traduit aujourd’hui en une possibilité concrète grâce aux avancées technologiques. Ces souhaits qui autrefois n’étaient rien de plus que des chimères, sont actuellement des projets réalisables grâce aux prouesses scientifico-techniques. L’utopie ici, telle qu’elle est présentée, est la croyance que le progrès technologique fera sortir l’homme de la misère et de l’aliénation. Le bien-être matériel est ainsi posé, selon l’hypothèse ontologique du matérialisme, comme la condition impérieuse de la libération du véritable potentiel humain. En parlant du marxisme, Jonas souligne que, « dès le début, il a célébré la puissance de la technique, dont il attend le salut en union avec une collectivisation49 ». Mais cette foi au progrès devient utopisme chez Jonas, parce qu’il découvre avec stupeur que bien loin d’apporter la libération de tout le potentiel humain, le progrès aliène davantage, puisque, ne pouvant plus contrôler le pouvoir qu’il a lui-même inventé, l’homme se trouve exposé à la merci de ce pouvoir. « Le pouvoir s’est rendu maître de lui-même, alors que sa promesse a viré en menace et sa perspective de salut en apocalypse50 ». Au fur et à mesure que se perfectionnent les sciences et les technologies, l’homme devient de plus en plus misérable. Il semble dès lors que le méliorisme est un espoir trompeur : « puisqu’il n’y a pas de fin ici, une « utopie » du perpétuel dépassement de soi vers un but infini 51». La technique tant vantée et appelée de tous nos vœux, apparaît être un poison dangereux dont il faut modérer la consommation, à défaut de l’arrêter. Croyance d’autant plus utopique qu’avec le progrès technologique, les maux auxquels l’homme est confronté seraient beaucoup plus importants que ceux auxquels il fut confronté sans progrès technologique. Ce n’est donc pas sans peine, dirait Rousseau, que l’homme est parvenu à se rendre si malheureux. En comparant les immenses progrès technologiques des hommes avec les vrais avantages qui en résultent pour le bonheur humain, Rousseau serait frappé de l’étonnante disproportion qui règne entre ces choses et déplorerait davantage l’aveuglement de l’homme qui, pour nourrir son fol orgueil et cette vaine admiration qu’il a de lui-même, le fait courir avec ardeur après toutes ces misères. Hans Jonas met donc en garde contre cette foi au progrès technique que le marxisme appelle de tous ses vœux. Allié à la technique, une des éthiques à perspective d’avenir globale qui existe déjà, le marxisme, a précisément élevé l’utopie au rang d’un but explicite. […] Puisque celui-ci a en sa faveur les plus anciens rêves de l’humanité et qu’il semble également disposer maintenant avec la technique des instruments permettant de traduire ce rêve dans une entreprise, l’utopisme qui jadis fut vain, est devenu la plus dangereuse des tentations – précisément parce que c’est la tentation la plus idéaliste – de l’humanité actuelle (52 ).
Introduction |