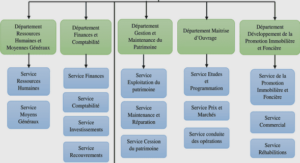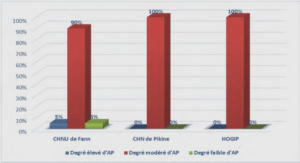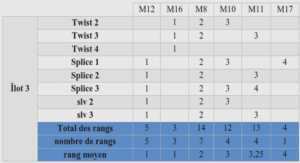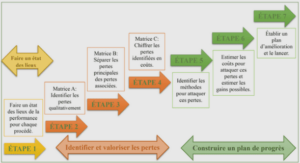La rente différentielle de RICARDO suppose la loi de rendement décroissant des facteurs : le capital, le travail et la terre
RICARDO (1817) a avancé l’idée de l’état stationnaire. Il a présenté d’intéressantes réflexions sur les relations entre la rareté des ressources et la croissance économique. RICARDO pensait que les terres les plus fertiles étaient mises en culture les premières, de sorte que la croissance économique exigeait de terres de moins en moins productives. Ces rendements décroissants de la terre, du travail et du capital entrainaient un ralentissement du processus de croissance. RICARDO s’appuie sur les travaux de MALTHUS qui a dégagé ce qui a été appelé par la suite la « loi de la rente différentielle ». La rente différentielle suppose la loi du rendement décroissant des facteurs et la fixation du prix sur la base du coût marginal.
La valeur d’une denrée quelconque n’est jamais réglée par la plus petite somme de travail nécessaire pour sa production, cette valeur dépend au contraire de la plus grande quantité de travail dans les circonstances les plus défavorables. Ainsi, le salaire ou le prix du blé dépendra du coût en travail sur les terrains les plus mauvais. (RICARDO, 1817). RICARDO explique que soient les terrains a, b, et c de qualités décroissantes. Le prix se fixe dans les conditions du terrain c. Le propriétaire du terrain c ne touche pas de rente. Si pour une raison ou pour une autre on n’exploite plus le terrain c, le prix se fixe sur le coût de b, b ne touche plus de rente, dans l’ensemble la rente diminue. La rente s’explique donc par la différence des qualités des terrains, et c’est l’avantage que reçoivent les propriétaires des terrains de meilleures qualités.
La rente s’expliquerait ainsi selon RICARDO par la nature (don de la nature) mais non pas par les rapports sociaux (fruits du travail).
La théorie de la population de MALTHUS : la rareté des ressources naturelles constitue un frein pour la croissance économique
Selon le Rapport Meadows sur les limites de la croissance, publié en 1972 : il y avait une contrainte économique absolue à la croissance. L’accroissement de la population conjugué à la limitation des terres et des ressources disponibles devait conduire inéluctablement sous l’effet du processus d’accumulation du capital à un état stationnaire. La poursuite du rythme de croissance économique et démographique fait peser des menaces graves sur l’état de la planète et sur la survie del’espèce humaine. Seul un « état d’équilibre » avec le maintien d’un niveau constant de population et de capital permettrait d’éviter la catastrophe qui guette l’humanité. Connues comme la théorie de la « croissance zéro », ces propositions sont qualifiées de malthusiennes. Seul le ralentissement, voire l’arrêt de la croissance économique, pourrait permettre de maintenir durablement l’activité. (Rapport Meadows sur les limites de la croissance, 1972). MALTHUS, célèbre par le parallèle qu’il établit entre la possibilité d’accroissement géométrique de la population et l’accroissement seulement arithmétique dans le meilleur des cas de la nourriture. La nature n’est pas généreusemais parcimonieuse. La loi de rendement décroissant du sol, la rente s’explique aussi par la parcimonie de la nature. Il répand l’idée selon laquelle la rareté des ressources naturelles, face à une population croissante. Il en conclut que compte tenu de limites naturelles, notamment des terres cultivables, la croissance démographique entraine un déclin du capital et de la production, et par conséquent de la croissance. (MALTHUS, 1798)
L’émergence de l’économie de l’environnement
Alors que l’économie politique a trois siècles et demi, l’écologie est une science récente : les concepts d’ « écologie », de « biosphère » et d’ « écosystème » datent de 1860, des années 1920 et 1935. L’écologie comme mouvementsocial ne se développe qu’après la seconde guerre mondiale, et le mot « environnement » au sens qui nous intéresse n’est entré dans la langue française que depuis les années 1960. Ce n’est donc que tout récemment que l’économie de l’environnement s’est constituée comme champ particulier à l’intérieur de l’économie politique.
Dans un premier temps, l’économie politique, à la recherche de la recette de la croissance équilibrée et indéfinie, s’est d’abord heurtée au fait que les ressources naturelles ne sont inépuisables, et que ce caractère limité des ressources naturelles allait inéluctablement mener à la fin de la croissance (« l’état stationnaire »).
Dans un deuxième temps, l’économie politique s’est heurtée à la montée des pollutions d’abord appréhendée comme des « externalités négatives », et elle dut reconnaitre que les mécanismes de marché n’intégraient pas spontanément toutes les utilités et les désutilités externes produites par l’activité d’un agent économique. Tout un courant de pensée, de PIGOU à COASE, s’est alors efforcé de trouver les moyens « d’internaliser les externalités » dans le cadre marchand. Dans un troisième temps, au milieu des années 1960, des économistes ont commencé à prendre conscience qu’une approche véritablement systémique (à vrai dire : écologique) s’imposait.
Le début des années 1970 a constitué en quelque sorte un seuil décisif avec la première « conférence mondiale sur l’environnement humain » (conférence de Stockholm 1972), et surtout avec le rapport « Halte à la croissance » par le Club de Rome (The limits to growth, 1972). En effet, cette fois-ci, ce sont l’ensemble des facteurs qui sont pris en compte dans une approche systémique (épuisement des ressources naturelles, accumulation des déchets et pollution) pour arriver à la conclusion que « cela ne pourra durer indéfiniment comme ça ».
Au total, après avoir beaucoup « phosphoré », les économistes n’ont plus guère le choix qu’entre une alternative simple : « libéralisme économique » ou « développement durable ». (PLAUCHU V., 2011).
Dès les années 1960, des économistes et des écologistes ont émis des doutes sur la pertinence du Produit National Brut (PNB) comme mesure du bien-être d’un pays. En effet le non marchand n’est pas pris en compte, en particulier tout le travail domestique ; les prélèvements sur la nature ne sont pas comptabilisés ; la production de sens, de relation, de qualité de vie ignorée. (VIVIEN D., 1994).
Protection et respect de l’environnement : mesures incitatives et responsabilisation des acteurs
Ce second chapitre consiste en premier lieu à affecter une valeur monétaire aux actifs environnementaux : il faut mettre les biens et services environnementaux au même niveau que les biens marchands pour influencer les comportements des agents économiques. Pour ce faire, il faut leur donner une valeur économique afin d’améliorer leur utilisation. La notion de dommages ou de bénéfices à l’environnement est tout à fait centrale en économie de l’environnement et que sans « internalisation » des effets externes dans le calcul économique, non seulement la détérioration de l’environnement va se perpétrer, mais en plus, nulle gestion économiquement efficace ne sera possible. Or faire entrer les dommages ou les bénéfices dans la sphère économique implique de leur affecter une valeur monétaire (BARDE J-P, 1992). Les instruments économiques étant destinés à modifier les modes de production et les habitudes de consommation, ils peuvent aussi être utilisés pour favoriser un développement respectueux de l’environnement (OCDE, 1993).
En second lieu, ce chapitre expose une revue théorique du développement durable.
Selon le PNUD (1992), le développement durable a pour vocation de réconcilier l’Homme, la nature et l’économie à long terme et à une échelle mondiale. La finalité du développement durable est d’assurer le bien-être de tous êtres humains qui vivent aujourd’hui et vivront demain sur la terre, en harmonie avec l’environnement dans lequel ils évoluent. La conception la plus courante du développement durable est celle de l’articulation de trois perspectives : économiques, environnementales et sociales. Ainsi, ce second chapitre est subdivisé en deux sections. La première section expose la valorisation monétaire des actifs environnementaux. Et la deuxième montre une revue théorique sur l’opérationnalisation du développement durable.
Valorisation monétaire des biens et services fournis par l’environnement :
D’après le rapport sur « L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire » (2003), les services écosystémiques sont considérés comme les bienfaits que les écosystèmes procurent aux êtres humains. Dans ce contexte, la biodiversité n’est pas seulement un don de la nature mais une ressource valorisable, que l’on a donc tout intérêt à la préserver. En réalité, on fait le pari que la promesse de gains peut rendre raisonnable. Si la biodiversité est un bien marchand, les pays ont la perspective de tirer bénéfice de leur diversité biologique ; On peut imaginer qu’ils vont faire des efforts afin de protéger et d’éviter les gaspillages. Evaluer l’environnement sous l’optique économique revient à mettre un prix sur ce qui n’a pas de prix. Car l’absence de prix signifie : soit les écosystèmes étaient exploités comme des dons de la nature et entrainent gratuitement dans l’économie, soit ils étaient protégés pour des raisons patrimoniales ou de rareté absolue et leur prix n’était pas mesurable. Les biens et services environnementaux sont à allouer d’une part dans l’économie et, d’autre part, entre l’économie et l’environnement. (REID W., 2003).
Valorisation des biens et services fournis par l’environnement
Il y a tout d’abord une fonction économique, par exemple, l’emploi d’eau se répartit entre production hydro-électrique, eau potable, eaud’irrigation, eau industrielle. Il y a ensuite la fonction écologique : toute l’eau ne peut pas être accaparée par des emplois économiques, mais doit aussi être réservée à des emplois écologiques liés à l’existence au fonctionnement des écosystèmes. Ainsi, la valeur économique de l’environnement dépasse la seule valeur d’usage des biens et services de la nature (leur valeur, dans l’immédiat, le service rendu) et doit intégrer la valeur attachée, soit à un usage futur, même optionnel, soit à un non-usage de l’environnement. (MOONEY A., 2003)
Le concept de valeur
Deux courants sont principalement à mettre en exergue : le concept de valeur selon les Classiques et le concept de valeur selon les Néoclassiques.
Nous avons regardé le travail comme le fondement de la valeur des choses et la quantité de travail nécessaire à leur production comme la règle qui détermine les quantités respectives des marchandises qu’on doit donner en échange pour d’autres. La valeur échangeable des objets produits est proportionnée au travail employé à leur production, et non seulement à leur production immédiate mais encore à la fabrication des instruments et machines nécessaires à l’industrie qui les produits(RICARDO, 1817). Selon les Classiques, la valeur d’un bien économique peut être mesurée par la quantité de travail nécessaire ou fourni pour son élaboration. En définitive, c’est la quantité de travail incorporé dans le bien qui détermine sa valeur. On parle alors de valeur-travail. Par contre, du point de vue des Néoclassiques, il est admis que non seulement la quantité de travail incorporé dans le bien ne permet pas d’évaluer correctement la valeur d’un bien, mais en outre, il est assez difficile d’estimer une telle valeur, en particulier du point de vue monétaire. Au contraire, la valeur d’un bien semesure par le degré de satisfaction d’un besoin que sa consommation peut procurer. En réponse aux besoins, le consommateur cherche des objets extérieurs pour se satisfaire. Un objet est dit utile lorsqu’il est apte à satisfaire un besoin. Deux notions sont importantes à ce niveau. Premièrement, le bien doit être utile, c’està dire, servir à quelque chose ; et que ensuite, saconsommation doit permettre de satisfaire ou du moins contribuer à la satisfaction d’un besoin déterminé. Le concept de valeur-travail est dépassé et remplacé par celui de valeur-utilité : plus un bien a de l’utilité, plus il a de la valeur. Et c’est dernière notion qui est définitivement à la base des méthodes d’évaluation économique.
La Valeur Economique Totale (VET)
Calculer la valeur économique totale d’un bien c’est estimer économiquement l’ensemble des avantages que la société humaine peut tirer de son utilisation. (BARDE J-P, 1992)
D’un point de vue purement économique, la valeur totale d’un bien peut s’évaluer en prenant en considération les valeurs d’usage et les valeurs de non-usage du bien en question. Les valeurs d’usage se réfèrent aux services fournis par le bien, donc son utilité, c’est-à-dire les satisfactions directes et indirectes des besoins qu’il peut procurer. Par contre, les valeurs de non-usage renvoient, soit à des usages futurs que l’on veut préserver pour nous (valeur d’option) ou pour les générations futures (valeur de legs), soit à l’existence même du bien, indépendamment de tout usage présent ou à venir (valeur d’existence). Une première approche est de considérer que la biodiversité a une valeur utilitaire et sert à satisfaire des besoins de la société. Une autre est de reconnaitrequ’elle a une valeur intrinsèque, en dehors de toute utilité. En d’autres termes, on peut parler de valeurs pour des usages mais aussi pour des non-usages. La valeur économique d’un bien peut en conséquence être schématisée comme ci-après.
L’illusion de l’économie de marché en termes de l’environnement
Economie de marché et protection de la biodiversité obéissent à des logiques différentes. La protection de la biodiversité s’inscrit sur le long terme. Elle implique de maintenir la diversité et la qualité des écosystèmes afin que les espèces puissent continuer à s’y reproduire et à y prospérer. Elle conduit aussià limiter l’usage des ressources naturelles pour que ces dernières puissent conserver les capacités de se renouveler.
L’économie de marché, au contraire, privilégie une logique de productivité maximale et de rentabilité à court terme. Le souci de rentabiliser les investissements conduit à une utilisation accrue de ressources naturelles et, rapidement, à une surexploitation. (BARDE J-P, 1992)
Selon les tenants de l’économie libérale, les problèmes environnementaux peuvent être résolus par le progrès technique dans un contexte de marchés concurrentiels. Le marché fixe les prix : la valeur d’un produit s’établit dans le cadre des échanges entre les agents économiques qui vendent et achètent des biens. Ce prix reflète à la fois le coût de production du produit et la préférence du consommateur lorsqu’il a le choix entre divers produits. Ainsi l’épuisement des ressources naturelles modifie à terme les prix de ces ressources dans le cadre des marchés (ce qui devient plus rare coûte plus cher, par exemple), ce qui incite les acteurs économiques à modifier leurs comportements. Les producteurs adoptent de nouvelles technologies, les consommateurs modifient leurs comportements d’achats.
La principale critique à la régulation des prix par le marché réside dans le fait que le prix des biens et services fournis par les écosystèmes ne reflète pas leur véritable « valeur ».
Par de nombreux aspects, ces biens et services ne sont pas appropriables. Ils sont souvent gratuits et apportent un bien-être à la collectivité même si celle-ci ne les consomment pas.
D’où les effets pervers possibles du marché. Par exemple, la destruction d’une forêt pour le commerce du bois rentre dans le cadre du marché puisque certaines espèces d’arbre font l’objet forte demande et sont payées parfois très chers. Mais en même temps, la destruction de cette forêt prive les hommes d’autres ressources (fruits, champignons, plantes médicinales) et des services de la forêt pouvait rendre sur le plan du cycle biogéochimiques (stockage du carbone par exemple) et du cycle hydrologique, de la production d’oxygène, de son rôle d’abri et d’habitat pour d’autres espèces. La pertede tous ces produits ou de ces fonctions, ainsi que le prix à payer pour replanter les arbres, ne sont pas pris en compte par les exploitants forestiers. Ils tirent un bénéfice immédiat de la coupe sans soucier du futur ni des effets collatéraux. Le marché sous-évalue donc le prix du bois en ignorant les autres biens et services fournis par la forêt. Ce biais est évidement préjudiciable pour conserver l’environnement et la biodiversité, et plus généralement pour gérer durablement les ressources naturelles. Pour l’économie, la réponse consiste dans la promotion d’instruments conformes aux marchés comme les taxes environnementales, les droits de propriétés. Elle consiste également à réintégrer la valeur des biens et services fournis par les écosystèmes dans le coût du marché. (OCDE, 1993)
Les défaillances du marché : Les externalités
PIGOU (1920) franchit un pas décisif en mettant en lumière la notion symétrique de « déséconomie externe » qui traduit les coûts ou désavantages que l’activité d’un agent économique impose à un autre, en l’absence de toute compensation financière, de tout échange marchand. Ainsi, la pollution de l’atmosphère par les activités industrielles, les transports ou la production d’énergie, entraine unecascade de conséquences négatives sur la santé, sur les matériaux, la végétation, etc. qui ne font l’objet d’aucun paiement compensatoire d’aucune transaction sur le marché. PIGOU met en relief cette divergence entre le coût privé et le coût social d’une activité ; seuls les coûts privés sont reflétés par le marché qui nous donne dès lors une vue tronquée du bien-être social. A. MARSHALL (1920) avait vu aussi que des phénomènes « hors marché » pouvaient influencer les comportements des agents économiques et affecter leur fonction d’utilité, en l’absence de toute transaction. Il met ainsi en lumière la notion d’ « économie externe » qui traduit l’avantage dont peut bénéficier un producteur (une entreprise) du simplefait l’existence d’autres producteurs, sans que le premier verse un paiement aux seconds. L’analyse économique se focalise sur les mécanismes de marché. Les biens en économie sont alloués par les mécanismes du marché, parce que pour ces derniers, les prix sont les signaux pour les agents économiques. Mais lorsque les biens et services n’ont pas de prix, lesystème du marché devient inefficace. Le marché est incapable de produire le niveau optimal de consommation. L’économique ne connait que deux phénomènes : la production et la consommation. Un bien produit est absorbé par la consommation : nul ne se soucie de savoir ceque deviennent les biens consommés ; un produit vendu n’a plus d’existence économique. Les déchets, phénomènes non monétaires, n’appartiennent pas à la sphère économique. De même, l’économie ne connait qu’une production : celle qui s’échange sur le marché contre de la monnaie. Or à la sortie du processus productif, on retrouve au moins deux types de « produits » : les produits destinés à la vente et les déchets, ces derniers désignant lesdéchets au sens large, c-est-à dire tout ce qui est rejeté, y compris la pollution. La réalité économique ne se réduit donc pas seulement à une simple dichotomie production-consommation, mais s’inscrit dans une dialectique beaucoup plus complexe qui relie la production, la consommation et les rejets . L’important est que nous ne créons rien, mais transformons des ressources en bien économiques et en déchets tout à la fois. De même, la consommation n’est pas seulement l’usure ou la destruction des biens, mais aussi leur transformation en résidus. Ces résidus et pollutions constituent des pertes de matière, donc de gaspillages qui, de ce fait, méritent d’être contrôlés au double titre de perte et nuisance. A ce stade, il faut bien comprendre la conséquence concrète de cette attitude. A partir du moment où l’économie ignore un phénomène, il en résulte d’évidentes erreurs de gestion. Les déchets n’ayant pas de valeur économique, ne sont pas préoccupants. Les ressources naturelles, telles que l’air et l’eau, considérées comme « biens libres », disponibles sans restriction, ne font pas l’objet d’une gestion rationnelle, au même titre que les biens économiques auxquels est attachée une valeur monétaire. Si, au contraire, une valeur monétaire était affectée à l’ensemble des ressources d’environnement (problème de tarification des ressources), celle-ci enteraient dans la sphère économique, au même titre que les autres ressources et facteurs de production, capital, travail, terre et l’ensemble des consommations intermédiaires (inputs), qui entrent dans le processus de production. Si je ne paie pas l’eau que j’utilise ou les services que merend l’atmosphère en tant qu’absorption de mes polluantes, je n’aurai aucune incitation économique à limiter ma consommation d’eau ou mes émissions dans le milieu ambiant. De plus, si ces pratiques sont dommageables pour d’autres agents économiques, sans que ces dommages se traduisent par une transaction monétaire, ces phénomènes, qui pourtant affectent le bien-être, demeurent purement et simplement ignorés (BARDE J-P, 1992).
Les externalités : la pollution en tant qu’effet externe :
L’externalité est une action d’un agent ayant un impact sur la fonction d’utilité ou de production d’un autre agent sans compensation financière. Il y a une « externalité positive » ou « économie externe » lorsqu’elle améliore le bien-être de l’agent concerné, et « l’externalité négative » ou « déséconomie externe » qui détériore le bien-être de l’agent concerné (OCDE, 1993). Le concept d’externalités fait référence aux retombées que peuvent avoir les activités économiques sur l’environnement. Selon les cas, les externalités peuvent être négatives ou positives. En matière d’Economie de l’environnement, en tant que science, l’analyse porte surtout, sur les retombées négatives des activités économiques surl’environnement.
Table des matières
Introduction générale
Chapitre 1 : Le passage du statut « bien libre » de l’environnement à la catégorie des biens économiques
Section 1 : Une absence de considération de l’environnement dans la théorie libérale
Section 2 : De la rente différentielle de RICARDO à la théorie de la population de MALTHUS : une prémisse de l’économie de l’environnement
Chapitre 2 : Protection et respect de l’environnement : mesures incitatives et responsabilisation des acteurs
Section 1 : Valorisation monétaire des biens et services fournis par l’environnement
Section 2 : Revue théorique du développement durable