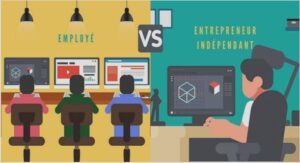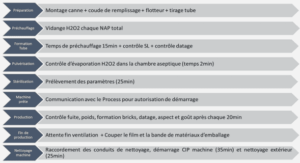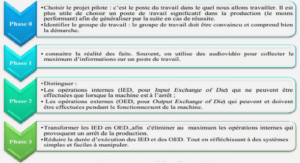Le monde des communications organisationnelles
Le monde professionnel des Relations Publiques et leurs organisations : profession et recherche Brésil et France
« Connaître et comprendre le passé permet de penser et agir dans le présent, surtout par rapport à des questions encore vives » (Boure 2007b, 258). Cette phrase de Robert Boure7 exprime ce que nous prétendons développer dans notre thèse. Avoir la connaissance de l’histoire et ses origines nous aidera à comprendre ‘le pourquoi, le qui, le où, le quand, le quoi et le comment’ des métiers, des activités et des fonctions dans le domaine de la communication, métiers et fonctions qui sont visés par les formations professionnelles, qui ont donné lieu à des formalisations théoriques produites par les professionnels eux-mêmes et ont fini par devenir des disciplines scientifiques. Nous allons nous consacrer dans ce premier chapitre, à reconstituer la dynamique des parcours professionnels et l’univers professionnalisant de certains métiers de la communication. Pour faire notre analyse nous avons choisi la fonction et/ou les métiers des Relations Publiques, ses origines et ses influences. En effet, nous considérons les Relations Publiques comme une pratique sociale mère qui s’est développée un peu partout dans le monde (Michel 2008, 25). Ce choix s’explique d’abord parce que la tradition brésilienne dans laquelle nous avons été formé est celle des Relations Publiques : le domaine des communications, au Brésil, s’est développé sur ce socle et cette référence. Une analyse de la situation française montre aussi cela, même si elle combine cette tradition de la communication tournée vers l’opinion publique avec une seconde, celle de l’Ecole des Relations Humaines américaine. Une étude historique des métiers et des pratiques en France montre cependant bien la contribution et l’influence des Relations Publiques en France et au Brésil, soit par son évolution constante, soit pas sa charte déontologique et son code de bonne conduite qui l’a amenée à imposer des modèles d’éthiques professionnelles cherchant toujours une harmonisation entre les actions internes et externes d’un dirigeant ou d’une entreprise. En outre, les Relations Publiques recouvrent aussi de nombreuses tâches dans le secteur de la communication. Pour comprendre cette influence il nous a fallu chercher dans son histoire, ses origines plus lointaines aux Etats Unis d’Amérique. Ce retour en arrière (nous nous sommes restreints aux pionniers des Relations Publiques, praticiens et théoriciens, en nous arrêtant aux années 1930) s’explique par le recours constant des travaux brésiliens et français à quelques figures données comme fondatrices du domaine professionnel. Le savoir-faire et le faire-savoir des Relations Publiques américaines ont eu une grande influence dans nos deux pays d’étude : France et Brésil. Logiquement, notre étude du champ professionnel en France et au Brésil commencera plus tard, après la seconde guerre mondiale. Dans une seconde partie de ce chapitre, acceptant l’idée que la définition du champ de la communication des entreprises et des organisations est partagée des deux côtés de l’Atlantique, nous chercherons à expliciter cette définition et à décrire les pratiques et les enjeux. Il y a en commun une philosophie, ou une éthique, celle de vouloir créer des relations personnelles, qui permettent de comprendre par la suite cette expansion toujours ancrée vers l’économique, même si cela initialement reste dissimulé. L’influence des USA : Appuyée sur de multiples sources brésiliennes, ainsi que des ouvrages français réalisés par des professionnels en Relations Publiques (Etienne, Boiry), nous verrons que l’influence des praticiens américains jouent incontestablement sur l’avenir socio-professionnel encore inconnu de la France et du Brésil. Nous remarquerons que cette pratique qui débute au XIXème siècle, va se démarquer et s’amplifier encore plus au XXème siècle où elle va imposer des modèles et des actions internes et externes à ses clients et aux entreprises qui ont mauvaise réputation ou qui veulent avoir une image plus sociale.
L’arrivée et le développement des Relations Publiques aux Etats Unis : 1865 – 1935
La pratique des Relations Publiques8 commence aux États-Unis à la fin de la guerre de Sécession, plus connue comme guerre civile américaine, dans les années 1865, au moment de la révolution industrielle, période des magnats du pétrole, des chemins de fer, pendant laquelle les banquiers traitaient la population sans aucun respect. L’argent était tout. L’opinion publique était quasiment nulle, personne ne s’inquiétait de l’intérêt de la société, jusqu’au jour où, à la fin du XIXème siècle, le contre-amiral William Henry Vanderbilt9 , président des chemins de fer Baltimore and Ohio Railroad, déclara le 8 octobre 1882 : « The public be damned. You get out of here ! / Le public au diable. Vous sortez d’ici ! » (Gordon 1989)10 durant une conférence de presse à un groupe de journalistes de Chicago (USA). Le sujet de la discussion : la suspension soudaine d’une des lignes ferroviaires. Cependant, cette fois-là, il y eut un énorme changement, le public réagit, provoquant une panique générale et une fusillade contre la population se produisit. Des innocents moururent. La presse, à ce moment-là, elle aussi réagit, et commença à chercher des réponses et à dénoncer les abus de ces dirigeants. Vanderbilt, essaya de justifier son erreur, et mit à disposition des citoyens des parts d’actions de sa Compagnie Central de New York, comme l’explique Salma S. Zogbi11, dans un ouvrage brésilien de 1987 (Au final, c’est quoi les Relations Publiques ?) (Zogbi 1987, 14 et 15). Malgré cela, les protestations continuèrent. Les attaques contre les ‘souverains’ furent de plus en plus fréquentes. C’est à ce moment-là qu’une nouvelle crise se déclencha, entre 1907 et 1917, appelée « The Muckraking Area », et qui fut une période de dénicheurs de scandales, illustrée par Upton Sinclair, dans ‘La Jungle’ et par Ida Tarbell, dans ‘L’Histoire de la Standart Oil Company’. Comme le décrit Philipe Boiry12, les journalistes et les écrivains traduisent les sentiments de leurs lecteurs et dénoncent les méthodes des grandes compagnies industrielles et les conditions de vie du monde ouvrier (Boiry 2003, 25). Ainsi les Relations Publiques sont au début une pratique de « gestion de l’opinion publique », nécessaire non seulement aux hommes politiques, mais aussi aux grandes entreprises. Le journaliste Ivy Ledbetter Lee13, rajoute encore : « Le public doit être informé », et au début du XXème siècle, à New York, il défend une nouvelle forme d’activité, celle de la diffusion institutionnelle d’information pour obtenir la compréhension et l’acceptation du public par rapport aux organisations. Ivy Lee délaisse sa profession de journaliste, et ouvre le premier bureau de Relations Publiques au monde. Nait, alors, la pratique des relations publiques, celle qui crée une certaine « empathie » entre les institutions (industries, marchés et entrepreneurs et le public (employés, citoyens et le peuple). Celle qui va « traduire les mots dollars et cents en termes humains, […] qui va transposer les faits économiques en réalités sociales » (Boiry 2003, 153). A partir de ce moment-là Ivy L. Lee est considéré comme le père des Relations Publiques. Ses actions sont nombreuses, cependant, nous voudrions mettre l’accent en particulier sur l’épisode du baron du pétrole John D. Rockfeller, dans les années 1920, venu en personne, demander les services14 d’Ivy Lee, pendant la grève sanguinaire du ‘Colorado Fuel and Iron Co’ (Leroy, 1967). La situation était si insoutenable que John D. Rockfeller, père, était obligé de sortir avec des gardes du corps. Lee avait comme défi de changer l’image de l’entrepreneur le plus détesté des États-Unis
LE MONDE DES COMMUNICATIONS ORGANISATIONNELLES : PRATIQUES ET 1.3.4.2 La Proal une entreprise de conseil en journalisme institutionnel : 1968 – 1990 B. Une autre histoire des théories de « la communication » 2.3.2 Des formations professionnelles aux formations universitaires : Guillebeau et le Communication&Organisation |