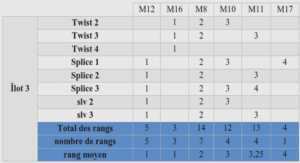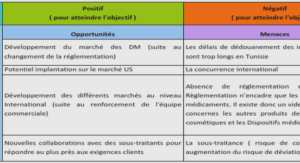LE LONG SIÈCLE ANALYTIQUE
L’esprit du XVIIIe siècle, dont Hobbes serait précurseur et duquel Rousseau annoncerait la fin, a été analytique : souvenons-nous de cette thèse émise par E. Cassirer, à laquelle nos propres recherches, limitées qu’elles sont à l’étude de ces deux auteurs, ne peuvent qu’apporter une illustration. Bien que restreint, ce terrain d’investigation s’avère toutefois suffisamment large pour que la méthode analytique puisse y avoir fait sécession. Si Hobbes et Rousseau procèdent l’un comme l’autre par analyse, on ne peut pour autant juger conformes leurs démarches respectives. L’examen des méthodes hobbésienne et rousseauiste nous a mené au constat que les idées de « résolution » et de sa conséquente « recomposition », ou encore celles de « soustraction » et d’« addition », s’offrent à la compréhension avec une facilité bien moindre que ce que pourrait laisser penser, à première vue, l’apparente clarté des termes qui les expriment. En réalité, affirmer que connaître un fait consiste à le décomposer en ses éléments puis à les réunifier de sorte à regagner l’objet examiné, ne revient pas – loin de là – à fournir un mode d’emploi à celui qui voudrait s’engager dans une telle entreprise. Nous avons identifié et interprété, chez Hobbes d’abord, chez Rousseau ensuite, un recours à la méthode analytique, et cela tant du point de vue des objectifs fixés par cette dernière que des techniques de sa réalisation. Il a été loisible d’observer que, malgré la superficielle ressemblance que présentent les récits soumis par les deux philosophes à leurs lecteurs, c’est à tort que nous passerions outre leurs différences, lesquelles distinguent en réalité et leurs démarches, et leurs objectifs.
En un mot, bien que figurent dans les écrits de l’un comme de l’autre un état de nature, un contrat social, un État et une société construits d’« en bas », l’inférence selon laquelle les théories politiques de ces deux penseurs représenteraient deux « variantes » de la même intention ne trouve guère de justification. Aucun doute, nos deux auteurs pensent à partir du présent et pour le présent. Tous deux empruntent la voie spéculative : ils croient pouvoir tirer une « connaissance » de leurs sociétés respectives en commençant par se détourner d’elles par le biais d’une mise en scène fictionnelle et théorique de la figure de l’homme naturel. Or, dans ce geste que nous avons associé à la méthode analytique, leurs démarches se séparent déjà. Si le texte qui suit tend à s’éloigner pour un court moment de Hobbes comme de Rousseau, c’est afin de leur revenir mieux armé par la suite. La problématique de l’erreur, fil rouge de ce pan de notre travail, sera en effet abordée dans le but de mieux saisir en quoi leurs méthodes – leurs analyses – se séparent. Dès lors, que l’examen – relativement sommaire au demeurant – consacré à la philosophie d’un contemporain de Rousseau, Étienne B.
de Condillac, ne soit pas interprété comme une tentative d’honorer la symétrie des sciences sociales et de la psychologie insinuée par E. Cassirer (qui, on s’en souvient, mentionne également cette dernière discipline comme particulièrement réceptive de la méthode analytique). C’est en fait sur la « logique » de Condillac que nous nous appuierons principalement – notamment sur l’inspiration mathématique dont manifeste l’analyse, érigée en modèle méthodologique général par cet auteur, et sur la fonction thérapeutique attribuée à cette méthode en vue de la rectification du langage – et dans une moindre mesure seulement sur l’application de la méthode analytique au domaine de la psychologie, application qui « travaill[ait] à la ruine de [l’]alternative entre genèse et calcul », selon la précieuse remarque de Jacques Derrida538. L’inspiration mathématique de Condillac Dans son épistémologie, Condillac se réclame explicitement des mathématiques comme d’un modèle de rigueur :seule : rien n’y paraît arbitraire. L’analogie qui n’échappe jamais, conduit sensiblement d’expression en expression. L’usage ici n’a aucune autorité541 ». La pureté du langage mathématique, sa transparence, contrasterait en revanche avec l’imperfection de la langue employée par les autres sciences qui, victimes de son hypocrisie, se laisseraient détourner de la vérité. Ainsi, lorsque Condillac s’interroge, au début de sa Langue des calculs (ouvrage paru à titre posthume en 1798), sur la façon de pourvoir toutes les sciences de la rigueur inhérente aux mathématiques, c’est à la manière d’un programme de rectification de la langue des sciences que s’annonce son projet.