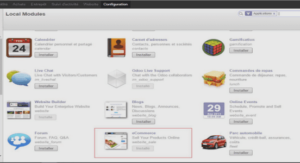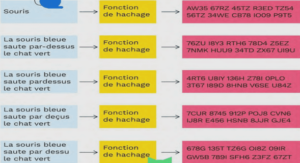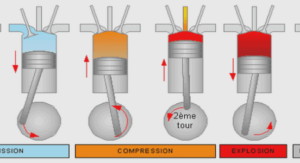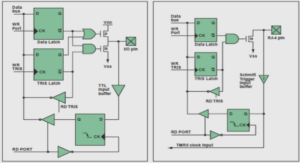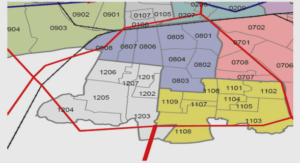La médiation documentaire photographique pour le scolaire
La médiation documentaire est un concept défini par de nombreux chercheurs dans différents champs de recherche. Nous allons revenir sur sa définition pour nous permettre de conjuguer ce concept à l’apprentissage d’une culture photographique.
Le mot médiation prend ses racines dans le substantif medius qui signifie : manière d’être au milieu, entre. Ce terme apparaît dans la langue française au XIIIème siècle selon Alan Rey, linguiste et lexicographe, en charge des éditions le Robert. A partir des années 1970, la médiation prend un sens plus large et se définit comme un moyen de mettre en relation deux choses. Chaque discipline la décline et s’approprie cette notion en construisant son modèle dans son champ d’expertise. En sciences de l’information et de la communication, la médiation est l’un des concepts fondateurs. « La médiation est un champ de recherche important dans les SIC, dans le sens où les types de médiation ordonnent la production, la diffusion et l’appropriation de l’information au sein de l’espace public (Lazimet, 1995) » (Le Coadic, 2006). La médiation structure l’espace social de communication. Nous nous sommes intéressée dans nos travaux à la médiation documentaire. Nous avons repris les propos de Séraphin Alava, qui définissait, dans ses cours, la médiation documentaire comme la fonction principale du professeur documentaliste. Il écrit, dans un article paru dans la revue Documentaliste-Sciences de l’information en 1993, que le documentaliste doit « aider l’élève à construire des savoirs de référence à travers la médiation du document » (Alava, 1993). Dans l’article « Qu’est-ce qui fait science dans science de l’information », Yves-François Le Coadic propose de compléter cette définition, qu’il juge limitée, au domaine pédagogique. Il rappelle la définition d’Annette Beguin-Verbrugge « la médiation documentaire est une médiation qui n’implique pas le rapport personnel direct mais qui implique cependant le recours au langage et la prise en compte d’un niveau de connaissance de l’utilisateur et de ses capacités d’abstraction » (Beguin-Verbrugge, 2002).
Pour construire la médiation documentaire appropriée, nous avons dressé ce bilan : premièrement nous cherchions à transmettre des connaissances sur la photographie à des élèves qui n’en avaient pas, deuxièmement, il nous fallait donc non seulement intégrer ce média quasi-absent dans la sphère scolaire et l’univers pédagogique de l’élève mais aussi développer en parallèle une médiation des savoirs. Nous ne voulions pas limiter la médiation photographique à un simple accès mais proposer un accompagnement à la construction de savoirs. Il ne s’agissait pas seulement, selon la définition du muséologue Jean Davallon, d’imaginer un simple processus d’accompagnement de l’élève usager mais de l’élève apprenant. La médiation étant une médiation de l’information.
Nous nous sommes trouvée devant la nécessité de développer une médiation plus complexe que nous avons nommé : « médiation photographique scolaire » nous voulions insister sur son objectif premier : accompagner l’élève usager à transformer une information en connaissance à partir du média photographique. Il nous semble primordial de s’appuyer sur le professeur documentaliste comme « catalyseur d’apprentissage », en empruntant l’expression à Isabelle Fabre, tout en conservant l’idée que la médiation documentaire n’impliquait pas un rapport personnel direct. Nous avons tout d’abord imaginé un parcours d’éducation à l’image photographique puis nous avons opté pour une médiation par le jeu. Nos recherches illustrent les conclusions de l’article : « Faut-il reconsidérer la médiation documentaire ? » « Si la médiation documentaire prend appui sur le traitement documentaire basé sur l’usage de normes professionnelles universelles visant un usage collectif, elle s’oriente aujourd’hui vers la mise en place de dispositifs techniques et humains plus complexes qui incluent des réécritures de l’information, revisitant aussi des formes médiatrices dans les pratiques professionnelles. Nous avons en effet noté que les champs d’actions et de discours des professionnels interrogés et observés évoluent progressivement vers une multiplication d’activités orientées autour d’un accompagnement médié des usagers par la production de ressources » (Liquète, Fabre, Gardiès, 2010).
Nous avons ajouté le jeu éducatif comme ingrédient dans la médiation documentaire photographique scolaire.
La médiation documentaire photographique scolaire
La médiation documentaire photographique scolaire aurait pour objectif d’amener les élèves aux images et de développer une plus grande maîtrise technique et culturelle. Les mots de Sylvie Germain, écrits dans un article du Sud-Ouest, publié le 26 octobre 2013, « Attends un peu, écoute donc, regarde bien afin de voir pour de bon … afin d’apprécier, de juger, de comprendre » ont résonné comme une ultime recommandation à transmettre aux élèves de Terminale avant qu’ils ne quittent le lycée.
Nous avons proposé et imaginé, au cours de ces travaux, plusieurs formes de médiation documentaire photographique scolaire qui peuvent se résumer en deux catégories : la médiation par le jeu et la médiatisation par le je. La première fait appel aux jeux tels que le jeu de cartes comme pause photo prose, conçu pour amener l’élève à regarder, à voir, et à faire grandir son regard, les jeux numériques proposés sur le site décrytptimages, ou sur les banques de jeux sérieux telles que Thot cursus. Nous avons relevé : Cadrez-moi qui permettent de découvrir les principales règles d’esthétique en photographie et Déclenchez-moi qui fait découvrir les réglages essentiels en photographie. Nous comptons dans cette catégorie, le premier webdocufiction : à la Une, édité par le réseau Canopé, permettant au joueur de devenir, journaliste stagiaire, le temps d’une journée, pour le quotidien Libération. Au cours de la partie, le joueur, stagiaire en journalisme, doit faire une recherche sur le photojournalisme. Il devra écrire et illustrer son article, aidé par un journaliste professionnel qui l’accompagne à choisir l’angle de son article, la forme journalistique appropriée. En amont, le journaliste a sélectionné pour le stagiaire des sources pertinentes : actuelles et fiables. Tout au long de la partie, il le guide et le corrige. Une interview d’Alain Buu, photographe chez Gamma, est intégrée au jeu pour que le joueur puisse dresser une photographie du métier.
Le deuxième type de médiation fait appel à la pratique de l’élève, à son positionnement, comme acteur du « je ». Nous incluons la médiation culturelle photographique, conduite par les médiateurs culturels lors des expositions. Ils conçoivent et proposent un parcours pour que la personne/l’élève puisse comprendre l’œuvre et passer du « je regarde » à « je vois ». Ils encouragent les spectateurs à devenir acteurs et à construire un regard, à trouver un sens à la photographie.
Une ressource documentaire vient contredire notre classement « mémoires du photographe inconnu » proposant par le jeu de devenir le je. En effet, le photographe Bertrand Carrière, reçoit en legs, de la part de son ami cinéaste, Philippe Baylaucq, un album contenant deux cent soixante-neuf clichés de la Première Guerre mondiale. Philippe Baylaucq l’avait découvert dans une grange abandonnée de Morin-Heights, près de Montréal. L’auteur des clichés est inconnu, mais Bertrand Carrière décide de comprendre ces photographies, d’en retrouver l’auteur, le lieu où elles ont été prises et la mission du photographe. Après de longues recherches, il arrive à trouver le propriétaire de ces photos : le soldat Fletcher Wade Moses. De retour au Canada, ce dernier devient distributeur d’images de la Grande Guerre. Bertrand Carrière décide de faire connaître ces photos, et réalise un docufiction en réalité virtuelle avec l’aide de l’Office national du film du Canada et le studio de production numérique Turbulent. Nous n’avons pas pu tester cette expérience immersive elle nécessite le port d’un casque 3D pour partir à la découverte de ces photos, accompagné par la voix du photographe inconnu. Ce docufiction est à découvrir à partir de 12 ans, en téléchargement gratuit avec un compte Oculus. Les critiques ont pu noter que « l’expérience invitait à la réflexion sur le pouvoir des images et les ravages de la guerre, celles d’hier, celles d’aujourd’hui ou celles de demain. » La bande d’annonce nous permet de découvrir l’atmosphère de ce « jeu du je » proposé en fin 2015. C’est une médiation documentaire photographique originale qui pourrait se déployer avec le développement des nouvelles technologies.