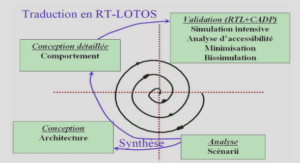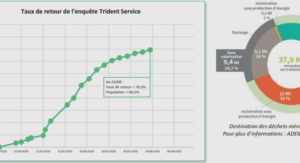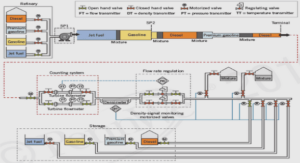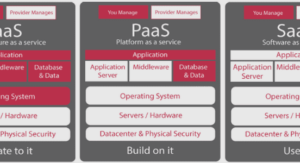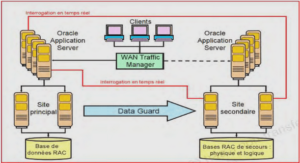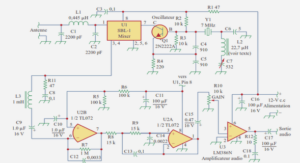L’évolution positive du droit des entreprises en difficulté à l’avantage du débiteur
Le droit des procédures collectives a connu récemment une immense vague réformatrice qui n’a pas atteint uniquement la législation Française, mais un ensemble de pays européens, voire d’autres pays développés et émergents289, qui aspirent véritablement à une économie développée et qui privilégient la création des richesses et l’ouverture à l’étranger. Suffisamment pour traduire la volonté politique et économique des pays réformateurs, en vue de mettre en place une loi relative au droit de faillite des entreprises, qui semble devenir une unité de mesure pour les acteurs économiques étrangers souhaitant s’aventurer dans un pays quelconque.
En effet, ces réformes jugées en grande partie substantielles, ont été orientées dans l’intérêt du débiteur, visant à assouplir les conditions d’ouverture d’une procédure à son avantage, et à favoriser également le redressement, qui recèle deux notions majeures relatives aux entreprises en difficulté, celle de la préservation de l’emploi et la continuation de l’activité.
220. En France, le législateur a voulu la substituer à une loi de faillite qui a toujours eu à la fois une connotation et une finalité sanctionnatrice. Conscient des mutations économiques qui se sont produites à l’échelle mondiale, celui-ci a dû anticiper son action réformatrice pour enfin élaborer une loi dépénalisant la défaillance des entreprises290, et soulignant les intérêts majeurs de celle-ci et sa principale vocation, qui reposait prioritairement sur la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi, et en dernière priorité, l’apurement du passif. Néanmoins, confronté à une controverse jurisprudentielle291, et un bilan désastreux pour les créanciers, qui se sont soumis vainement aux sacrifices imposés par le législateur, du fait que 90% des entreprises étaient finalement liquidées292 , le législateur français a dû se rattraper, en mettant en place la loi du 10 juin 1994, ayant pour objectif de trouver un point d’équilibre entre le redressement de l’entreprise et le droit des créanciers, notamment ceux titulaires de suretés spéciales et propriétaires, mais ses lacunes ont été décelées, et ont provoqué de sérieuses critiques293.
Dans la même dynamique, le législateur Français a étendu les procédures collectives aux professionnels libéraux, à travers la loi du 26 juillet 2005, mettant au cœur de cette réforme une nouvelle procédure dite de sauvegarde. Il s’agit d’une réforme courageuse qui témoigne de l’évolution importante de la législation Française. L’ordonnance du 18 décembre qui s’inscrit dans la même continuité est venue d’emblée combler les insuffisances dénoncées de la loi de 2005.
En effet, la succession des réformes relatives aux procédures collectives a radicalement révolutionné ce droit, et notamment sa finalité294, sans pour autant assurer la quiétude nécessaire aux créanciers qui, dans cette perspective de redressement de l’entreprise, et eu égard à l’assouplissement des conditions d’ouverture des procédures, face à l’accumulation de celles-ci dans le but de sauver l’entreprise295, peuvent se trouver confrontés à un risque d’ouverture prématurée de ladite procédure qui résulte des difficultés de prévoir adéquatement le risque de la défaillance financière du débiteur. Cela nous amène à penser que ces réformes peuvent être une source d’insécurité juridique pour les créanciers, si l’on tient compte qu’en l’absence d’une définition unanime d’un état d’insolvabilité296, le traitement des entreprises en difficulté ne s’ouvre pas par l’existence d’un ou plusieurs impayés297, mais par une situation de fait établie de manière comptable et juridique, et légalement qualifiée de cessation de paiement.
De ce point de vue, on peut se demander si les procédures collectives ne servent pas de refuge aux débiteurs, attendu que les chances de recouvrement dans le contexte de ces procédures sont moins évidentes que dans les procédures de droit commun liées à l’impayé, étant donné que le débiteur n’a jamais été aussi protégé et avantagé par une loi relative aux entreprises en difficultés…
Certes, les questions qui portent sur la priorité des intérêts du débiteur et ceux du créancier resteront toujours au centre des discussions en la matière, et seront une préoccupation majeure du législateur. Chacun adoptant une position de victime, ce problème est loin d’être résolu. Toutefois, on est enclin à penser que le droit des procédures collectives est passé en France d’une sévérité extrême à un laxisme exagéré298. On peut estimer en conséquence que cela a contribué à ce que davantage de débiteurs s’abritent derrière la loi à travers les procédures collectives, pour peut-être éviter le contentieux de l’impayé de droit commun, qui lui peut a contrario s’avérer plus fructueux pour le créancier qu’une collectivisation de recouvrement dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Nous allons donc nous focaliser sur cette évolution législative au profit du débiteur, particulièrement sur les questions procédurales ayant vraisemblablement concouru à la hausse des procédures collectives, tant au niveau des procédures préventives de ces réformes (p.1), qu’au niveau des procédures de traitement (p.2).
L’évolution du domaine préventif des réformes des procédures collectives
Aujourd’hui, le domaine préventif de la loi des entreprises en difficulté, s’articule autour de deux procédures préventives, n’ayant pas toutes les deux un caractère collectif, celle nouvellement appelée la conciliation (A), qui est venue remplacer la procédure de règlement amiable et combler les insuffisances afférentes. Et celle de sauvegarde (B) qui constitue la procédure phare de la réforme du 26 juillet 2005.
La conciliation dans sa nouvelle dimension
Outre les procédures d’alertes299 et le mandat ad hoc300 qui ont une finalité purement préventive, mais n’emportent pas d’effets à l’égard des créanciers, la procédure de conciliation vient renforcer un arsenal juridique préventif en relation avec les difficultés qu’une entreprises peut rencontrer.
En effet, la nouvelle législation a étendu le domaine d’application de la conciliation qui s’applique désormais à tous les professionnels exerçant à titre individuel, y compris les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé301. A ces personnes éligibles s’ajoutent, toute entreprise, personne morale ou physique. Le chef d’entreprise ou le professionnel libéral 302 éprouvant une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et ne se trouvant pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours, peut saisir le tribunal pour le bénéfice d’une procédure de conciliation. Celle-ci est ouverte par le président du tribunal de commerce303 qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas 4 mois.
Par ailleurs, la question est de savoir si le droit des créanciers, et notamment leur droit de poursuites individuelles ne sera atteint par l’ouverture de la conciliation ou pendant la recherche d’un accord amiable (1), pareillement lors d’une constatation ou lors de l’homologation d’un accord (2).
Le droit des poursuites individuelles et d’exécution pendant la recherche d’un accord amiable
La procédure de conciliation se distingue par sa confidentialité du fait qu’elle ne fait pas l’objet d’une publication, une fois le conciliateur désigné, il a pour mission de favoriser l’aboutissement d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ou ses contractants habituels, à dessein de mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Il peut, dans le cadre de son mandat, présenter toute proposition de nature à sauvegarder l’entreprise en vue de la poursuite de son activité et en faveur du maintien de ses emplois.
Cependant, la mission du conciliateur qui est de rechercher un accord amiable après l’ouverture de la procédure de conciliation n’entraine pas un arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution pendant la recherche de cet accord, contrairement aux régimes antérieurs304.
Compte tenu du caractère non collectif de cette procédure, les créanciers ne subissent aucun effet lors de l’ouverture de la procédure de conciliation, ou pendant la recherche d’un accord amiable par le conciliateur, en conséquence, ils peuvent exercer librement leurs actions individuelles et agir en exécution contre le débiteur faisant l’objet d’une procédure de conciliation. En outre, aucune interdiction de paiement n’est prévue par la réglementation en vigueur, à la différence de l’ancienne législation si d’aventure une ordonnance visant la suspension provisoire des poursuites venait à être rendue.
Toutefois, rien ne semble interdire au conciliateur durant son mandat, de s’appuyer sur le principe de la liberté contractuelle, pour demander aux créanciers qui souhaitent poursuivre individuellement le débiteur ou le garant, d’y renoncer, au moins durant la procédure de conciliation.
Nonobstant, l’absence d’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution pendant la recherche d’un accord connait une exception, lorsque, le débiteur lui-même sollicite le président du tribunal afin que celui-ci lui accorde des délais de grâce en vertu des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Toutefois, la jurisprudence approuve le fait que seules les procédures exécutoires et actions en justice tendant au paiement de sommes d’argent, engagées postérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation pourront bénéficier des dispositions de l’article L611-7 du code de commerce305, mais cette décision n’est pas encore confirmée par la cour de cassation. Par ailleurs, l’ordonnance du 18 décembre 2008 prévoit qu’une seule mise en demeure faite par le créancier au débiteur suffit pour permettre à ce dernier de saisir le président du tribunal à cet effet306.