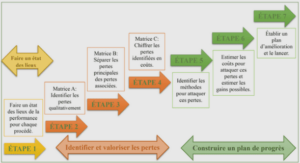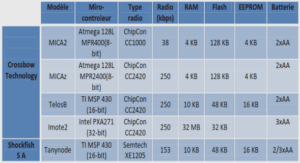Le double modèle d’Aristote (suite) : les métaphores du troisième et quatrième type
La métaphore et la rhétorique
Ce lien, pendant longtemps, n’a pas posé problème. La métaphore est ainsi apparue comme l’une des figures chéries de la rhétorique, cet art du « bien dire », cette technique visant à convaincre et à persuader, comme une fleur du style. On est loin alors, du moins en apparence, de la métaphore surréaliste et de ses pouvoirs stupéfiants, invoqués par Genette après Breton, l’un pour les dénoncer, l’autre pour les louer. Les conséquences de cette liaison entre métaphore et rhétorique sont pourtant nombreuses et parfois paradoxales. Aussi convient-il de revenir sur ce lien largement contingent, même s’il possède souvent un caractère d’évidence aujourd’hui, pour en interroger les implications et les conséquences.
La rhétorique entre philosophie et sophistique
On ne peut évoquer la rhétorique sans rappeler son ambiguïté constitutive, bien connue, relevée par exemple par Ricœur, Châtelet, Détrie, mais déjà perceptible chez Aristote, Cicéron ou Quintilien : très tôt, la rhétorique apparaît comme déchirée entre convaincre et persuader. Le débat est connu qui oppose Socrate et Platon aux sophistes, dont le nom désignait à l’origine l’ensemble des rhéteurs. Pour Platon, c’est la discipline toute entière qui est condamnée : dans Gorgias, la rhétorique est comparée à la cuisine, à la cosmétique et à la sophistique ; ce ne sont que différentes formes de flatterie. 154 Mais, dans le discours de Socrate tel qu’il est fixé dans L’Apologie de Socrate, c’est bien une sorte de rhétorique – ou d’anti-rhétorique – qui est à l’œuvre. La mort de celui-ci peut alors apparaître, à plusieurs niveaux, comme une victoire des sophistes contre la philosophie, contre une démocratie authentique, contre la « vérité ». D’où la réaction de Platon, et les conclusions radicales qu’il en tire, avec la République par exemple, ou le rejet de toute rhétorique. La réaction d’Aristote est différente, même si elle témoigne elle aussi d’un état de crise, d’un échec de la stratégie des philosophes : avec lui, la rhétorique se constitue comme discipline de compromis. Il s’agit de réconcilier cette pratique, tentée par la sophistique au sens actuel, avec la philosophie. La métaphore participe évidemment de ce projet, comme elle participe de l’ambivalence de la rhétorique : elle peut être utilisée pour convaincre ou persuader. C’est là, après son pacte avec le mot et la théorie qui en découle, une seconde source de soupçon. La métaphore permet d’argumenter, de fixer les idées ; elle permet aussi de créer des illusions, de polémiquer. Les développements sur l’analogie, dans les Seconds analytiques, dans les Topiques, l’indiquent bien déjà, ainsi que dans Éthique à Nicomaque d’ailleurs. L’histoire même de la rhétorique, la référence constante à son origine supposée – la chute de la tyrannie en Sicile – souligne bien les enjeux : comme art de la parole, permettant de délibérer, elle est liée à la démocratie mais, comme art de plaider une cause, pour obtenir des droits contestés par d’autres, elle apparaît comme un art libéral non dénué d’ambiguïté. Socrate et Platon souligneront d’ailleurs cette différence essentielle entre 154 Platon, Gorgias, 463a-465e et 520a-520b. 261 l’enseignement des rhéteurs et le leur : les sophistes font payer, parfois très cher, pour délivrer leur savoir. C’est finalement l’un des principaux critères qui permettent de distinguer les deux enseignements, la rhétorique et la philosophie, dont les contenus se recoupaient parfois largement. À partir de ce moment-là, le soupçon ne cesse plus sur la rhétorique. Sans aller jusqu’à évoquer les premiers protestants, opposés à la rhétorique déployée par la Contre-réforme, ou les jansénistes rebutés par l’enseignement des Jésuites, on peut mentionner la première page de la Rhétorique à Herennius, dans les années 80 av. JC : la rhétorique est utile, ses qualités sont « l’abondance oratoire et l’aisance d’expression », mais elles ne se livrent que « si elles sont réglées par un jugement droit et une âme bien tempérée ». Une certaine défiance est perceptible, que l’on retrouvera, mais atténuée, chez Cicéron et Quintilien. Ces derniers règlent la question en voulant rapprocher rhétorique et philosophie : comme Aristote, ils insistent sur la nécessité de cette dernière. L’Auctor ad Herennium, lui, assume davantage la coupure : il présente sa rédaction du traité de rhétorique comme une parenthèse complaisante dans son activité d’étude de la philosophie, à laquelle il dit préférer consacrer son peu de temps libre. Il ajoute d’ailleurs qu’il a rédigé son ouvrage pour faire plaisir à son dédicataire, cet Herennius qui lui a demandé ce service, mais qu’il a « laissé ce que les Grecs, auteurs de manuels, sont allés chercher pour en faire un vain étalage : dans la crainte de paraître trop peu savants, ils ont pris des éléments hors du sujet, pour qu’on crût leur science plus difficile à connaître » et il ajoute : « ce n’est pas en effet, comme les autres, l’appât du gain ou le désir de gloire qui me conduit à écrire ».155 La rhétorique peut donc être proche de la sophistique, constituer un art de tromper, comme le voulait Athénée par exemple, ou apparaître neutre, simple instrument, comme la présente l’Auctor ad Herennium. Mais c’est une troisième voie, empruntée par Aristote, Cicéron, Quintilien, qui apparaît, du moins rétrospectivement, avoir eu le plus de succès, puisque ce sont ces auteurs dont il nous reste le plus d’ouvrages : la rhétorique n’est plus un instrument, mais un art de bien parler qui engage l’individu dans une démarche globale, où morale et philosophie sont nécessaires. Cette conception, à dire vrai, ne semble pas toujours convaincre leurs auteurs eux-mêmes. Elle semble en tout cas moins cohérente, plus un projet qu’une réalité jamais atteinte, comme le reconnaît implicitement Cicéron en citant Socrate : ce fut lui qui « par sa dialectique, sépara deux choses, liées au fond l’une à l’autre, la science de bien penser et celle d’écrire en un style brillant. C’est d’alors que date cette séparation si importante je dirais volontiers entre la langue et le cœur, séparation vraiment choquante, inutile, condamnable, qui imposa deux maîtres différents pour bien vivre et bien dire. » 156 Socrate pourtant n’a fait que reconnaître – et déplorer – cette possible séparation, d’où la haute ambition d’Aristote pour la rhétorique. La toute première phrase de sa Rhétorique déclare brutalement, en effet, que « la rhétorique se rattache à la dialectique. » En témoigne le rôle de la preuve dans son ouvrage, même si la rhétorique est du domaine du vraisemblable : son souci est particulièrement éloquent d’apporter à l’art oratoire, avec l’enthymème, l’équivalent du syllogisme. Et Aristote de décrire ce qui rapproche de si près les deux disciplines : « La rhétorique, nous l’avons dit en commençant, est une partie de la dialectique et lui ressemble. Ni l’une ni l’autre n’implique en soi la connaissance de quelque point déterminé, mais toutes deux comportent des ressources pour procurer des raisons. » Mais, en même temps, Aristote doit réfuter l’accusation de malignité de la rhétorique. Signalant que, comme toute puissance, comme « tout ce qui est bon, la vertu exceptée »,
Soupçon sur l’art du style
la coupure entre rhétorique et poétique Le soupçon sur la rhétorique, et sur la métaphore à travers elle, ne tient pas seulement au lien de la rhétorique avec la sophistique, à cette tension entre rhétorique et dialectique. Ce n’est pas seulement comme art de l’opinion, de la persuasion, que la rhétorique a pu nuire à la « reine des figures ». C’est aussi comme art du style, de la forme, qui se perd parfois dans les méandres du beau style ou dans les effets oratoires gratuits. Les deux débats se recoupent largement chez Aristote. Et si les rapports entre rhétorique, philosophie et sophistique sont complexes, les liens entre poétique et rhétorique ne sont pas moins ambigus : des passerelles existent quant aux notions utilisées, aux grandes catégories, mais une coupure s’établit également entre les deux domaines. Aristote exprime en effet des soupçons très nets en la matière, sur les comparaisons poétiques notamment : « la comparaison est utile même en prose, mais il faut en user peu souvent, car elle a un caractère poétique. » 162 Et, de fait, il relève de nombreux défauts dans les métaphores d’Euripide ou de Gorgias, par exemple, dans les pages qui précèdent. De ce point de vue aussi, il est donc erroné de dire que la rhétorique d’Aristote était générale, comme le fait Genette : elle n’excluait pas seulement la dialectique authentique, mais également la poétique. Ce soupçon à l’égard de la poésie et donc de la littérature, généralement larvé, est à relativiser, à replacer dans le contexte rhétorique de l’ouvrage, qui porte davantage sur l’art des discours que sur celui des écrivains, même si des exemples littéraires sont donnés. Mais c’est bien dès Aristote qu’un soupçon s’exprime à l’égard de la poésie, de la littérature, comme art « mensonger ». L’un des jugements les plus négatifs apparaît au début du livre III, au moment où, après avoir trouvé les arguments, le rhéteur doit se préoccuper de leur donner une forme. L’auteur présente à la fois l’art du style et de l’action. Dans ce développement essentiellement consacré à l’action, c’est-à-dire ici à la technique de la diction, qui comprend la maîtrise du volume de la voix, de l’intonation et du rythme, il est difficile de savoir exactement sur quoi porte la critique. Il est probable que le jugement le plus négatif s’adresse à cette technique de l’acteur mais, dans tous les cas, il en rejaillit quelque chose sur l’art du style auquel elle est liée : « il semble que ce soit là un art grossier à en juger sainement. Mais, puisque dans toute son étude la rhétorique ne s’attache qu’à l’opinion, il faut, encore que ce ne soit pas là l’idéal, mais une nécessité, il faut donner à l’action les soins requis ». La querelle entre philosophie et sophistique trouve là de très nets échos : « les seules armes avec lesquelles il est juste de lutter, ce sont les faits, de sorte que tout ce qui n’est pas démonstration est superflu. Néanmoins, l’action a, comme nous l’avons dit, grand pouvoir, par suite de la perversion de l’auditeur. Aussi bien le souci du style est-il, au moins pour une petite part, nécessaire en toute sorte d’enseignement. » Cette dernière concession reste sévère : on sent que, pour Aristote, cette nécessité de travailler la forme est assez relative – ou, plutôt, mal fondée, sur la seule efficacité. Mais quelle est donc exactement cette « perversion de l’auditeur » ? Est-ce seulement un goût pour les illusions, pour les faux-semblants de la voix ? Aristote cite les concours où ce sont les acteurs qui font le succès des poètes, mais également les débats de la cité où l’on devine que les sophistes règnent en maîtres. On perçoit donc bien que l’art du style est condamné en tant qu’il englobe, entre autres, l’art de l’action, de la diction. Quelques lignes plus loin, le philosophe se désole des poètes qui atteignent la gloire « nonobstant l’insignifiance de ce qu’ils disaient, […] grâce à leur façon de le dire » et d’illustrer encore son propos avec Gorgias, qui pratiqua l’art oratoire dans un sens poétique.163 Le lien entre poésie et sophistique est encore suggéré ailleurs, dans le passage sur les mots ambigus par exemple, qui servent pour dire quelque chose quand on n’a rien à dire. Et Aristote d’ajouter : « ceux qui ont un tel dessein expriment ce rien en vers ».164 Même si Aristote vise principalement Empédocle ici, et donc un philosophe aussi, le propos n’en est pas moins éloquent : on en revient au passage précédent sur « le style de la prose », c’est-à-dire du discours, qui « est autre que celui de la poésie », qui doit s’en distinguer, parce que le style poétique n’est parfois que vacuité. L’idée est d’autant plus frappante qu’elle ne convainc pas forcément : Aristote signale luimême qu’« aujourd’hui encore les gens incultes pensent pour la plupart que les orateurs de ce genre parlent excellemment ». Or, s’ils sont populaires, n’est-ce pas qu’ils parviennent à faire passer leurs idées ? L’argument suivant ne convainc pas davantage mais il clarifie le débat : « l’histoire même le montre : même le style des auteurs de tragédie n’a plus le même caractère », leurs vers se rapprochent « de la prose », et leur vocabulaire « du parler courant ». Paradoxalement, Aristote prend donc un exemple poétique pour soutenir la nécessité d’une évolution « spécifique » de la rhétorique, vers plus de « naturel », de simplicité. On le voit, si le style « poétique » est à proscrire, c’est pour différentes raisons, qu’Aristote ne prend pas soin de sérier, et qui semblent parfois contradictoires : ce n’est pas tant parce qu’il est impropre à faire de l’effet, mais parce qu’il est éloigné du langage courant, parfois archaïsant, et donc susceptible d’en imposer pour de mauvaises raisons, mais c’est aussi parce que, parfois, il n’est pas clair et donc, là encore, capable d’emporter l’adhésion sans bonne raison ou, à l’inverse, de n’être pas compris. Enfin, il y a clairement une part de jugement de valeur, même si l’on peut avancer le risque de susciter le rejet : il est parfois pompeux ou comique de façon déplacée.