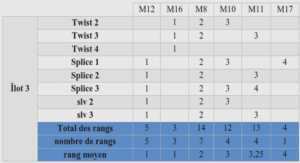«Réduire de moitié la pauvreté d’ici 2012», constitue un objectif ambitieux et requiert en conséquence le recours à de stratégies bien élaborées.
Pour faire de cet objectif une réalité, Madagascar, confronté à divers échecs issus du passé, a tenté de changer de tactique. Le pays se tourne actuellement, vers une approche territorialisée de son développement, vers le « développement par la base » devenu à la mode au niveau mondial et souvent imposé par la volonté des bailleurs de fonds.
Ce développement a comme point de départ le niveau local. On souhaite désormais un mode de fonctionnement s’opposant à l’ancienne approche top down qui a laissé de mauvais souvenirs et un long sillage d’échecs. Dans cette nouvelle vision du monde rural et du développement, les collectivités territoriales décentralisées (CTD) ont un grand rôle à jouer.
C’est dans ce sens que l’Etat procède depuis un certain temps à la réforme de son administration qu’il a cherchée à décentraliser après diverses tentatives de déconcentration. Les réformes datent déjà des années 90. Elles sont actuellement conduites à travers le Programme National de Décentralisation et de Déconcentration connu sous le sigle abrégé de PN2D. Ce programme s’inscrit sur une période de 9 ans, au terme de laquelle, le pays espère voir émerger « un développement national propulsé par les initiatives menées au niveau des CTD » (Lettre de politique de décentralisation et de déconcentration, 2005, p18).
Le concept de développement local
Essai de définition
Le développement local se présente comme lié à une localité donnée, à un territoire. Plus précisément, c’est « la contribution qu’un petit territoire apporte au mouvement général de développement en terme de plus value économique, social, culturel et spatiale » (chargé de mission auprès de Mairie-conseil, in Kolosy 2006). C’est le concours apporté par le développement de ce territoire au développement général de la nation.
Le développement local est aussi une méthode, une stratégie de développement parmi tant d’autres. Sa finalité est la même que celle du développement en général, c’est-à-dire l’amélioration du bien être de la population. Mais ce sont les moyens qu’il mobilise pour parvenir à cet objectif qui font sa différence. Le développement local ne se focalise que sur une petite partie seulement du territoire national. Pourtant, il touche aux différents aspects de la vie de la population concernée, au « développement en général », secteur, équipement local, institutionnel, social,… . Le développement local doit être global et multidimensionnel comme le souligne Kolosy (2006). Sont aussi valorisées dans cette politique, les initiatives de la population, la définition d’un projet commun, la mobilisation des ressources humaines et matérielles locales (Inter réseaux développement rural, p.6). Husson B.(2001, p1) définit le développement local comme « un processus qui permet de faire mûrir des priorités, de choisir des actions à partir de savoirs et propositions des groupes de populations habitant un territoire donné et de mettre en œuvre les ressources disponibles pour satisfaire à ces dites propositions. ». Selon cet auteur, les actions de développement devraient émerger des besoins réellement exprimés par les concernés. Ce que semble confirmé Prévost P. (2003, p 23) par « le développement local est un processus endogène d’accroissement durable du bien être d’une communauté. Il est celui qui émerge des initiatives et du dynamisme des communautés locales. ».
Emergence du concept
Le terme « développement local » est apparu pour la première fois vers la fin des années 50, à travers la théorie du développement endogène de John Friedman et de Walter Stöhr. Selon cette théorie, le développement est une démarche qui doit partir d’en bas. Il doit être conçu à partir des réalités du terrain, du vécu de la population. Pour cela, il doit être axé sur un territoire plus restreint que le territoire national et doit tenir compte des ressources au niveau de ce territoire. Il se doit aussi d’intégrer les pratiques locales : les traditions industrielles et les valeurs culturelles,… . (Kolosy, 2006) .
A partir des années 60, le concept fut mis en pratique dans les pays développés (PD). Après avoir constaté que les politiques décidées au niveau central ne correspondaient pas toujours aux besoins de la population, surtout à ceux des gens vivant dans les périphéries. La non correspondance a été particulièrement perceptible dans l’aménagement du territoire national. Lequel revenait à une administration qui ne connaissait parfois rien à la réalité de la localité aménagée, puisque se situant à une distance assez éloignée de cette dernière. (Husson B., 2001).
Dans les pays en développement (PED), la politique a eu plusieurs origines, notamment, les échecs des différentes politiques de développement qui y ont été menées et dont la politique d’ajustement structurel (PAS) a été le coup de grâce, l’émergence sur la scène internationale de la notion de développement durable et l’influence, entre autre aussi, des partenaires financiers.
– Les politiques mises en œuvres jusqu’ici au niveau des PED se ressemblaient toutes par le fait que ce sont des politiques macro-économiques globales. Les politiques macro-économiques générales telles que la planification, le libéralisme, ou les politiques sectorielles telles que les investissements à outrance sont toutes des politiques à grande dimension, appliquées sur une échelle relativement importante et donc peu ressenties au niveau local. Les échecs successifs rencontrés sur ce plan ont amené à réfléchir à un développement qui serait appliqué à des échelles plus cohérentes, qui s’appuierait sur des territoires un peu plus réduits mais surtout sur les populations concernées. Ces dernières doivent être parties prenantes des constructions des politiques qui les concernent (Rey P, 2007).
– Le fiasco des Politiques d’Ajustement Structurel (PAS) et les différentes critiques qui les ont suivies. En effet, non seulement les objectifs des PAS (une économie équilibrée) n’ont pas été atteints, mais du point de vue social, l’échec a été total. Aussi, il a été question d’aller directement soulager les hommes de leur pauvreté par un développement de proximité, qui aurait comme principal souci, le bien être de la population.
– L’émergence de la notion de développement durable dans les années 80 et 90.
De la prise de conscience de l’existence d’une capacité de charge de la terre a émergé sur le plan international, un tout nouveau concept, celui du développement durable. Il s’agissait, avec cette notion, de procéder à une gestion durable des ressources naturelles du fait justement que celles-ci n’étaient pas inépuisables. Aussi, afin de garantir leur pérennité, leur gestion a-t-elle été confiée à la population locale, c’est-à-dire aux gens vivants sur place. En accompagnement de la politique de gestion localisée des ressources, on a lancé, au niveau local, des petits projets de développement destinés à améliorer le niveau de vie des gens vivants aux alentours de ces ressources. En effet, l’on a mis en évidence l’existence d’une relation étroite entre exploitation des ressources naturelles et niveau de vie des ménages. La détérioration de leurs conditions de vie pousse les gens à surexploiter les ressources.
– L’influence des partenaires financiers, comme la Banque mondiale ou l’ensemble des systèmes des Nations Unies. A partir des années 97, ceux-ci ont axé leur stratégie d’intervention sur une approche participative. Ce qui sollicitait l’implication directe des bénéficiaires dans tous projets les concernant.
INTRODUCTION |