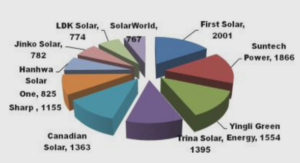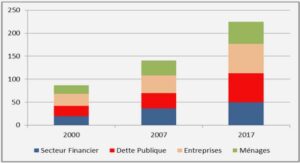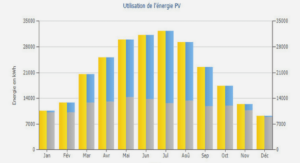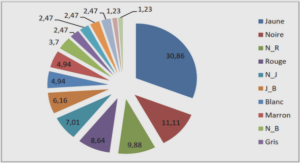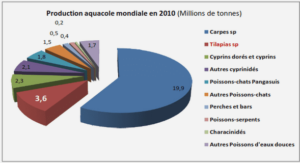Le capital-investissement peut-il soutenir durablement la croissance des entreprises ?
Quels indicateurs pour suivre l’impact du capital-investissement ?
La recherche sur le capital-investissement s’est intéressée à qualifier l’impact réel du capitalinvestissement sur la croissance à travers des études quantitatives reprenant les cadres économiques exposés précédemment. Les données utilisées proviennent de bases de données ou de sondages. La majorité de ces recherches visent ainsi à établir des corrélations ou des causalités entre la présence de capital-investisseurs et l’évolution d’indicateurs de performance des entreprises investies. Deux Partie I – Origines et limites du modèle classique de capital-investissement ? 58 approches sont utilisées : d’une part, un suivi de l’évolution de la variation de la performance intrinsèque de l’entreprise investie avant et après la prise de participation, d’autre part, des comparaisons, souvent sectorielles, avec des entreprises non soutenues par le capital-investissement (i.e. entreprises indépendantes ou marchés boursiers) afin d’isoler les effets de conjoncture de l’influence de l’investisseur. Ce champ est majoritairement constitué d’études économétriques, peu d’articles explorent en profondeur les leviers de création de valeur utilisés. Les analyses se font principalement selon trois variables : les résultats financiers, la productivité et l’emploi.
Buyout & croissance
Malgré l’article fondateur de Jensen intitulé « Eclipse of the public corporation » (Jensen 1989) présentant le capital-investissement comme la forme de gouvernance la plus efficiente, l’ère de raids hostiles qui a accompagné l’essor du buyout dans les années 80, a contribué à forger un imaginaire collectif extrêmement négatif autour des performances sociales du buyout et de son influence sur la pérennité des entreprises soumises à d’importants leviers de dette. Une première interrogation porte donc sur l’effet du buyout sur la pérennité de la croissance des résultats financiers et de la productivité de l’entreprise investie. En théorie, le buyout est un instrument permettant la réallocation de ressources disponibles pour une maximisation de leur usage. La vaste majorité des recherche produites sur les deux premières vagues de buyout (années 80 et années 2000) conclut à une amélioration de la productivité et des résultats financiers (Cumming, Wright et al. 2007, Kalplan and Stromberg 2009, Guo, Hotchkiss et al. 2011) sur les années suivant l’investissement. Cependant, croissance de rentabilité post-investissement n’implique pas nécessairement croissance à long terme pour l’entreprise. En fonction de la politique de redistribution, elle peut par exemple alimenter des gains supplémentaires pour les actionnaires, des salaires plus élevés, un ré-investissment, etc. Le second axe de cherche s’intéresse à l’impact sur l’emploi. Suite aux pratiques de dépeçage en vogue à ses origines, le buyout a largement été accusé par les médias et les syndicats de nuire à l’emploi et aux salaires. Cette question s’inscrit au cœur de débats politiques, notamment dans les années 2000 (House of Commons Treasury Committee 2007, ITUC International Trade Union Confederation 2007), faisant croître la menace d’un accroissement de réglementation de ces opérations. Contrairement à ces accusations, les recherches académiques autour de l’impact du buyout sur l’emploi, autant en quantité qu’en qualité, se révèlent plus nuancées. La majeure partie des articles portent sur le premier cycle du buyout aux Etats-Unis dans les années 80 (Kaplan 1989, Lichtenberg and Siegel 1990, Smith 1990, Opler 1992) et la période 1990-2003 au Royaume-Uni (Wright and Coyne 1985, Wright, Chiplin et al. 1990, Robbie, Wright et al. 1992, Robbie and Wright 1995, Bruining, Wright et al. 2005, Amess, Brown et al. 2007, Amess and Wright 2007, Amess and Wright 2007, Cressy 2011, Cressy, Munari et al. 2011, Gospel, Pendleton et al. 2011, Amess and Wright 2012, Weir, Jones et al. 2013, Amess, Girma et al. 2014, Goergen, O’Sullivan et al. 2014, Goergen, O’Sullivan et al. 2014). Plusieurs revues de littérature dressent des conclusions similaires: le buyout accroît significativement la rotation des salariés mais son impact net sur l’emploi s’avère limité (Kaplan and Strömberg 2009, Wright, Bacon et al. 2009, Wright, Gilligan et al. 2009, Goergen, O’Sullivan et al. 2011, Tåg 2012). Concernant les Etats-Unis, S. Kaplan montre en 1989 que la masse salariale post opérations de buyout (going private management buyout) augmente mais moins que la moyenne de l’industrie (Kaplan 1989). Par la suite, ce résultat n’est pas démenti mais précisé. Des recherches ultérieures montrent qu’un effet négatif existe mais 59 concentré sur les cols-blancs dont le nombre et les salaires diminuent (Lichtenberg and Siegel 1990), les transactions public-privé et les secteurs de la distribution et des services (Davis, Haltiwanger et al. 2008, Davis, Haltiwanger et al. 2014). Concernant le Royaume-Uni, les nombreux articles de M. Wright décrivent aussi des effets légèrement positifs ou peu significatifs (Bruining, Wright et al. 2005, Amess and Wright 2007, Amess and Wright 2012). R. Cressy apporte un nouvel élément en analysant les effets à court et long termes et conclut que l’assainissement des premières années laisse place à des emplois en plus grand nombre par la suite (Cressy, Munari et al. 2011, Weir, Jones et al. 2013). Le type de buyout provoque des effets différents. Ainsi, les MBO12 ont un impact positif alors que celui des MBI13 est négatif (Amess and Wright 2007, Goergen, O’Sullivan et al. 2014, Goergen, O’Sullivan et al. 2014). Dans une étude européenne, AK Achleitner et O.Kloeckner soulignent que la nature de l’actionnariat avant l’opération est aussi discriminante (Achleitner and Klöckner 2005). Ils montrent ainsi un effet allant de + 7,1% de croissance pour une entreprise familiale à – 3,8% pour un retournement. L’effet des buyout secondaires, des privatisations et des spin-off étant plus restreint (+1.6% à +3.4%). Les recherches s’étendent progressivement à d’autres pays, notamment en Europe et à des comparaisons en fonction de l’origine des investisseurs (nationaux ou étrangers (Olsson and Tåg 2018)). Deux articles révèlent la spécificité du cas français où la masse salariale augmente post-transaction (Boucly, Sraer et al. 2011, Guery, Stevenot et al. 2017). Ils l’expliquent par le large soutien de l’Etat aux acteurs du capital-investissement dans le pays qui influencerait la sauvegarde de l’emploi (Bacon, Wright et al. 2013). Les recherches sur l’évolution des salaires ou la modification des conditions de travail sont moins nombreuses mais concluent à un impact positif bien que dépendant aussi du type d’opération et du contexte national. Dans l’ensemble, ces recherches souffrent de plusieurs limites. Concernant les études d’impact sur l’emploi, tout d’abord, nombre d’entre elles intègrent dans les données quantitatives les emplois dus aux cessions et acquisitions. Toutefois, dépassé l’échelle de l’entreprise, vendre ne reflète pas forcément une destruction d’emploi tout comme acheter n’équivaut pas à une création (Appelbaum and Batt 2012). Ensuite, la plupart des données ne permettent pas de tracer l’interversion entre emplois à temps plein et temps partiel. Plus globalement, d’une part, la majeure partie des analyses quantitatives se réfère à des transactions de privatisation, notamment pour les périodes les plus anciennes, ce qui s’explique par la plus grande accessibilité des données. Or d’après les théories de l’agence (Jensen 1989), le passage du public au privé confère un atout significatif quant aux performances. Cependant, ce type d’opération est loin de représenter la majorité des investissements en buyout, notamment sur le dernier cycle (2012-2017) où il ne compte que pour environ 10% (Wright, Amess et al. 2018). D’autre part, les recherches empiriques sont restreintes au niveau des zones géographiques et temporalité. Elles se concentrent majoritairement sur les Etats-Unis et le Royaume-Uni, plus succinctement sur l’Europe. La littérature sur les autres zones dont l’Asie, reste rare alors que les chercheurs s’accordent sur l’impact du contexte institutionnel. Malgré l’évolution des pratiques d’investissement, les analyses sur les périodes récentes dont l’après-crise de 2008, s’avèrent encore peu nombreuses. Enfin, les différences d’impact décelées en fonction de la nature des transactions (privatisation, secondaire, etc.) et du type d’acteurs (management, externes, etc.) suggèrent que toutes les logiques d’investissement ne sont pas motrices des mêmes types de croissance. D’où un intérêt à préciser les stratégies actionnées pourtant systématiquement cachées 12 Management Buy-Out : désigne le rachat d’une entreprise par ses dirigeants ou ses salariés 13 Mangement Buy-In : désigne la reprise d’une entreprise par un ou plusieurs acheteurs étrangers à la société reprise dans ces recherches de corrélations et la question suivante : quelles sont les conditions dans lesquelles le buyout soutient une croissance persistante ?
Capital-risque et croissance
A contrario, le capital-risque, en tant que soutien à l’entrepreneuriat, est aujourd’hui majoritairement perçu par la société civile et les politiques comme un moteur indéniable de croissance. Les success-stories de start-up financées par ces investisseurs puis devenues de grandes entreprises (ex Google, Intel, Apple, Microsoft, Cisco, Facebook, Skype, Sun, Microsystems, Federal Express, Genentech, etc.) constituent une vitrine de l’impact positif du capital-risque sur l’emploi et la création de valeur financière. Pourtant, au début des années 2000, un autre courant décrivait les investisseurs en capital-risque comme des financiers passifs n’apportant que peu de valeur à part une contribution financière et pouvant donc être facilement remplacés par tout autre acteur apportant les mêmes fonds (Gompers and Lerner 2004). La démonstration empirique d’un lien de causalité entre emploi et capital-risque a été désignée comme un enjeu majeur par P. Gompers et J. Lerner, références académiques pour l’étude du capital-risque (Gompers and Lerner 2001). Par la suite, une relation a en effet été montrée au niveau macro-économique entre présence d’une industrie de capital-risque et croissance de l’emploi (Belke, Fehn et al. 2004). De même au niveau de l’entreprise, d’après une étude sur les années 90, l’annonce d’un nouveau tour de financement impulserait un pic de recrutement (Davila, Foster et al. 2003). Plus généralement, les start-up financées par le capital-risque auraient créé 600 000 emplois en Union européenne de 2000 à 2004 et offriraient de meilleurs salaires (Achleitner and Klöckner 2005). D’autres analyses montrent que les entreprises soutenues par le capital-risque croissent plus vite comparées à celles qui ne disposent pas de ce type de financement mais que leur avance ne dure pas toujours (Inderst and Müller 2009, Puri and Zarutskie 2012). L’indicateur phare qu’est le chiffre d’affaire pour la grande entreprise peut être remplacé par le taux de survie, de faillite ou de détresse financière. Les résultats sont contradictoires, en particulier concernant l’influence du capital-risque sur la survie de l’entreprise après leur introduction en bourse (Jain and Kini 2000, Manigart, Baeyens et al. 2002, Audretsch and Lehmann 2004, Pommet 2012). Les dirigeants d’entreprises soutenues par le venture capital étant la plupart du temps actionnaires, la littérature sur ce sujet croise celle sur les retours pour les investisseurs avec un intérêt porté à des indicateurs financiers tels que les plus-values de cession. Les raisons sous-jacentes à cette surperformance sont largement débattues et un champ de recherche s’est cristallisé autour de la question suivante : s’agit-il d’un biais de sélection ou d’une plus-value effective de l’investisseur ? La réponse varie notamment en fonction des secteurs et du type d’investisseur (Gerasymenko 2008, Inderst and Müller 2009).
INTRODUCTION |