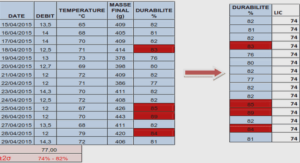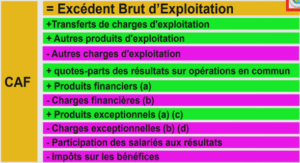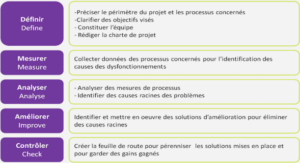L’ARCHITECTURE SCOLAIRE EN REGARD DE L’HISTOIRE DE L’ÉDUCATION
– Fin XIXème, genèse d’une l’architecture scolaire au service de l’idéologie républicaine Bien avant les lois Ferry, la loi Guizot de 1833 ordonnant à chaque commune de pourvoir à l’instruction primaire de ses enfants du peuple en fournissant un local pour la pratique scolaire, pose les bases de l’enseignement primaire en France et annonce la naissance de l’architecture scolaire.« La volonté d’attacher l’institution à un local est justifiée par le souci d’assurer la permanence de l’enseignement en un lieu donné, quel que soit l’instituteur.»
L’importance d’attribuer un cadre stable à la pratique d’enseignement devient la condition sine qanun de la pérennisation de l’école en tant qu’institution et de l’affirmation du pouvoir central. Jusqu’à l’application de cette loi, les constructions scolaires rivées au bon vouloir et aux finances des communes étaient restées timides, en particulier dans les campagnes où les espaces attribués à l’école étaient souvent inappropriés et insalubres. « Dans le courant du XIXe siècle, le développement des architectures fonctionnalistes, la politique interventionniste et centralisatrice de l’État, la mise en place des réglementations de la commande publique entraînent la multiplication des plans-types et exemples-modèles : une architecture normative et réglementaire s’installe au fur et à mesure de la mise en place des nouveaux pouvoirs. »
L’école communale fait alors l’objet d’un important travail de modélisation
« L’architecture scolaire s’assimile peu à peu à une architecture de catalogue. La construction une fois achevée, l’architecte, auteur du projet, l’inspecteur représentant l’administration pédagogique et le maire élu de la population et représentant l’administration territoriale, se réunissent pour la réception des travaux. Chacun des trois intervenants est en possession du projet approuvé et vérifie une dernière fois la conformité de l’œuvre édifiée avec leur « modèle ». » 99 Progressivement les différents gouvernements qui se succédèrent, renforcèrent leur pouvoir central en développant tout d’un réseau d’écoles de la République sur le territoire national.
Pour ce, la standardisation des bâtiments scolaires, annexée à un cadre référentiel incarnant la symbolique républicaine et sa fonction de « dressage institutionnel », s’élabore et se précise dans les coulisses du pouvoir central. En 1871, le recueil des modèles de maisons écoles et mairies de l’architecte César Pompée et la parution de celui de Félix Narjoux en 1880, confirment la volonté gouvernementale d’uniformiser l’architecture des bâtiments scolaires et d’en faire une architecture monumentale au service la construction républicaine. L’architecture scolaire, alors profondément ancrée dans un processus de symbolisation, est utilisée comme un support de diffusion et d’enracinement des nouvelles valeurs. Cet appareillage normatif et réglementaire de standardisation des écoles va lentement se répandre pour consolider le nouveau pouvoir à l’échelle du territoire.
L’entre-deux-guerres, la montée en puissance du fonctionnalisme et de l’hygiénisme
une architecture scolaire à la solde du progrès social et de l’innovation Au tournant du XXe siècle, d’illustres pédagogues tels John Dewey, Maria Montessori, Roger Cousinet ou Célestin Freinet pour n’en citer que certains, rejettent la conception traditionnelle de l’enseignement axée sur le contrôle et la soumission des élèves et préfigurent l’éclosion du mouvement de l’école Nouvelle qui œuvre pour une école moderne, active et plus adaptée à la psychologie enfantine.
Ce nouveau paradigme met l’élève au centre de la pratique éducative et souscrit au précepte qu’il est acteur de sa propre formation par son implication dans les apprentissages et au fonctionnement de l’école ; ce qui n’est pas sans conséquences sur la vision des espaces scolaires. Médecins, architectes et pédagogues œuvrent alors à l’introduction du bien-être qui se traduit par une amélioration des bâtiments scolaires en termes d’exposition à l’ensoleillement et à l’éclairage naturel, de création d’espaces verts, de recherche de fonctionnalité et confort du mobilier et de choix judicieux des couleurs et des matériaux.
La prise en compte de ces critères dans la construction des bâtiments scolaires entraînent l’apparition de nouvelles formes architecturales scolaires dont les écoles de plein air sont les figures de proue de l’audace des architectes du courant moderne.