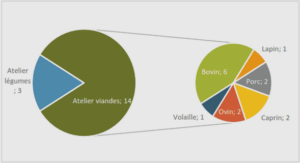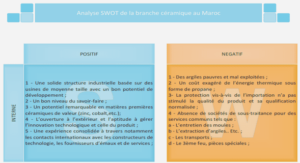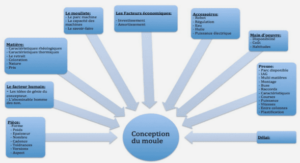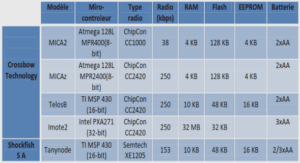L’Arc de Galère à Thessalonique (FICHE 4) (PL. XXXI. 2 – 3 – XXXII, CXXXI – CXXXVIII)
L’Arc de Galère est un monument qui fut érigé à Thessalonique par l’empereur Galère sous la tétrarchie de Domitien. Il fait partie d’un complexe qui comprend l’arc, le palais de Galère, la rotonde1258, l’octogone et l’hippodrome, qui ont tous été construits dans un laps de temps très court (PL. XXXI. 2 – 3). Pour cela il a fallu agrandir la cité en démolissant la muraille existante et en en reconstruisant une autre un peu plus loin.
L’Arc de Galère se trouve entre le palais et la rotonde. Il se situait au croisement du decumanus, la Via Egnatia1259 et de l’actuelle rue Dimitrios Gounaris. Il était entouré de portiques sur la Via Egnatia et servait de lien entre le palais et la rotonde sur l’autre voie.
L’arc comporte trois baies, une monumentale centrale et deux latérales, chacune composée de quatre piliers dont chaque face était décorée de scènes historiques.
Les vestiges que nous pouvons observer maintenant ne représentent que la moitié de l’arc d’origine. Pendant longtemps on a cru que l’arc ne comportait qu’une arcade, c’est pourquoi il a été défini, à tort, d’arc tétrapyle, or celui-ci comporte huit piliers ou pilastres et non quatre. L’arcade se trouvant au nord repose sur deux piliers de la partie centrale et deux autres piliers. L’arcade du sud continue aussi du centre sur deux piliers de l’arcade centrale, tandis que l’autre partie est posée sur des pilastres insérés dans le palais de Galère. Ainsi, il semblerait que l’arc et le palais soient étroitement liés, formant un ensemble architectural. Le fait que l’arc se trouvait au croisement de plusieurs rues explique que sa partie centrale soit tétrapyle.
La partie conservée de l’arc montre que les piles étaient totalement recouvertes de reliefs qui racontent les campagnes menées par Galère en Orient.
Les piles centrales de l’arc ne mesurent pas moins de 5,20 mètres de côté. Celles-ci se composent de quatre faces toutes décorées, à raison de quatre bas-reliefs par face organisés en quatre frises superposées (PL. CXXXI – CXXXV) Cette ordonnance de quatre pourrait symboliser les tétrarques, quatre empereurs qui sont à la tête de l’empire à raison de deux en Orient, deux en Occident. Les bas-reliefs sont séparés les uns des autres par des tores (PL. CXXXVI).
Contrairement à l’ensemble des monuments dont les reliefs se lisent du bas en haut, dans le cas de l’arc de Galère c’est le contraire. La lecture des reliefs débute du haut de chaque pile, allant vers le bas, avant de continuer sur la face suivante de cette même pile1260. Ce détail fait de l’arc une particularité au point de vue iconographique. La lecture des différents reliefs se fait dans un ordre logique qui est celui chronologique des événements. Le relief représentant les Tétrarques avec les figurations des provinces de Mésopotamie et d’Arménie se situe sur le pilier ouest (ou Colonne B), sur la face nord-est (PL. CXXXIV), troisième bas-relief en partant du haut (PL. CXXXVI).
Les monuments entre public et privé : les thermes ou bains
La notion de public ou privé est assez complexe en ce qui concerne les thermes. Ceux-ci peuvent être privés ou publics, voire les deux à la fois. En effet, cela dépend de deux critères. Dans un premier temps tout dépend du propriétaire. Il peut s’agir d’un établissement balnéaire appartenant soit à la cité, soit à un particulier. Dans le premier cas les thermes sont publics, dans le second ils sont privés, mais seulement en ce qui concerne leur appartenance. En effet, un autre critère, l’accès, joue également sur ce point. Par exemple on peut avoir des thermes appartenant à un particulier, donc privés, mais ouverts au public. Dans ce cas il s’agit d’un établissement semi-public, à la fois public et privé. Le propriétaire peut également se réserver l’accès à titre privé, ne l’ouvrant pas au public, dans ce cas nous avons affaire à un monument totalement privé.
Il est difficile de savoir si les thermes sont publics, privés ou les deux car très souvent, par manque d’inscriptions ou de sources mentionnant le propriétaire, il n’est pas possible de le connaître.
Pour les Thermes des Provinces à Ostie, nous n’avons aucune idée sur leur appartenance. De même pour les Thermes E d’Antioche, aucune indication ne nous est parvenue sur leur usage et leur propriétaire. Dans les deux cas il n’est donc pas possible de savoir si nous avons affaire à des thermes publics, privés ou les deux.
En raison de cette ignorance, je préfère placer ces établissements dans une partie consacrée aux monuments à la fois publics et privés.
Les deux ensembles balnéaires ici étudiés sont nommés thermes or il s’agit de bains car aucun espace dédié au sport ou à la culture ne s’y trouvait. Je garde néanmoins le nom de thermes pour les nommer (« Thermes des provinces » et « Thermes E »), car c’est sous ce nom qu’ils sont connus, mais je tiens à préciser que nous avons affaire à des bains.
Les Thermes des provinces à Ostie (FICHE 5) (PL. CXXXIX – CXL)
Les Thermes dites des provinces se trouvent en Italie, à Ostie dans le Latium, plus précisément dans la Regio II, Insula V, à côté de la Caserne dei Vigili, et en partie dessous. En effet, les thermes ont été construits dans la première période de construction de la cité, celle-ci a été partiellement reconstruite tout en étant surélevée en raison de la montée des eaux et de la nappe phréatique sous Ostie. Les travaux furent effectués sous Hadrien et achevés sous Antonin le Pieux. C’est durant cette seconde période que furent élevés la Caserne dei Vigili et les Thermes de Neptune. Avec la construction de ce nouveau quartier, les Thermes des provinces furent détruits et recouverts, marquant la fin de leur activité.
En raison de la présence de la Caserne dei Vigili au-dessus, seule une partie du bâtiment a été dégagée, ne permettant pas de connaître le plan précis de l’édifice balnéaire. Une tranchée de 120 m de long sur 7,5 m de large fut ouverte à l’occasion de fouilles archéologiques entreprises en 1912, mettant au jour la mosaïque illustrant les provinces (PL. CXXXIX – CXL). C’est cette mosaïque qui donna le nom de thermes des provinces à l’établissement.
Cette fouille partielle, mettant au jour neuf espaces, permit néanmoins de connaître quelques détails sur le bâtiment. On aurait affaire probablement à un plan asymétrique avec un parcours qui semble être à itinéraire rétrograde..
La mosaïque se trouve dans une pièce de 13,20 m de long, qui semble avoir été un secteur froid, probablement un frigidarium. Il s’agit de la seule mosaïque ou décoration figurée retrouvée dans les thermes, il n’est donc pas possible de faire un lien avec une quelconque autre représentation qui indiquerait si ce thème était utilisé dans l’ensemble des thermes où s’il se trouvait uniquement dans cette pièce. Ce qui est certain, c’est que la mosaïque recouvrait le sol d’un bassin d’eau.
Les Thermes E d’Antioche (FICHE 6) (PL. XXXIII – XXXV, CXLI – CXLII)
Ce sont des campagnes archéologiques qui ont eu lieu entre 1933 et 1936 qui ont permis de mettre au jour des établissements balnéaires à Antioche, dans la province de Syrie (PL. XXXIII). Ceux qui ont été découverts ont été répertoriés sous le nom d’une lettre. Ils sont au nombre de six jusqu’à maintenant, allant de la lettre A à la lettre F et se situent dans le nord de la cité, au nord du stade byzantin. Les thermes A, B, C et D se trouvent proches les uns des autres. Les thermes E et F sont un peu plus éloignés mais ne dépassent pas les 1,5 km à vol d’oiseau. A l’exception des Thermes F, tous se trouvent sur l’île formée par l’Oronte (PL. XXXIV).
Les Thermes E sont des bains de petites dimensions, tout comme les Thermes A, comparés aux Thermes C qui sont monumentaux. De plus tous les deux correspondent plus au type des bains rencontrés en Grèce et en Asie Mineure qu’à ceux que l’on retrouve en Syrie, et cela malgré le fait que l’on soit en Syrie. D’autres thermes mentionnés par Malalas1262 nous sont connus. Ils portent des noms d’empereurs, généraux ou gouverneurs, et se situent de l’autre côté de la cité, à deux exceptions près, mais leur localisation n’est pas certaine car elles n’ont pas été attestées par des fouilles archéologiques. Seul le texte de Malalas nous indique leur existence.
Christine Kordoleon classe les Thermes E dans les bains publics, à en croire le plan sur lequel elle indique qu’il s’agit d’un « restored topographical plan of Antioch with real and hypothetial locations of public baths »..
La mosaïque se trouve dans les Thermes E d’Antioche, plus précisément dans le hall qui donne accès aux différentes pièces (PL. XXXV).
Lorsque les baigneurs entraient dans les thermes, ils traversaient le vestibule qui s’ouvre sur le hall. Tous ceux qui se rendaient dans les Thermes E étaient donc obligés de passer par le hall et pouvaient donc observer cette mosaïque sous leurs pieds, avant de se diriger soit vers les bains chauds à leur droite, soit vers les bains froids à leur gauche. A partir de ce hall ils pouvaient également se rendre dans le dressing, puis dans le vestiaire afin d’y déposer leurs affaires, et aux latrines avant d’entrer dans les différents bains. Parmi les mosaïques des Thermes E conservées, celle du hall, comprenant le panneau de Gè et Karpoi (PL. CXLI), est une des deux seules à représenter un décor figuré. L’autre est la mosaïque qui se trouve dans le vestibule, première salle que traversait le baigneur en entrant dans les thermes. La position de la mosaïque de Gè et Karpoi se trouve dans un lieu de passage obligatoire pour ceux qui fréquentaient les lieux, ce qui explique, comme pour celle du vestibule, la présence de motifs figurés.
Contrairement au cas des Thermes des provinces d’Ostie, cette mosaïque n’était pas faite pour recouvrir le fond d’un bassin. Il s’agit d’un revêtement de sol qui n’est pas destiné à être submergé, néanmoins cela ce change rien à sa confection.
Les monuments privés : les uillae et domus
La Villa de Fannius Sinistor à Boscoreale (FICHE 7) (PL. XXXVI – XXXIX, CXLIII – CXLIV)
La villa de Fannius Sinistor se situe dans la cité de Boscoreale, plus précisément au lieu-dit de la Grotte Franchini dans le quartier nommé « Pagus Augustus Felix Suburbanus ». Le nom de Boscoreale n’apparaît qu’à l’époque médiévale. Cette région fertile à l’époque romaine devint par la suite une réserve de chasse des rois de Naples prenant le nom de Nemus Regalis (Bois Royal), qui donnera Boscoreale. Boscoreale se situe dans la baie de Naples, à 1,5 km du nord de Pompéi (PL. XXXVI).
La villa dont il est question comporte une partie destinée à l’habitation du propriétaire (PL. XXXVII – XXXVIII) et une autre pour l’exploitation agricole1264. Boscoreale se situe sur les pentes du Vésuve, des terres très fertiles ont permis l’installation de nombreuses cultures depuis plusieurs siècles. Durant l’Empire Romain se trouvait à Boscoreale un domaine agricole important consacré en grande partie à la culture de la vigne pour la production de vin et un peu à la culture de l’olive pour la confection de son huile. Nous en avons en partie connaissance par la découverte de divers pressoirs et de dolia. Les pentes du volcan accueillaient de luxueuses résidences comme on en retrouve à Pompéi et à Herculanum. La baie de Naples – alors Neapolis – était le lieu de villégiature le plus recherché durant le Ier siècle ap. J.C., attirant une grande partie de la population aisée.
La fresque se situe sur le panneau central du mur ouest du « salon H d’Aphrodite1265 » (PL. XXXIX). La partie de la villa concernée est la partie privée, destinée à son propriétaire.
Cette pièce est composée de neuf fresques peintes sur les murs, représentant des figures isolées ou en groupe (PL. CXLIII). Lors de sa découverte, seules huit subsistaient, la neuvième étant recouverte d’un enduit. Chaque scène est séparée par une colonne peinte en trompe-l’œil. Sur le mur nord figurent, de gauche à droite, Dionysos et Ariane (PL. CXLIII. D), Aphrodite et Éros (PL. CXLIII. E) et les trois Grâces (PL. CXLIII. F). Sur le mur ouest on retrouve une fausse porte avec un vieil homme qui s’appuie sur un bâton (PL. CXLIII. A, CXLIV. 1), deux femmes se faisant face (PL. CXLIII. B, CXLIV) et le panneau recouvert d’enduit dont le décor a été perdu (PL. CXLIII. C). Sur le mur est sont représentés une femme jouant de la lyre avec une petite fille (PL. CXLIII. G), un homme et une femme assis sur des sortes de trônes (PL. CXLIII. H), et une femme seule tenant un bouclier (PL. CXLIII. I). Sur les huit fresques retrouvées intactes, six ont été sauvegardées.
La fresque qui nous intéresse est celle qui illustre deux femmes se faisant face (PL. CXLIII. B, CXLIV) mais sa compréhension n’est possible que par l’étude de l’ensemble iconographique de la pièce qui forme un tout, une histoire.
La Villa d’Africa à El-Jem (FICHE 8) (PL. XXVIII, XL, CXLV – CLI)
A El Jem se trouve une villa qui se situe dans le quartier sud-est de la cité (PL. XL). Elle a été découverte suite à une tentative de construction illicite qui a été interrompue par Mohamed Mahjoub. Les fondations creusées de cette construction ont permis de mettre au jour une mosaïque. Cette découverte a mené à la mise en place de fouilles archéologiques qui ont abouti à la découverte d’un établissement thermal, lequel a permis de découvrir la Villa d’Africa en cherchant son entrée1266. La demeure est l’une des plus importantes de l’Afrique du Nord en raison de ses dimensions de grande ampleur. La présence d’un grand péristyle entourant un vaste jardin orné d’un bassin imposant, indique la richesse de la demeure. En effet, El Jem se situe en Afrique Proconsulaire, dans la partie de la province où l’eau n’est pas aussi abondante qu’elle peut l’être à Carthage..
La villa est composée de deux grandes parties. La première est publique, avec des pièces qui semblent être consacrées aux réceptions comme le montre la présence d’un oecus-triclinium et d’autres salles. La seconde partie est d’ordre privé, réservée à la famille résidant dans les lieux, avec la présence de petits salons et de chambres.
La villa a été nommée Villa d’Africa en raison de deux mosaïques qui y ont été retrouvées, toutes les deux dans la partie privée. L’une des deux mosaïques illustre en son centre, la figuration d’Africa sous la forme d’une figure féminine représentée en buste, avec la figuration des quatre saisons autour. Elle se trouve dans une sorte de petit salon, tandis que l’autre, celle qui nous intéresse, est située dans une chambre à coucher.
Cette dernière pièce mesure 6 mètres sur 4,5 mètres. Sa fonction a pu être établie grâce à l’organisation du pavement au sol qui se compose de deux parties. L’une est décorée de motifs géométriques, elle devait accueillir le lit. Une décoration géométrique pouvait être cachée par un lit, contrairement à une décoration figurée qui devait être à un endroit où l’on pouvait sans peine l’observer. L’autre partie était décorée d’un panneau figuré (PL. CXLV). Avec ses dimensions de 3,49 mètres sur 3,44 mètres, sans prendre en compte la frise autour, il prenait la totalité de la largeur de la pièce. Il faut imaginer que la mosaïque était positionnée de telle manière à ce que la personne allongée sur le lit pouvait voir les différentes figures présentes sur le panneau. La mosaïque n’était donc pas faite pour être vue par tous car nous n’avons pas affaire à un triclinium qui pouvait réceptionner trois personnes, comme on le retrouve à la Maison de la Cilicie à Seleucia Pieria..
La mosaïque ne laisse pas de place pour y mettre un ensemble de trois lits formant un U. Cette mosaïque était donc vue uniquement par ses propriétaires et n’avait pas pour but d’être exhibée à tous.
La Villa Tiburtina d’Hadrien à Tivoli (FICHE 9) (PL. XLI – XLII, CLII – CLIV)
Le choix de Tivoli pour la construction d’une villa n’est pas anodin. Même si on connaît aussi bien la cité grâce à la villa d’Hadrien, c’est dès le IIe siècle av. J.C. que la cité de Tivoli devient un lieu de villégiature pour les nobles romains. A partir du Ier siècle av. J.C., de nombreuses uillae s’installent dans cette cité située à moins d’une journée de Rome.
Les nobles pouvaient ainsi se retirer à la campagne dans leur uilla urbana, loin de l’agitation de Rome. Avant Hadrien, Jules César, Catulle, Horace ou encore Mécène y firent construire chacun une villa. Celle d’Hadrien reste le meilleur exemple en raison de ses dimensions importantes, s’étendant sur presque 102 hectares. Plus qu’une uilla, c’est presque une cité entière que fit construire l’empereur en raison du nombre important d’édifices qui y furent élevés (PL. XLI – XLII). Une partie de la uilla existait déjà auparavant. Elle se composait alors du palais daté de la République, fin du IIe siècle – début du Ier siècle av. J.C.
Ces édifices ont la particularité de reproduire des monuments connus qu’Hadrien visita lors de ses voyages à travers l’Empire1269. Tous les types d’architecture y sont représentés : temple, théâtre, bibliothèque, appartements, portiques, bains, … tous ceux que l’on peut retrouver dans une cité du IIe siècle ap. J.C.
D’après l’Histoire Auguste, si ce texte s’avère fiable, il est certain que toutes les provinces étaient représentées sous la forme de statues, comme celle ici présentée. Cela n’a rien d’étonnant puisque Hadrien fit émettre une série monétaire représentant les provinces romaines, et quelques cités ayant un statut à part, sous la forme de trois types..
« Tiburtinam uillam mire exaedificauit, ita ut in ea et prouinciarum et locorum celeberrima nomina inscriberet, uelut Lycium, Academian, Prytanium, Canopum, Poecilen, Tempe uocaret. et, ut nihil praetermitteret, etiam inferos finxit. »
(trad.. : Il orna d’édifices admirables sa villa de Tibur : on y voyait les noms des provinces et des lieux les plus célèbres, tels que le Lycée, l’Académie, le Prytanée, Canope, le Pécile, Tempé. Ne voulant rien omettre, il y fit même représenter le séjour des ombres.) (Histoire Auguste, Hadrien, XXVI, 5)
Comme l’indique le texte, il y a une volonté d’introduire d’une certaine manière les provinces dans l’architecture de la villa à travers les monuments les plus célèbres de l’Empire. On est plus que tenter de voir à travers l’organisation de la villa un lieu où sont représentées les provinces de l’Empire, comme nous l’atteste les différentes architectures de la villa qui ont pu être conservées et interprétées. Par exemple, le Serapeion fait allusion à l’Égypte et le Canope à Alexandrie (qui, rappelons-le, est considérée « hors d’Égypte »1271, donc avec un statut de cité à part ; d’ailleurs Alexandrie figure dans la série monétaire des provinces d’Hadrien).
La présence de la statue illustrant Cappadocia (PL. CLII) peut donner une autre indication, complétant celle qui vient d’être mentionnée. On peut en effet supposer que cette statue n’était pas isolée et que d’autres illustrant les autres provinces présentées à travers l’architecture de la villa étaient présentes. Ainsi, on pourrait avoir pour chaque monument, l’inscription de la province en question, comme il est indiqué dans l’Histoire Auguste (si on se fie à la véracité de la source !!!!) « ita ut in ea et prouinciarum (…) nomina inscriberet », accompagnée chacune de la personnification de la province sous la forme d’une statue.
Il se pourrait même que parmi les statues retrouvées, certaines représentent une province mais qu’elles aient été interprétées différemment. Par exemple, une des statues du Canope ou du Serapeion illustre une figure féminine tantôt interprétée comme la figuration d’Isis, tantôt comme celle d’une de ses prêtresses (PL. CLIV)1272. Bien que ces interprétations aient tous les arguments pour ne pas être remises en question, il faut rappeler que la personnification de l’Égypte est représentée avec les attributs d’Isis et de ses prêtresses comme nous le rappellent des séries monétaires de l’époque d’Hadrien figurant Aegyptus (PL. LXXXIX. 4 – 6)1273. Dans toutes ces représentations monétaires, la personnification tient un sistrum, contrairement aux autres attributs qui sont absents sur certaines variantes.
On retrouve également cet instrument comme attribut permettant l’identification de la province dans la mosaïque de la Maison d’Africa à El Jem (PL. CXLVIII)1274. On y aperçoit la figure féminine en buste accompagnée du sistre. Sa présence en compagnie d’autres figurations de provinces ne laisse aucun doute sur son identification. Cela indique bien l’importance de l’instrument pour illustrer la province à cette période, or la présence de l’objet en cas de figure isolée est automatiquement interprétée comme étant la figuration d’Isis ou d’une de ses prêtresses1275. Il en est de même pour celles figurant Alexandria1276 (fig.). Il existe donc, dans ce cas, une possible ambiguïté sur l’interprétation de la figure. D’autant plus que la statue de Cappadocia et celle interprétée comme étant Isis sont de même hauteur et sont sculptées dans le même marbre, celui de Paros.
Dans leur ouvrage, William MacDonald et John Pinto émettent, à partir de la source issue d’Histoire Auguste, l’hypothèse que les inscriptions pouvaient être placées sur la base des statues représentant chacune une province romaine1277. Ils imaginent ces statues pouvant se situer dans le théâtre, comme ce fut le cas pour le Théâtre de Pompée et le Porticus ad Nationes d’Auguste.