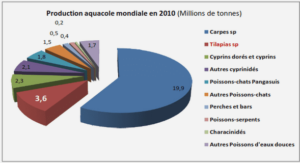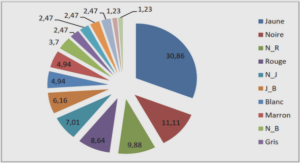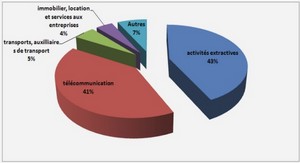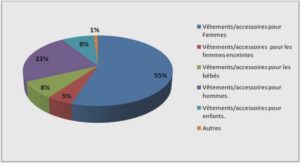Concepts de l’approche participative
L’approche participative a fait son apparition depuis les années 1970. En 1976, il a été adopté par les programmes d’action pour le développement qu’une politique orientée vers la satisfaction des besoins essentiels demande que la population y participe aux discussions par l’intermédiaire des organisations de son propre choix. C’est dans cette optique que s’inscrit l’approche participative pour le développement. C’est une approche large qui inclut la prise en compte des institutions, de la gouvernance, et la participation des acteurs. L’approche participative s’inscrit dans le cadre de développement Humain.
La participation est une approche d’intervention qui consiste à impliquer les populations à différentes étapes de la réalisation des projets.
D’après TIKARE et al. en 2001, le processus participatif est processus à travers lequel les agents influencent et partagent le contrôle et la fixation des priorités dans la définition des politiques. L’approche participative est fondée sur une interaction entre projets et population. Elle consiste en une mobilisation de travail plus ou moins volontaire et enthousiaste de la population. Elle se manifeste par le fait d’être consulté avant la mise en œuvre d’un projet, de contribuer à une enquête sous forme d’entretien collectif au profit de l’équipe du programme et politique, de bénéficier une action censée renforcer le pouvoir, d’être invité à une négociation pouvant être débouché sur des décisions en sa faveur.
la participation est un mode d’organisation sociale où le pouvoir de décider ne serait plus confisqué sur quelques mains mais systématiquement partagé avec les personnes composant la communauté de vie. Les populations, considérées comme marginalisés par les anciennes stratégies, vont prendre, alors, part à l’élaboration, à la prise de décision et suivi d’intervention de développement. La participation est, donc, un moyen pour atteindre les besoins de la population et renforcer ses capacités à devenir des acteurs de leur propre développement.
Participer, c’est prendre part aux efforts mais aussi aux décisions et aux fruits procurés par les efforts. Cela implique une certaine transformation au niveau des relations de pouvoir. Cela réplique des principes des anciennes stratégies de développement qui excluent certaines catégories de la population pauvre du processus.
Il existe trois principes fondamentaux qui se rattachent au processus participatif : D’abord, l’appropriation ou ownership : cela consiste en une implication active de l’ensemble des acteurs de la société dans l’élaboration, suivi des stratégies de développement. Cela se manifeste d’abord par l’implication du gouvernement dans le processus. Contrairement aux anciennes stratégies de développement, qui consiste en un « développement d’en haut » imposé par les bailleurs de fonds, le gouvernement n’était considéré que comme des exécutants des décisions prises par les bailleurs de fonds.
Mais outre cela, cela implique également l’appropriation par la société civile qui regroupe la population. Cela facilite l’adhésion de la population dans les politiques de développement, par exemple dans les mises en œuvre des projets de développement. Cela s’inscrit avec le concept de gouvernance considéré comme condition de réussite des politiques. La gouvernance se manifeste avec deux conditions : meilleure prise en compte des contextes économiques, sociopolitiques et institutionnels, spécifiques à chaque pays et aussi adhésion aux politiques des gouvernements de la population. D’où, l’intérêt de mettre en œuvre l’approche participative qui facilite l’appropriation de la population.
Développement et approche participative
Le développement socio-économique a toujours été une préoccupation majeure des différents pays. Le développement doit relever, actuellement, les défis auxquels l’humanité fait face: l’explosion démographique, insuffisance de ressources, manque d’infrastructure de base. La participation de la population aux initiatives de développement est primordiale car cela permet d’augmenter la capacité, de comprendre les désirs des bénéficiaires.
L’approche participative est surtout apparut dans le discours de développement local et du développement durable.
Dans le cadre du développement local, l’approche participative se concrétise dans la mise en œuvre des différents projets de développement. Le développement local se rapproche de la notion de développement au Ras du sol qui consiste en une « prise en charge, partielle ou totale, par les communautés ou les groupement des communautés, des responsabilités d’actions directes
correspondant à leurs besoins, aux priorités qu’elles apprennent à établir en prenant conscience des problèmes qui affectent leur niveau de vie et leur bien être ».
Le développement local est, donc une intervention structurée, organisée, à visé global et contenu dans un processus de changement . C’est une approche qui tend à privilégier les acteurs au niveau local, les infrastructures, les réseaux sur les institutions. Il se manifeste, par la valorisation des ressources intérieures d’un territoire donné et le privilège des acteurs locaux comme acteurs à part entière du développement. D’ailleurs, cette notion s’est apparut depuis la valorisation des ressources endogènes par l’intégration des théories sur le développement endogène par John FRIEDMAN et Walter STOHR. Le développement local a comme outil essentiel l’approche participative. Il se fonde sur la responsabilisation des communautés rurales en matière de programmation, de gestion de ressources financières affectées au développement, et à l’exécution et suivi de la programmation.
Les échecs du développement imposé d’en haut
Les théories de modernisation : La théorie de modernisation trouve son origine dans le discours de TRUMAN en 1949, qui se fonde sur quatre éléments essentiels :
Les pays occidentaux sont les pays développés, les autres sont sous développés . Les causes du sous développement sont internes. Il s’agit d’un manque de progrès technique. L’occident doit diffuser ses technologies au profit des pays sous développés.
Cette mission se veut humaniste en s’intéressant à supprimer les souffrances des pays du Sud en les suscitant à imiter les pays du Nord c’est-à-dire à suivre la voix sur laquelle se sont engagés les pays occidentaux. C’est la théorie de la convergence Le sous développement est, alors, conçu pendant ce temps, comme un simple retard de croissance c’est-à-dire retard sur les pratiques adoptés par les pays riches. Il suffit, donc, de suivre les modèle de développement adopté par ces pays c’est-à-dire les mêmes politiques, les mêmes mesure et surtout l’adoption des mêmes technologies. Ainsi, l’industrialisation, la modernisation de l’agriculture et la promotion de l’exportation était au cœur des débats sur le développement.
L’approche top down du développement : L’approche top down ou développement d’en haut est une stratégie de développement préconisée par les bailleurs de fonds. Le Programme d’Ajustement Structurel en est une illustration.
Avec l’existence des crises pétrolière de 1973 et 1979, les Pays En Développement ont été confrontés à une forte crise de dettes dans les années 1980 qui a porté préjudice sur les équilibres économiques de ces pays. Pour les aider à surmonter les blocages structurels et à rembourser leurs dettes, les bailleurs de fond leur ont accordés des prêts en les soumettant à de nouvelles conditionnalités qu’est la Programme d’ Ajustement Structurel (PAS). Ils prônent que l’échec des anciennes stratégies de développement à savoir développement autocentré réside dans une place trop importante accordée à l’Etat et une faible ouverture au commerce international.
Ainsi, ils ont décidé de prendre en main les actions et les programmes de développement des PED à savoir les différents projets de développement. Le PAS est une stratégie de développement qui se fonde sur le modèle de développement libéral.
Valorisation de la population et de l’échelon locale
Approche buttom up et la valorisation de l’échelon locale
Suite à l’échec des stratégies de développement « top down », un nouvel axe stratégique est adopté. Il s’agit du développement par le bas ou l’approche « buttom up » à l’origine même des différents projets axés sur la population. L’approche « buttom up » est une approche de développement qui s’appui sur l’approche participative. Se rapprochant de la notion d’ «approche ascendant», « démocratie locale », «gestion concertée» etc.… l’approche « buttom up » exprime les variantes d’une concertation et d’une démarche collective d’appropriation de l’avenir d’un territoire par sa population.
Dans cette démarche, la population et les acteurs locaux sont invités à s’exprimer et à participer aux orientations du territoire en matière de développement suivant leurs attentes, leurs visions et leurs projets.
La conception de l’ « approche buttom up » s’est apparut en 1950, depuis la période de John FRIEDMAN et Walter STÖHR qui ont conçu la théorie du développement endogène. C’est une approche volontariste qui conçoit le développement comme une démarche partant du bas privilégiant les ressources endogènes. Elle fait référence aux traditions individuelles locales et insiste sur la prise en compte des valeurs culturelles et sur les recours à des modalités coopératives.
L’approche « buttom up » met l’accent sur les rôles des organisations de la société civile. Dans cette optique, les objectifs macroéconomiques ne sont plus considérés comme seuls indicateurs à atteindre mais le développement est pris dans un sens beaucoup large en intégrant les dimensions sociales et économiques pour répondre aux besoins de l’ensemble de la population de la communauté.
Approche populiste du développement
Depuis fort longtemps, les stratégies et politiques de développement avaient tendance à marginaliser les populations pauvres. La prise en compte de la population en tant qu’acteurs de développement est apparut avec l’avènement des théories sur le capital humain.
L’approche populiste du développement a été favorisée par Chambers et Cernea depuis les années 1990. Ils ont tout deux souligné l’importance de la place que les populations défavorisées ont dans le processus de développement.
Chambers a souligné qu’il est impératif que les intervenants changent de modes de pratiques en matière de développement en incluant ce qu’il appelle « outsiders » c’est-à-dire les populations les plus défavorisées aux différentes politiques de développement. Ainsi, il suppose un changement de relation de pouvoir dans ses théories en soulignant trois points importants :
Chambers exige que les intervenants dans les domaines politique et économique du pays considèrent la place de la population pauvre. Il est nécessaire de rétablir une relation entre les acteurs en incluant toutes les catégories de la population dans le processus du développement et en optant surtout pour l’intérêt collectif.
Chambers a conçu également qu’il est nécessaire de découvrir les connaissances et les savoirs des populations. Il utilise l’expression « se mettre à l’école des pauvres ». Cette dimension consiste à écouter les voix des pauvres. On peut récolter les informations et les connaissances des pauvres par les méthodologies de collecte d’informations, par les enquêtes fondées sur la reconnaissance des savoirs des paysans.
Chambers a souligné l’importance de prendre en compte les vertus et les capacités du peuple et agir en les renforçant. Cela se rapporte à la notion d’ « empowerment ».
Ainsi, cette nouvelle approche suppose une nouvelle forme de relation entre «Développeurs» et «Développés». Cela va à l’encontre de théories classiques axées sur la satisfaction de l’intérêt individuel.
La participation de la population comme moyen d’assurer l’efficacité des politiques de développement
La lutte contre la pauvreté et l’atteinte du développement ont été présentes dans les discours de la Banque mondiale. Dans ses rapports sur le développement dans le monde en 1980 et 1990, la Banque Mondiale préconisait une lutte contre la pauvreté axée sur la croissance économique. D’où les politiques et interventions visaient surtout à accroitre les revenus des populations. Pour ce faire l’amélioration de la qualité de main d’œuvre est nécessaire.
Le concept de la participation a été introduit par la Banque Mondiale avec la prise en compte du développement humain. La pauvreté n’était plus seulement considérée du point de vue monétaire mais peut être envisagée comme se rattachant à des problèmes sociaux c’est-à-dire que la pauvreté est de nature multidimensionnelle. Le non prise en compte de cet aspect peut être considérée comme obstacle à l’efficacité des politiques de développement. D’ailleurs, lorsqu’on examine les projets de la Banque mondiale, il existe un certain nombre de problèmes institutionnels communs au niveau des faiblesses organisationnelles de planification, l’inadaptation des structures et procédures administratives aux perspectives et initiatives de la population au niveau local. Pour atteindre les objectifs de développement, alors, la banque mondiale suppose d’agir pour le développement humain en identifiant les « résistances » et en optant pour une transformation profonde du comportement de la population.
Sous cette angle, l’Etat ou l’administration se trouve dans l’incapacité d’identifier et répondre aux réels besoins de tous les groupes de population et aussi d’assurer l’accès de la population aux services sociaux. Pour surmonter ces obstacles, la Banque Mondiale prône la promotion des groupements social, culturel, et religieux pour accomplir le travail de persuasion. L’amélioration de l’efficacité des programmes de développement passe, d’abord, par des changements endogènes de valeurs au sein des populations. La participation de la population au sein de diverses organisations est un moyen pour atteindre cet objectif.
Table des matières
INTRODUCTION
Partie 1 : APPROCHE PARTICIPATIVE ET DEVELOPPEMENT : CONCEPTS ET ANALYSES
DE SA MISE EN ŒUVRE
Chapitre 1 : Notion de l’approche participative dans le cadre du développement
I. Concepts de l’approche participative
1. Définitions
2. Types et degrés de la participation
II. Développement et approche participative
Chapitre 2 : Fondement théorique de la mise en œuvre de l’approche participative
I. Les échecs du développement imposé d’en haut
1. Les théories de modernisation
2. L’approche top down du développement
II. Valorisation de la population et de l’échelon locale
1. Approche buttom up et la valorisation de l’échelon locale
2. Approche populiste du développement
III. Approche participative dans les discours de la Banque Mondiale
1. La participation de la population comme moyen d’assurer l’efficacité des politiques de
développement
2. La participation comme moyen d’assurer l’empowerment des populations pauvres
Chapitre 3 : Analyse empirique de la mise en œuvre de l’approche participative
I. Modèle de participation en pratique dans le cadre de développement à Madagascar
1. Approche participative dans le cadre du DSRP à Madagascar
2. Mise en œuvre de l’approche participative dans les projets de développement
3. Le budget participatif
II. Résultats de la mise en œuvre de l’approche participative dans le processus de développement à Madagascar
1. Résultats de l’approche participative dans le domaine économique
2. Implications de l’approche participative dans le domaine social
3. Impacts de l’approche participative dans le domaine politique et institutionnel
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
Partie 2 : ENJEUX ET LIMITES DE L’APPROCHE PARTICIPATIVE DANS LE CAS DE
MADAGASCAR
Chapitre 4 : Limites de la participation au développement
I. Limites liées aux méthodes et outils participatifs
1. Les difficultés dans les collectes de connaissance
2. La problématique posée par le passage de la connaissance à l’action
II. Limites liées à l’architecture institutionnelle assurant l’approche participative
1. Limites liées aux problématiques de l’action collective
2. Limites liées aux structures de la participation
3. Limites liées à la logique de l’aide au développement
III. Contextes socio-économiques et politique entravant le processus participatif
1. Contextes microéconomiques entravant la participation au développement
2. Environnement macroéconomique entravant la participation au développement
Chapitre 5 : Perspectives et recommandations
I. Actions au niveau local
II. Partenariat avec les agents extérieurs
III. Environnement politique favorable au niveau étatique
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE
CONCLUSION GENERALE