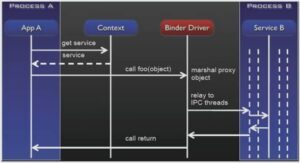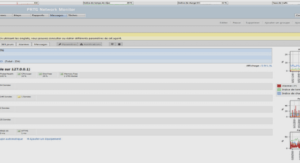L’analyse narrative et thématique des contes d’Amadou Hampâté BÂ
HISTORIQUE DES RELATIONS DE L’ORALITE ET DE L’ECRITURE
Jack Goody, historien de la communication et de l’écriture, développe dans les chapitres 8 et 12 de son ouvrage intitulé Entre l’oralité et l’écriture que « l’oralité est le mode culturel premier et fondamental de toutes les civilisations » 17. Nous sommes presque tentés de dire un mode naturel. Non que la pratique graphique n’ait existé très tôt dans certaines civilisations, mais la présence de l’écriture ne fait pas pour autant disparaître l’oralité comme mode culturel privilégié. Beaucoup de sociétés, qui ont connu la pratique de l’écriture circonscrite à des domaines bien particuliers, n’en ont pas moins continué à fonctionner sur les principes de l’oralité pour tout ce qui concernait leur patrimoine verbal. Et même lorsqu’on a commencé à consigner ce patrimoine sous la forme de manuscrit, ce n’est pas pour autant que le système de la culture oral, tel que nous venons de le définir, n’a pas continué à fonctionner et à régir la représentation anthropologique de la société vis-à-vis de la parole. L’exemple de l’Occident médiéval, souvent mis en avant par les chercheurs s’intéressant à l’oralité, est à cet égard significatif. La culture verbale de ces sociétés a donné lieu à la consignation de nombreux énoncés dans des manuscrits, dont beaucoup ont été conservés. Mais fallait-il connaitre quel était le plus souvent le statut de ces manuscrits dans le domaine des Belles Lettres par exemple. L’histoire nous apprend qu’ils étaient d’abord des outils destinés à une minorité érudite d’artistes lettrés qui étaient quant à eux sensés produire oralement ces discours. Ces supports graphiques pouvaient en quelque sorte leur servir d’aide-mémoire, mais en aucun cas ils n’étaient directement un objet de consommation culturelle, par le moyen de la lecture, pour le public auquel les discours étaient normalement destinés. Dans le cas de genre relativement populaire, une bonne partie de ce public restait d’ailleurs illettrée et n’aurait pas pu lire même. Mais ce n’est pas non plus parce qu’ils disposaient éventuellement de manuscrits qu’il faut imaginer que les interprètes de ces discours, ceux qui récitaient les grandes gestes médiévales par exemple, lisaient leur texte en public. Lors de la véritable performance culturelle devant un auditoire, ces artistes, qui étaient souvent eux-mêmes des musiciens et qui s’accompagnaient d’un instrument, récitaient leur texte de mémoire, selon les principes habituels de l’oralité. Le support graphique, s’ils y avaient recours, ce qui était sans doute loin d’être systématique, n’était donc pour eux qu’un complément de confort au support mnémonique traditionnel représenté par le style formulaire. C’est ce qui leur permettait de « réviser ». Des manuscrits circulaient le plus souvent entre spécialistes. Mais il est très probable que chaque interprète s’était constitué, de ce point de vue, son propre matériel, à partir d’autres performances entendues chez ses confrères. C’est ce qui explique sans doute qu’au Moyen- Âge européen on trouve tant de variantes entre les manuscrits se rapportant à une même œuvre. Lorsqu’ils étaient retranscrits, bien souvent, ils n’étaient pas copiés à partir d’un autre manuscrit mais réécrits à partir de versions mémorisées. C’est donc bien sous le régime de l’oralité que ces textes étaient culturellement consommés par leur public. Ce n’est pas la connaissance de l’écriture, comme moyen de conservation graphique, mais bien plutôt l’usage de l’imprimerie qui a fait de l’objet écrit sous forme de livre un objet de consommation culturelle. C’est cette révolution là, (la révolution Gutenberg) pour paraphraser une célèbre formule de Mac Luhan, qui a provoqué le basculement d’un certain nombre de sociétés d’une culture de l’oralité vers une culture de la scripturalité. Encore cette mutation ne s’est-elle pas faite en un jour. Il a fallu plusieurs siècles pour qu’elle se réalise complètement. Si l’on considère le cas de la littérature française, par exemple, on constate qu’au XVIe siècle, la Renaissance, comme son nom l’indique, n’est pas, en matière de poésie, un mouvement qui entend innover de toutes pièces. Il s’agit plutôt de renouer avec toute 22 une tradition de l’antiquité grecque dont on va chercher à reproduire le modèle. L’écrivain puise dans le répertoire écrit de cette tradition, exactement comme l’interprète de tradition orale puise dans un répertoire mémorisé. Au XVIIe siècle encore, l’idéal classique prône la mimésis comme idéal de création littéraire. Il convient d’imiter les anciens et de se mettre à leur école. Qu’il s’agisse de Corneille, de Racine ou de Molière, la plupart des grandes pièces de l’époque trouvent leur sujet dans une situation littéraire antérieure, parfois même une autre pièce de théâtre sur le canevas de laquelle on va simplement tenter une nouvelle variation. Qu’on songe par exemple au Don juan, l’Amphitryon de Molière. De même, personne ne s’offusque du fait que la plupart des fables de la Fontaine sont reprises de Plaute, de Phèdre ou d’Esope. Cela signifie que, bien qu’on ait changé depuis déjà longtemps le mode de production et de consommation du discours littéraire, la société française de l’époque, aussi bien du côté des écrivains que de leur lectorat, a encore largement gardé un mode de pensée et des réflexes hérités des habitudes de la culture orale. D’ailleurs, à la fin du siècle, la querelle des anciens et des modernes peut être interprétée comme une péripétie significative de cette évolution de l’esprit propre à l’oralité, qui n’est plus adaptée aux réalités de la communication en matière d’art verbale, vers l’esprit nouveau qui commence à se faire jour avec la généralisation de la culture imprimée.
L’ORALITE : UN PRODUIT VIVANT
S’il y a eu cette mise au point, c’est que les sociétés de culture écrite regardent souvent l’oralité avec condescendance. Pour ces sociétés, l’oralité est marquée par l’idée de manque : manque d’écriture, manque d’auteur, manque de raffinement. Elles mettent le plus souvent l’accent sur ce qu’elle n’a pas par rapport aux propriétés de la production écrite. Elle est généralement pensée comme une expression de la culture populaire peu élaborée par opposition à la scripturalité supposée aboutir à des discours plus raffinés et 24 plus savants. Le terme même de « folklore » dont on se sert couramment depuis le milieu du XIXe siècle pour parler des productions de l’oralité est, du fait même de son étymologie, (« folk » du germanique volk « peuple ») assez significatif. L’oralité pourrait donc apparaître comme une sorte d’expression culturelle par défaut réservé à des communautés trop frustes pour se hisser d’elles-mêmes au niveau de la technique graphique. L’histoire mal comprise peut tendre à favoriser un tel point de vue. Elle montre en effet, nous venons de le voir que la culture écrite, là où elle s’est imposée comme modèle dominant, a toujours succéder à la culture orale. De là à céder à la tentation selon une interprétation « évolutionniste » un peu naïve, de considérer la scripturalité comme une forme culturelle « évoluée » par opposition à l’oralité qui représenterait quant à elle une forme « primitive » sous prétexte qu’elle est première, le pas à franchir n’est pas bien grand. Cette idée que la production orale, fruit d’une infériorité culturelle, est moins « évoluée » a bien entendu des incidences sur la façon dont est considérée la discipline qui étudie ce domaine. A propos des énoncés de culture orale, la critique parle souvent d’ « ethnotextes ». Ce n’est pas que le terme soit en lui-même à récuser. Mais si l’on admet que les langues et les productions verbales auxquelles elles donnent lieu sont indissociables de la culture qui les porte. Tout texte ne devrait-il pas être considéré comme un ethnotexte ? Réserver ce terme au domaine de l’oralité, c’est d’une certaine façon impliquer qu’il s’agit alors d’un type d’énoncé dont l’ethnologue seul doit s’occuper, comme s’il n’avait pas de propriété suffisamment élaborée pour concerner le chercheur en étude littéraire par exemple qui s’intéresse plus spécifiquement à l’art verbal. On aperçoit bien les conséquences désastreuses d’un tel apriori, lorsqu’il s’agit d’examiner la question à propos de pays qui ont été en leur temps qualifiés de sousdéveloppés ou plus tard d’émergents, comme c’est précisément le cas de l’Afrique. Selon une telle optique jusqu’à la colonisation généralisée du continent qui lui aurait « apporté » l’écriture, l’Afrique en serait « restée » au stade de l’oralité parce qu’elle aurait été en retard sur l’échelle de l’évolution, par rapport à d’autres civilisations et en particulier par rapport à l’Occident. Suivant cette logique, la part qu’elle accorderait aujourd’hui à l’écriture dans sa culture, où le régime d’oralité garde une place beaucoup plus importante que dans les sociétés occidentales, la placerait en un point de l’échelle de l’évolution plus ou moins équivalent à celui de l’Occident médiéval que nous avons évoqué plus haut, en attendant qu’elle ne bascule inévitablement à son tour dans le 25 régime dominant de la culture écrite, étape supposée consacrer un nouveau progrès dans son évolution. Nous n’avons aucunement l’intention de prédire dogmatiquement ce que sera l’avenir de l’Afrique noire en matière de culture verbale ou certes rien n’est joué. Nous voudrions toutefois montrer le fondement pernicieux de cette lecture « évolutionniste ». Au plan théorique, il tient au caractère très ethnocentré du point de vue qui suppose un modèle unique d’évolution pour l’humanité entière dont l’Occident est bien entendu censé représenter le stade le plus avancé. A un plan plus pratique, l’histoire du continent africain montre fort bien que si au cours des siècles il a eu encore moins que d’autres civilisations (l’Antiquité ou le Moyen-âge européens par exemple), recours à la technique graphique pour gérer sa pratique verbale, ce pas par incapacité à l’inventer. C’est plutôt parce qu’il n’en voyait pas l’utilité peut-être justement parce que son système de culture orale était plus élaboré que celui d’autres sociétés. L’Afrique noire, en plusieurs de ses régions, a en effet depuis fort longtemps des contacts avec des techniques d’écriture et, quand certaines sociétés en ont éprouvé le besoin, elles en ont invité plusieurs, les exemples sont bien connus. Ainsi en Ethiopie, le guèze s’écrit depuis les premiers siècles de l’ère chrétienne. Plus tard, à l’époque médiévale, les conquérants de l’islam apportèrent avec eux la graphie arabe. Plusieurs sociétés noires islamisées ont d’ailleurs utilisé cette technique graphique pour transcrire leur propre langue : peul, haoussa, minianka, soninké, khassonké, etc. C’est ce qu’on appelle l’ajami. On peut encore citer tous les systèmes graphiques inventés ou attribué à une révélation onirique ou divine (obéri, okaimé, vaï, nko) mais dont curieusement, pour certains, un bon nombre de signes sont identiques à ceux d’écriture très anciennement attestés (documents épigraphique du Moyen-Orient et de Crète18 ). A ces exemples, ajoutons celui de l’invention par Njoya de l’écriture Bamun pour l’usage de l’administration du Palais. Pourrait-être signalée aussi l’existence de signe idéographique dans certaines sociétés secrètes comme le Komo des Bambara, et surtout de code de communication gratuite à côté de système d’écriture, le tifinagh par exemple. Mais ce qui est significatif en l’occurrence, c’est que ces empreintes ou ces inventions sont toujours restés cantonnées à des usages sociaux très limités et qu’ils n’ont été que très rarement et très marginalement utilisés pour noter ce qui relevait normalement de la tradition orale. Pour ce qui est de l’ajami, par exemple, la plupart des manuscrits dont on dispose montrent que les textes transcrits sont des textes religieux (donc liés à la culture qui a importé l’écriture) et, dans quelques cas plus rares, des éléments d’histoire (essentiellement dates, repères événementiels) qui en font des sortes de mémentos. De toute façon, même là où on se réfère à un texte écrit, le plus souvent on le glose oralement ou on l’énonce publiquement. Pourquoi, du Moyen-âge au XXe siècle, l’acquisition par des lettrés de cette compétence graphique n’a-t-elle lieu à une transcription généralisée des œuvres du patrimoine de tradition orale dans ces sociétés ? La réponse semble s’imposer d’elle-même. On peut penser que les membres de ces communautés avaient un rapport beaucoup trop immédiat à la parole, rapport incarné pourrait-on dire, pour se sentir vraiment intéressé et concerné par ce type de solution. En formulant une telle hypothèse, il ne s’agit pas d’asséner, au nom d’une théorie sociologique, une solution dogmatique à ce qui peut rester à certains égards énigmatique ; toujours est-il qu’aujourd’hui encore, il est loisible de constater que dans les sociétés rurales, on préfère souvent accorder du crédit à la parole de celui qui fait autorité plutôt qu’à ce qui est écrit sur un manuscrit. C’est que l’oralité permet ce que la culture écrite ne permet plus : une inscription directe de l’acte de parole dans le tissu relationnel du groupe et dans la dynamique de l’univers culturel et social. C’est ce qui confère au patrimoine verbal des civilisations de l’oralité sa dimension unitaire et communautaire. L’histoire nous a toujours montré que les traits et les techniques culturels se répandaient par contacts successifs entre peuples voisins. A partir du moment où l’écriture a été connue à certaines époques, en différentes parties du continent africain noir, il y a tout lieu de penser qu’elle se serait étendue de proche en proche si son utilité culturelle avait été ressentie. Cela n’a pas été le cas et on peut voir là la preuve que le maintient quasiment intégral de l’oralité dans les sociétés négro-africaines jusqu’à l’aube du XXe siècle est le fait d’un choix, lié à un type de représentation de la parole, plutôt que d’une incapacité. La parole recèle une importance particulière et des interdits dans les sociétés africaines, c’est que nous rappelle ici Ursula Baumgardt dans ces termes : « La parole a le pouvoir de changer le cours des évènements, elle est entourés de respect – les conversations sont ainsi souvent ponctuées de « prête l’oreille ! Ecoute ! ». Parler, s’exprimer, c’est prendre un risque, celui de se révéler, de se compromettre et de perdre de sa puissance. Publique ou privée, la parole est donc codifiée, limitée par des interdits : on ne dit pas n’importe quoi à n’importe qui, et pour avoir tout son impact, tout son poids, pour bien piller, tailler et découper, cette parole doit respecter les règles établies ».
INTRODUCTION GENERALE |