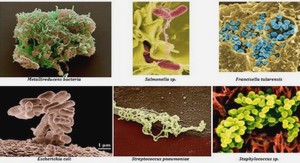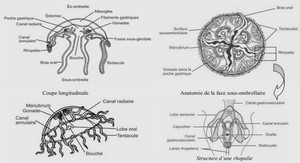L’ALLÉGORIE DE LA MALADIE DANS TERRE
D’ASILE
L’hémophilie : une analogie à une fin d’innocence
L’hémophilie suscite immédiatement une idée d’hémorragie, par conséquent de sang. Cette maladie est caractérisée par un écoulement abondant de sang, l’incapacité à coaguler en cas de blessure. Nous préférons, pour l’heure, cette précision. Nous ne proposons pas, dans cette présente analyse, une étude médicale de cette pathologie. Notre objectif est de tenter de mettre en relief des images auxquelles renvoie cette affection hémorragique. C’est le sang, à proprement parler, que des romanciers, poètes et dramaturges, en un mot des écrivains tels que Pierre Corneille dans Le Cid (1637) ; Arthur Rimbaud, « le Dormeur du val » (1870) ; Louis Bertrand, Les martyrs africains (1934) ; Paul Éluard, Capital de la douleur (1929) ; Drieu La Rochelle, L’homme à cheval (1934) ; Charles Baudelaire, « La fontaine de sang », pour ne citer que ceux là – ont évoqué chacun, en sa perception propre, qui nous motive. En outre, l’idée que l’entendement se fait souvent du sang renvoie de prime à bord à une acception de procréation, donc à la vie. Parallèlement à cette conception, celle de la mort par assassinat s’impose, aussi, naturellement. Et, puisqu’il s’agit du sang émanant de l’hémophilie, la connotation s’éclaircit et nous permet de signaler que dans L’Âge de fer et Terre d’asile, l’image de ce liquide rouge est analogue à la violence d’où découle la mort. Il nous faut noter que, dans les romans de John Maxwell Coetzee et Pierre Mertens, la présence du sang émane de l’action démesurée, notamment de la torture, de la répression, des assassinats… C’est ainsi qu’avant d’utiliser des images qu’offrent du sang découlant de ces différentes formes de violence, ces écrivains se sont attelés à montrer sa valeur. Le sang est, pour eux, signe de vie. Alors, tout être vivant, homme et bête, lui doit sa survie. C’est en cela que le sang relève d’ailleurs du mystère. Étant l’image de la vie, à chaque fois que le sang coule, cela ne peut que traduire la réalité d’une vie en perdition. C’est ce qui explique effectivement la peur que certains personnages, dans L’Âge de fer et dans Terre d’asile, éprouvent dès qu’ils ont sous le regard du sang en écoulement. Dans L’Âge de fer, si Florence, la mère de Bheki et Élizabeth Curren, se trouvent dans une situation de trouble, de confusion et d’inquiétude, c’est parce que le sang qui coule des blessures de Bheki et celles de John fait pressentir chez elle le danger, voire une pensée funeste. Cette assertion de la narratrice, à ce propos, en dit long : Parce que le sang est un : un océan de vie dispersé parmi nous en plusieurs existences distinctes, mais qui vont naturellement ensemble ; prêté et non donné, gardé en commun, comme un dépôt de confiance devant être préservé (AF, 72). Le sang se révèle, en effet, être un patrimoine, selon l’auteur sud-africain, d’une valeur universelle et dont la protection est un devoir que l’humanité toute entière doit non seulement à la postérité, mais surtout à la divinité. Outre cette vision, le sang demeure quelque chose que nous empruntons à Dieu et à nos parents que nous devons respecter et honorer. Le sang étant inhérent à l’homme, vouloir le préserver, c’est aussi penser du bien de l’humanité. Cette remarque s’applique à Jaime morales dans Terre d’asile. Il se trouve dans une grande inquiétude face à l’éventualité de perdre sa vie à cause de l’hémorragie abondante et continue de sa blessure. Mais, il faut dire que le personnage principal de Pierre Mertens a moins peur de se vider de son sang et d’en mourir que d’être arrêté et reconduit en milieu carcéral par la police de l’aéroport de Santiago. L’effusion de sang, au fait, à l’aéroport devient un indice qui pourrait dévoiler la fausse identité qui devait lui ouvrir la voie, en fuite, pour la Belgique, métropole choisie pour son exil. C’est pourquoi, il redoute d’avantage les « les tueurs anonymes qui guettaient dans l’ombre » (TA, 24). Si le héros saigne abondamment durant le voyage, c’est aussi qu’une partie de lui-même, de son âme, reste au Chili malgré son exil. Le sang est alors le symbole d’une trace inoubliable, d’un lien qui ne sera pas coupé, même avec 45 l’éloignement. Un peu de lui-même, de sa part la plus précieuse, reste sur la terre de son combat. Jaime Morales semble comprendre que, ainsi que le déclare une héroïne de Pierre Drieu La Rochelle, « quand on a commencé dans le sang, on continue dans le sang »85 . De ces mots du personnage de Drieu La Rochelle, nous percevons une certaine cohérence parfaite dans la mesure où, en ce qui concerne L’Âge de fer et Terre d’asile, les régimes chilien et sud-africain, trouvent leur genèse dans le sang et évoluent encore dans ce contexte. Dans ce cas, le sang qui coule est en passe de devenir une règle incontournable pour régner. Nous comprenons, également, la motivation, dans le roman de Pierre Mertens, de certains personnages pour quitter le pays. L’angoisse de voir perpétuellement des événements durant lesquels du sang est versé ne pourrait pas les laisser demeurer dans ce pays « hémophile ». La vue de ce sang est traumatisante comme il est question de celui que Charles Baudelaire chante dans un des poèmes, intitulé « La fontaine de sang » dans son recueil Les fleurs du mal : Il me semble parfois que mon sang coule à flot, Ainsi qu’une fontaine aux rythmiques sanglots. Je l’entends bien qui coule avec un long murmure Mais je me tâte en vain pour trouver la blessure […] J’ai demandé souvent à des vins capiteux D’endormir pour un jour la terreur qui me mine86 . Les « flots » et « sanglots » baudelairiens dessinent une image d’une gravité captivante et viennent ainsi corroborer l’extravagance et l’horreur représentées par l’action sanguinaire que le narrateur offre dans L’Âge de fer. L’action, puisqu’il s’agit d’elle, qualifie, dans ce roman, le degré de barbarie de certains personnages. Il nous faut rappeler que s’il existe des personnages qui n’aiment pas voir le sang ou qui en ont peur, d’autres en revanche y trouvent leur compte et s’en repaissent. Aucune valeur n’est donnée à ce liquide rouge. En d’autres termes, on croirait que ces derniers font verser le sang des opposants pour s’affirmer. Dans des régimes, tel sud-africain du temps de la ségrégation raciale, les confrontations sont toujours sanglantes, car se battre constitue une forme de protection ou de survie, et de ce fait, il faut impérativement dominer et tuer son ennemi pour s’assurer la sécurité. L’écrivain sud-africain immortalise cette situation grâce à une image d’un homme en pleine activité d’abattage d’animaux d’où s’échappe du sang en quantité abusive : La petite perce-neige perdue dans les cavernes de sang, et sa mère elle aussi perdue. Un pays prodigue de sang. Le mari de Florence en ciré jaune et en bottes, pataugeant dans le sang. Des bœufs s’abattant, la gorge tranchée, projetant en l’air leur dernier jet comme des baleines. La terre sèche absorbant le sang de ses créatures. Une terre qui boit des rivières de sang et n’est jamais abreuvée (AF, 71). L’assimilation de ces tueries animales, d’où coule à flot du sang, au contexte d’apartheid souligne la cruauté des hommes dudit système. Ce système offre une image d’abattage de bêtes. Le volume extrême de sang dans lequel patauge ce « boucher » configure la multitude d’hommes torturés et assassinés lors des manifestations violentes. Ces hommes ne semblent pas avoir été tués et traités avec dignité. Comme à la manière dont on tue les animaux, ils sont exécutés en masse et gisent dans leur propre sang reflétant ainsi l’image d’un carnage. Aussi cette séquence n’occulte-t-elle pas les émeutes meurtrières des années 1960 à Sharpeville, en Afrique du Sud. Amnesty international souligne : À Sharpeville, la police ouvrit le feu, sans qu’il ait eu une provocation, sur la foule d’africains désarmés qui manifestaient contre les laissez-passer, faisant 69 morts. Des manifestations de protestation eurent lieu dans tout le pays, mais le gouvernement ne fait que durcir ses positions87 .
LA MALADIE, SYMBOLISME D’EXCÈS ET DU MANQUE
À force de sombrer dans un état de souffrance et de peine, notamment dans une situation d’envahissement parallèle à l’écoulement sanguin, le corps social, dans Terre d’asile et dans L’Âge de fer suscite, a fortiori, l’idée d’excès et de manque. De prime abord, les deux extrémités marquent une opposition puisqu’elles sont contraires et antonymiques. Car, l’excès, c’est tout à fait ce qui dépasse la norme ou le normal et par conséquent il doit être situé dans la démesure, l’hybris, l’outrance, le dérèglement. Autrement dit, l’excès qualifie quelque chose ou un acte, mieux encore une présence outrepassant la limite, c’est-à-dire ce qui est inattendu. C’est à ce titre que ce terme doit être lu, comme le trop ; d’où l’idée de perte d’équilibre qui paraît indiquer, d’une autre manière, ce que Georges Canguilhem dénomme « le pathologique »117 . Il ajoute cette précision : La maladie n’est pas seulement déséquilibre ou dysharmonie, elle est aussi, peut-être surtout, effort de la nature de l’homme pour obtenir un nouvel équilibre. La maladie est réaction généralisée à intention de guérison. L’organisme fait une maladie pour se guérir118 . La maladie peut être perçue comme un excès dont le corps n’arrive pas à supporter le poids. D’ailleurs, les substantifs « déséquilibre » et « dysharmonie » nous offrent une compréhension parfaite, étant donné que le corps, formant une unité, n’arrive plus à résister aux coups et au mal dont il souffre. Cela est d’autant plus vrai que l’état dans lequel il se trouve signale, aussi, un manque car, les deux états relèvent tous de la souffrance et de la violence. Mais avant tout, arrêtons-nous sur l’expression : le manque. Le manque rappelle une disposition de désir et de besoin parce que le corps (humain ou social) concerné éprouve un déficit du nécessaire qui devrait asseoir son équilibre. Ce qui nous fait penser à une atmosphère de carence, de vertige et d’absence. Ainsi, l’idée de vacuité n’est pas à négliger dans ce contexte, en ce sens que l’absent laisse naturellement un vide. Ce fait est remarquable dans la poésie senghorienne, surtout dans son recueil Éthiopiques119. En effet, le manque de ce poète de la Négritude s’exprime sous forme d’une absence protéiforme, mais ce qui importe, pour nous dans ce cas précis, c’est l’aspect défectueux de la vie de ses frères africains qu’il espère rétablir : la libération de l’Afrique de l’oppression coloniale. Léopold Sédar Senghor, Éthiopiques (1956), in Œuvre poétique, Paris, Seuil, 1990. 64 Finalement, ce qui ferait du manque un synonyme de l’excès demeure l’absence de l’équilibre que nous soupçonnons chez les personnages malades que les romans de John Maxwell Coetzee et Pierre Mertens présentent. Le regard qu’a le lecteur que nous sommes, devient clinique à cause de l’obligation à laquelle il est appelé : celle de diagnostiquer le corps malade. Ce corps souffre puisqu’il est en panne de santé laquelle constitue son état d’équilibre naturel. Il souffre également, dans la mesure où il est sous le joug de la maladie qui représente son état excédent. Bien qu’ils semblent opposés, l’excès et le manque, dans le contexte médical que nous traitons, renvoient au déséquilibre du corps saisi de pathologie que nous aurons à analyser quant à l’enfance qui, dans une société sombrant de plus en plus dans la violence, aboutit à une perte prématurée de son innocence. Ce qui laisse lire une dégénérescence sociale, elle-même conduisant à la symbolique de « la thanatophanie ».
La maladie comme un avortement de l’innocence enfantine
Les enfants, dans Terre d’asile et L’Âge de fer, sont loin des enfants normaux. Habituellement, l’enfance suggère une époque d’émerveillement tel que nous le constatons chez Candide120, personnage principal et éponyme de l’œuvre de Voltaire. Avant d’être chassé du château par le Baron, il était innocent car il ignorait le mal. C’est dire que cette période de la vie est très importante et détermine plus ou moins ce que devient l’être adulte. Rappelons que cette question infantile a été une préoccupation des philosophes tels que Jean-Jacques Rousseau, Lucien Malson121, des littéraires notamment Émile Zola122, au dix-neuvième siècle, Rudyard Kipling123, Antoine de 120 Voltaire, en développant, par le biais de Pangloss l’idéologie du meilleur des mondes possibles, maintient au départ le personnage de Candide dans une perception pratiquement aveuglante et utopique de la vie jusqu’ à ce qu’il découvre de lui-même la réalité patente de celle-ci. Autrement dit, ce sont les épreuves qui transforment et dénaturent l’enfant et par conséquent l’homme. Sinon, il est d’essence innocente. Le roman initiatique des aventures de Mowgli dans Le Livre de la jungle, Paris, Éditions du groupe « Ebooks », 1894. 65 Saint-Exupéry124, William Golding qui abordent courageusement le thème de la violence enfantine125, des psychanalystes et des hommes des sciences sociales, précisément Sigmund Freud126 et Michel Foucault127. Ces écrivains s’accordent sur un fait : l’universalité de l’innocence de l’enfance, même s’il y a lieu de préciser avec Tshikala K. Biaya qu’elle varie d’une culture à l’autre, elle se construit en se rattachant à une culture, à la classe, au genre et à d’autres variables. Mieux, cette affirmation ne veut point rejeter l’universalité de l’enfance, à la condition qu’elle soit comprise dans une formulation et formalisation « émique », qui permettrait de transcender les approches anthropologiques consistant à lire l’Autre à partir de la propre culture du chercheur et ses normes 128 . Selon cette remarque, le statut et le devenir de l’enfant dépendent strictement de la société dans laquelle il évolue. À ce titre, la responsabilité de son entourage est de facto engagée, à cause de « la réprobation des aînés qui pensent et disent tous qu’il faut partir pour défendre le bonheur de la tribu »129 ou de la race. Dans L’Âge de fer, justement, l’épanouissement des enfants est brutalement interrompu à cause de la situation conflictuelle entre les Blancs et les Noirs d’Afrique du Sud. Le texte offre une image de l’enfance très diversifiée. Ce qu’il faut signaler dès l’entame de cette analyse, c’est que les petits ont très tôt, ou prématurément, quitté l’âge puérile de telle sorte qu’ils sont généralement confondus avec des hommes matures. Il n’est pas alors fréquent de les voir évoluer ou se comporter conformément à leur âge. Ils parlent Les travaux de Freud sur la psychanalyse réservent une bonne partie à l’enfance. Le psychanalyste nous apprend que la sexualité est aussi vieille que l’enfant. Il ne nie pas que l’homme naît avec le désir sexuel mais le père de la psychanalyse se voit dans l’obligation de préciser que « la différence des sexes ne joue pas le rôle décisif dans cette période infantile. Sans crainte, [persiste-t-il], d’être injuste, on peut attribuer à chaque enfant une légère disposition à l’homosexualité. », Cinq leçons sur la psychanalyse suivi de Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique, op. cit., p. 52. Appliquée à notre travail, cette idée justifie que l’enfant est un être changeant et qui peut se dénaturer selon des situations. 127 Michel Foucault aborde la question de l’emprisonnement des délinquants en signalant que la prison n’est pas toujours une des meilleures formules correctives, car un « chef de famille en prison réduit chaque jour la mère au dénuement, les enfants à l’abandon… », Surveiller et punir. Naissance de la prison, op. cit., p. 312. Donc, un enfant abandonné, par exemple, court le risque de se retrouver à son tour dans la même situation que celle de son père à cause du manque de surveillance et d’éducation. 128 Enfants de conflit armé et de violence armée, Dakar, CODESRIA, 2001, p. 05. 129A. Falilou Ndiaye, « Romans africains et figures d’enfants soldats », in Revue de langues et de littérature, n°s 4-5, 2013, pp. 122-123. 66 comme des adultes et posent des actes qui justifient qu’ils sont sortis du contexte d’accomplissement et d’éducation. La narratrice de L’Âge de fer constate : Des enfants qui méprisent l’enfance, le temps de l’émerveillement, la saison où l’âme croit. Leur âme, organe de l’émerveillement rabougrie, pétrifiée. Et de l’autre côté de la grande démarcation, leurs cousins blancs, l’âme également rabougrie, s’entortillent de plus en plus dans le cocon de somnolence (AF, 11). Ce déclin moral de l’enfance sud-africaine pendant la période de l’apartheid relève, s’il faut écouter attentivement la narratrice de L’Âge de fer, de la responsabilité parentale. Car, les parents, qu’ils soient Blancs ou Noirs, se sont évertués, de toute leur force et âme, à faire de cette progéniture des enfants soldats130 tel celui qu’on peut retrouver dans le roman d’Ahmadou Kourouma. Dans le même registre, dans Terre d’asile, à force de vivre sous la contrainte de la dictature sous l’ère Pinochet, les enfants finissent par opter pour l’endurcissement. En sus des moments ludiques durant lesquels ils se fabriquent, pour eux-mêmes, des armes de jeu, on lit une volonté qui est la leur de devenir des combattants. Ils ont, en fait, appris de la situation tortionnaire qui prévaut dans le pays à devenir volontiers bourreaux. Jaime Morales, qui a connu le même contexte dans le passé avant de devenir le principal acteur de la révolution, se plaint : « On n’est pas sorti de l’adolescence que, déjà, les jeux sont faits : on porte sur soi le parfum fétide de ses peurs inavouées, de ses colères rentrées, de rage impuissante » (TA, 78). À la différence des enfants de L’Âge de fer de John Maxwell Coetzee, les enfants de Terre d’asile de Pierre Mertens tel que la trame narrative nous le laisse comprendre, n’ont pas reçu de leurs parents une idéologie de fer. Par volonté de conjurer l’injustice du bourreau dont leurs parents ont été victimes, les adolescents chiliens copient de préférence le style de ce dernier. D’ailleurs, Marina Bethlenfalvay, analysant l’image de l’enfance dans le roman français du XIXe siècle, remarque : Dans ces enfants endurcis, on reconnaît les anciennes victimes, devenues bourreaux. À force de souffrir, l’enfant qui était bon est devenu mauvais. 130 Dans Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, 2000, Ahmadou Kourouma, dans un registre linguistique familier, fait découvrir avec regret le détournement des enfants, lesquels auraient dû recevoir une bonne éducation afin de devenir de bons citoyens pour leurs pays, à des fins inutiles et cruelles. Ce sont les enfants-soldats des bandes pillardes. 67 Vu ainsi, l’enfant torturé devient une image complète de la condition humaine : c’est parce qu’il souffre qu’il sera cruel à son tour131 . Nos écrivains peignent, à travers la figure infantile, l’excès et le manque que les parents, faute d’assurer leur devoir d’éduquer – rappelons qu’éduquer, c’est, étymologiquement, prendre soin d’un petit et le conduire des ténèbres à la lumière – infligent à la couche la plus chétive de la société. Dans ce contexte de guerre, d’abandon des parents et de récupération par les belligérants, le manque que vit l’enfant est relatif à l’absence de la culture d’amour qui aurait dû être le tout premier exercice des parents et des éducateurs. Et, à la place de l’éducation, ces responsables inculquent la haine ; une culture révolutionnaire et de vengeance : On pourrait penser que c’est alors le rôle éducatif, au sens large du terme, ou parce qu’il parvient à s’identifier à la victime, ou pour d’autres raisons encore […] Le « rôle éducatif » parental implique toute une série de processus qui accompagnent l’intégration des notions cruelles au sein du développement psychique132 . Les points de vue de Marina Bethlenfalvay et Maurice Berger se rejoignent et semblent corroborer celui de John Maxwell Coetzee dans la mesure où, quand on considère sous l’angle psychologique le corps juvénile dans L’Âge de fer, on discerne rapidement que les enfants, qu’ils soient de race noire ou de race blanche, ont été fabriqués, mis au monde par la situation ségrégationniste. Ce sont des enfants de situation. Prenons, par exemple, ceux de la communauté noire : ils sont dressés et laissés par leurs parents, pour que, à chaque fois qu’un besoin de contestation se présente, ils puissent riposter contre toute attaque émanant de la communauté blanche. Telle est l’idéologie reçue des parents pour honorer la race noire et forger les défenses des rejetons noirs. Cette figure de l’enfance noire sud-africaine vient justifier l’ancienneté de ce thème, comme le précise bien Tshikala K. Biaya : Aussi loin que remontent les études sur les enfants en situation de guerre, la figure de l’enfant-soldat domine la littérature par sa prégnance, mais elle n’est pas d’apparition récente. Depuis l’antiquité, Sparte nous en livre la première version. L’armée de Napoléon Bonaparte comportait un régiment des enfants de 12 ans, la marine de sa 131 Marina Bethlenfalvay, Le visage de l’enfant dans la littérature française du XIXe siècle, Paris, Droz, 1979, p. 58. 132 Maurice Berger, « Notes cliniques sur la cruauté pathologique de l’enfant », in Cahiers de psychologie, 2004, n° 22, p. 03. 68 majesté britannique recrutait des enfants de 15 ans qui ont participé à la bataille de Trafalgar sous la direction de l’amiral H. Nelson, etc133 . Si les hommes impliquent des enfants dans de telles dispositions, c’est parce que l’enfant imite facilement et sait s’imprégner vite des idéologies, contrairement à l’adulte qui, pour épouser une doctrine, passe d’abord par une analyse, avant de se décider. C’est pourquoi, la narratrice de L’Âge de fer n’hésite pas à chapitrer Florence, figure parentale de cette communauté noire, qui se conforme à l’endoctrinement des enfants à la ségrégation raciale : Ces incendies, ces meurtres dont on entend parler, cette indifférence scandaleuse, même ces coups donnés à M. Vercueil – de qui est-ce la faute au bout du compte ? Le blâme doit certainement retomber sur les parents : « Vas-y, fais ce que tu veux, tu es ton propre maître maintenant, je renonce à mon autorité sur toi ». Quel enfant, au fond de son cœur, désire réellement qu’on lui dise cela ? Il va certainement repartir tout égaré en se disant : je n’ai plus de mère maintenant, je n’ai plus de père dans ce cas, que ma mère soit la mort, que mon père soit la mort. Vous vous en lavez les mains et ils deviennent les enfants de la mort (AF, 55-56). L’endoctrinement et la fausse liberté juvénile, orchestrés par la communauté noire, sont perçus par la narratrice comme une entreprise de mort, parce que ces enfants, à qui l’on inculque d’être prématurément des adultes, ou mieux, de devenir leur « propre maître », ignorent véridiquement ce qui est attendu de cette guerre. Il est à noter d’ailleurs que certaines factions d’une même communauté entrent, par moments, en conflit. Pour son compte, Pierre Mertens opte pour une démarche inverse à celle de John Maxwell Coetzee qui, lui, examine directement cette question de l’enfance sur place, en l’occurrence en l’Afrique du Sud. L’écrivain belge prête ses yeux à son personnage principal se trouvant en exil en Belgique pour qu’il procède à une comparaison entre les enfants chiliens et belges. Sans parler nommément de la progéniture de ce pays sudaméricain, Jaime Morales exprime justement son étonnement devant une jeunesse belge épanouie et heureuse. Subséquemment, le camarade Morales conclut que seule la « paix civile » devrait laisser libre et fraîche cette jeunesse belge : Quel âge peuvent-ils avoir ? Entre dix-huit et vingt cinq ans. Entre dix-huit ans et vingt cinq ans de paix civile. C’est pour cela sans doute qu’ils ont une bonne mine, 133 Tshikala K. Biaya, Enfant de conflit armé et de violence armée, op. cit., p. 02. 69 qu’ils ont le teint si frais ils sont comme des porcelets fondant au milieu de la paille, l’Histoire ne leur a pas encore plombé les joues (TA, 34). Derrière l’émerveillement dont Jaime Morales fait montre pour les jeunes belges, nous osons scruter de son for intérieur la manifestation et le regret quant au malheur dont les enfants chiliens sont victimes, durant les sombres années de torture. Nous apprenons cela grâce à la dernière phrase – « … l’histoire ne leur a pas encore plombé les joues » de la citation. Elle rend compte surtout, au-delà de l’innocence de l’enfance belge grâce au rôle éducatif optimal du corps parental belge et d’une société en paix, des « idylles brisées »134 de l’enfance du pays du Général Augusto Pinochet. Aussi, l’emploi à la forme négative, de l’expression « plombé » qui appartient au secteur de la violence, vient-il confirmer comment la couche sociale chilienne la plus fragile a subi la pire des histoires, différemment de celle de la Belgique. Là où les deux tableaux, celui de l’enfance chilienne et celui des adolescents sud-africains, se recoupent, c’est évidemment dans la réception du sort que leur impose cette situation de violence. Même si les enfants dans Terre d’asile n’ont pas été accoutumés par leurs parents à la cruauté comme c’est le cas chez ceux de L’Âge de fer, il va s’en dire qu’ils ont tous, les uns et les autres, connu le même drame. C’est ce qui confirme du reste l’idée de cancer dans ces deux romans ; il s’est avéré que la masse infantile y est peinte à l’image des cellules d’un corps lesquelles ont subi une « prolifération anarchique indéfinie »135 .
INTRODUCTION |