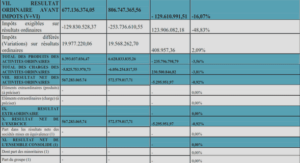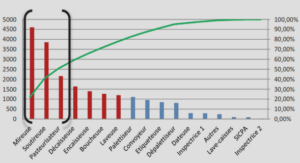L’Alchimiste
Les secrets du Grand Œuvre
Comme ils étaient en chemin, ils entrèrent en un certain bourg. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
Cette femme avait une sœur, nommée Marie, qui s’assit aux pieds du Seigneur et qui écouta ses enseignements.
Marthe allait de tous côtés, occupée à divers travaux. Alors elle s’approcha de Jésus et dit :
– Seigneur! Ne considères-tu point que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu’elle vienne m’aider.
Et le Seigneur lui répondit :
– Marthe! Marthe! Tu te mets en peine et tu t’embarrasses de plusieurs choses. Marie, quant à elle, a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée.
L’Alchimiste prit en main un livre qu’avait apporté quelqu’un de la caravane. Le volume n’avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l’auteur : Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba sur une histoire qui parlait de Narcisse.
L’Alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l’eau d’un lac. Il était si fasciné par son image qu’un jour il tomba dans le lac et s’y noya. A l’endroit où il était tombé, naquit une fleur qui fut appelée narcisse.
Mais ce n’était pas de cette manière qu’Oscar Wilde terminait l’histoire.
Il disait qu’à la mort de Narcisse les Oréades, divinités des bois, étaient venues au bord de ce lac d’eau douce et l’avaient trouvé transformé en urne de larmes amères.
« Pourquoi pleures-tu? demandèrent les Oréades.
– Je pleure pour Narcisse, répondit le lac.
– Voilà qui ne nous étonne guère, dirent-elles alors. Nous avions beau être toutes constamment à sa poursuite dans les bois, tu étais le seul à pouvoir contempler de près sa beauté.
– Narcisse était donc beau? demanda le lac.
– Qui, mieux que toi, pouvait le savoir? répliquèrent les Oréades, surprises. C’était bien sur tes rives, tout de même, qu’il se penchait chaque jour! »
Le lac resta un moment sans rien dire. Puis :
« Je pleure pour Narcisse, mais je ne m’étais jamais aperçu que Narcisse était beau.
Je pleure pour Narcisse parce que, chaque fois qu’il se penchait sur mes rives, je pouvais voir, au fond de ses yeux, le reflet de ma propre beauté. »
« Voilà une bien belle histoire », dit l’Alchimiste.
Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu’il arriva, avec son troupeau, devant une vieille église abandonnée. Le toit s’était écroulé depuis bien longtemps, et un énorme sycomore avait grandi à remplacement où se trouvait autrefois la sacristie.
Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brebis par la porte en ruine et disposa quelques planches de façon à les empêcher de s’échapper au cours de la nuit. Il n’y avait pas de loups dans la région mais, une fois, une bête s’était enfuie, et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée.
Il étendit sa cape sur le sol et s’allongea, en se servant comme oreiller du livre qu’il venait de terminer. Avant de s’endormir, il pensa qu’il devrait maintenant lire des ouvrages plus volumineux : il mettrait ainsi plus de temps à les finir, et ce seraient des oreillers plus confortables pour la nuit.
Il faisait encore sombre quand il s’éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré.
« J’aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps », pensa-t-il. Il avait fait le même rêve que la semaine précédente et, de nouveau, s’était réveillé avant la fin.
Il se leva et but une gorgée de vin. Puis il se saisit de sa houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil sitôt que lui-même reprenait conscience. Comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à celle de ces moutons qui, depuis deux ans, parcouraient le pays avec lui, en quête de nourriture et d’eau. « Ils se sont si bien habitués à moi qu’ils connaissent mes horaires », se dit-il à voix basse. Puis, après un instant de réflexion, il pensa que ce pouvait aussi bien être l’inverse : c’était lui qui s’était habitué aux horaires des animaux.
Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une, avec son bâton, en appelant chacune d’elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu’il disait.
Aussi leur lisait-il parfois certains passages des livres qui l’avaient marqué, ou bien il leur parlait de la solitude ou de la joie de vivre d’un berger dans la campagne, commentait les dernières nouveautés qu’il avait vues dans les villes par où il avait l’habitude de passer.
Depuis l’avant-veille, pourtant, il n’avait pratiquement pas eu d’autre sujet de conversation que cette jeune fille qui habitait la ville où il allait arriver quatre jours plus tard. C’était la fille d’un commerçant. Il n’était venu là qu’une fois, l’année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissus, et il aimait voir tondre les brebis sous ses yeux, pour éviter toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin, et le berger y avait amené son troupeau.
«J’ai besoin de vendre un peu de laine », dit-il au commerçant.
La boutique était pleine, et le commerçant demanda au berger d’attendre jusqu’en début de soirée. Celui-ci alla donc s’asseoir sur le trottoir du magasin et tira un livre de sa besace.
« Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres », dit une voix de femme à côté de lui.
C’était une jeune fille, qui avait le type même de la région d’Andalousie, avec ses longs cheveux noirs, et des yeux qui rappelaient vaguement les anciens conquérants maures.
« C’est que les brebis enseignent plus de choses que les livres », répondit le jeune berger.
Ils restèrent à bavarder, plus de deux heures durant. Elle dit qu’elle était la fille du commerçant, et parla de la vie au village, où chaque jour était semblable au précédent. Le berger raconta la campagne d’Andalousie, les dernières nouveautés qu’il avait vues dans les villes par où il était passé. Il était heureux de n’être pas obligé de toujours converser avec ses brebis.
« Comment avez-vous appris à lire? vint à demander la jeune fille.
– Comme tout le monde, répondit-il. A l’école.
– Mais alors, si vous savez lire, pourquoi n’êtes-vous donc qu’un berger? »
Le jeune homme se déroba, pour n’avoir pas à répondre à cette question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre. Il continua à raconter ses histoires de voyage, et les petits yeux mauresques s’ouvraient tout grands ou se refermaient sous l’effet de l’ébahissement et de la surprise. A mesure que le temps passait, le jeune homme se prit à souhaiter que ce jour ne finît jamais, que le père de la jeune fille demeurât occupé longtemps encore et lui demandât d’attendre pendant trois jours. Il se rendit compte qu’il ressentait
quelque chose qu’il n’avait encore jamais éprouvé jusqu’alors : l’envie de se fixer pour toujours dans une même ville. Avec la jeune fille aux cheveux noirs, les jours ne seraient jamais semblables.
Mais le commerçant arriva, finalement, et lui demanda de tondre quatre brebis. Puis il paya ce qu’il devait et l’invita à revenir l’année suivante.
Il ne manquait plus maintenant que quatre jours pour arriver dans cette même bourgade. Il était tout excité, et en même temps plein d’incertitude : peut-être la jeune fille l’aurait-elle oublié. Il ne manquait pas de bergers qui passaient par là pour vendre de la laine.
« Peu importe, dit-il, parlant à ses brebis. Moi aussi, je connais d’autres filles dans d’autres villes. »
Mais, dans le fond de son cœur, il savait que c’était loin d’être sans importance. Et que les bergers, comme les marins, ou les commis voyageurs, connaissent toujours une ville où existe quelqu’un capable de leur faire oublier le plaisir de courir le monde en toute liberté.
Alors que paraissaient les premières lueurs de l’aube, le berger commença à faire avancer ses moutons dans la direction du soleil levant. « Ils n’ont jamais besoin de prendre une décision, pensa-t-il. C’est peut-être pour cette raison qu’ils restent toujours auprès de moi. » Le seul besoin qu’éprouvaient les moutons, c’était celui d’eau et de nourriture. Et tant que leur berger connaîtrait les meilleurs pâturages d’Andalousie, ils seraient toujours ses amis. Même si tous les jours étaient semblables les uns aux autres, faits de longues heures qui se traînaient entre le lever et le coucher du soleil; même s’ils n’avaient jamais lu le moindre livre au cours de leur brève existence et ignoraient la langue des hommes qui racontaient ce qui se passait dans les villages. Ils se contentaient de nourriture et d’eau, et c’était en effet bien suffisant. En échange, ils offraient généreusement leur laine, leur compagnie et, de temps en temps, leur viande.
« Si, d’un moment à l’autre, je me transformais en monstre et me mettais à les tuer un à un, ils ne commenceraient à comprendre qu’une fois le troupeau déjà presque tout entier exterminé, pensa-t-il. Parce qu’ils ont confiance en moi, et qu’ils ont cessé de se fier à leurs propres instincts. Tout cela parce que c’est moi qui les mène au pâturage. »
Le jeune homme commença à se surprendre de ses propres pensées, à les trouver bizarres. L’église, avec ce sycomore qui poussait à l’intérieur, était peut-être hantée. Etait-ce pour cette raison qu’il avait encore refait ce même rêve, et qu’il éprouvait maintenant une sorte de colère à l’encontre des brebis, ses amies toujours fidèles? Il but un peu du vin qui lui restait du souper de la veille et serra son manteau contre son corps. Il savait que, dans quelques heures, avec le soleil à pic, il allait faire si chaud qu’il ne pourrait plus mener son troupeau à travers la campagne. A cette heure-là, en été, toute l’Espagne dormait. La chaleur durait jusqu’à la nuit, et pendant tout ce temps il lui faudrait transporter son manteau avec lui. Malgré tout, quand il avait envie de se plaindre de cette charge, il se souvenait que, grâce à cette charge, précisément, il n’avait pas ressenti le froid du petit matin.
« Nous devons toujours être prêts à affronter les surprises du temps », songeait-il alors; et il acceptait avec gratitude le poids de son manteau.
Celui-ci avait donc sa raison d’être, comme le jeune homme lui-même. Au bout de deux années passées à parcourir les plaines de l’Andalousie, il connaissait par cœur toutes les villes de la région, et c’était là ce qui donnait un sens à sa vie : voyager.
Il avait l’intention, cette fois-ci, d’expliquer à la jeune fille pourquoi un simple berger peut savoir lire : jusqu’à l’âge de seize ans, il avait fréquenté le séminaire.
Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre, motif de fierté pour une humble famille paysanne qui travaillait tout juste pour la nourriture et l’eau, comme ses moutons. Il avait étudié le latin, l’espagnol, la théologie. Mais, depuis sa petite enfance, il rêvait de connaître le monde, et c’était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s’était armé de courage et avait dit à son père qu’il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager.
« Des hommes venus du monde entier sont déjà passés par ce village, mon fils. Ils viennent ici chercher des choses nouvelles, mais ils restent toujours les mêmes hommes. Ils vont jusqu’à la colline pour visiter le château, et trouvent que le passé valait mieux que le présent. Ils ont les cheveux clairs, ou le teint foncé, mais sont semblables aux hommes de notre village.
– Mais moi, je ne connais pas les châteaux des pays d’où viennent ces hommes, répliqua le jeune homme.
– Ces hommes, quand ils voient nos champs et nos femmes, disent qu’ils aimeraient vivre ici pour toujours, poursuivit le père.
– Je veux connaître les femmes et les terres d’où ils viennent, dit alors le fils. Car eux ne restent jamais parmi nous.
– Mais ces hommes ont de l’argent plein leurs poches, dit encore le père. Chez nous, seuls les bergers peuvent voir du pays.
– Alors, je serai berger. »
Le père n’ajouta rien de plus. Le lendemain, il donna à son fils une bourse qui contenait trois vieilles pièces d’or espagnoles.
« Je les ai trouvées un jour dans un champ. Dans mon idée, elles devaient aller à l’Eglise, à l’occasion de ton ordination. Achète-toi un troupeau et va courir le monde, jusqu’au jour où tu apprendras que notre château est le plus digne d’intérêt et nos femmes les plus belles. »
Et il lui donna sa bénédiction. Le garçon, dans les yeux de son père, lut aussi l’envie de courir le monde. Une envie qui vivait toujours, en dépit des dizaines d’années au cours desquelles il avait essayé de la faire passer en demeurant dans le même lieu pour y dormir chaque nuit, y boire et y manger.
L’horizon se teinta de rouge, puis le soleil apparut. Le jeune homme se souvint de la conversation avec son père et se sentit heureux; il avait déjà connu bien des châteaux et bien des femmes (mais aucune ne pouvait égaler celle qui l’attendait à deux jours de là). Il possédait un manteau, un livre qu’il pourrait échanger contre un autre, un troupeau de moutons. Le plus important, toutefois, c’était que, chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie : voyager. Quand il se serait fatigué des campagnes d’Andalousie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il en aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de villes, des quantités de femmes, des quantités d’occasions d’être heureux.