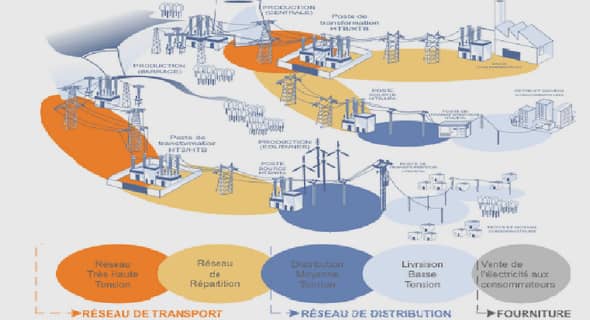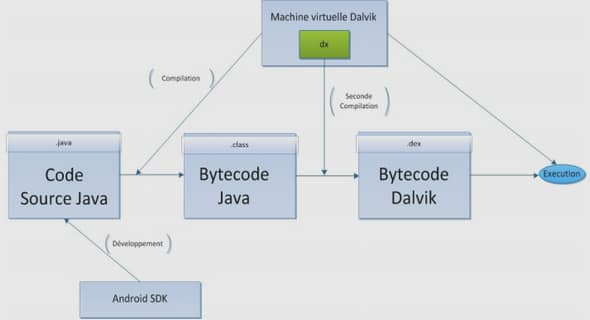Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
L’action publique contre la précarité sociale
L’action sociale conduite par les départements d’une part, et la politique de la ville d’autre part sont deux politiques publiques qui visent explicitement à lutter contre la précarité sociale. On ne saurait pourtant réduire le champ de l’action publique contre la précarité à ces deux politiques. La lutte contre la précarité sociale constitue effectivement un champ d’action extrêmement vaste, dont il est bien difficile de cerner les contours et ce, quel que soit l’angle à partir duquel on l’aborde, celui des définitions posées par le législateur ou celui des actions effectivement mises en œuvres.
Parmi les très nombreux textes réglementaires et législatifs portant sur le sujet, la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998 se démarque par son approche généraliste de l’exclusion sociale. Or, il apparaît de façon évidente que ce texte ne se réfère pas à un champ particulier de l’action publique ; il ne désigne pas non plus une autorité responsable en premier lieu de la conduite des politiques en destination des plus démunis ; ceux-là mêmes ne sont pas identifiés de manière précise, comme en témoigne tout particulièrement le premier article de la loi :
La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation.
La présente loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.
L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes. » (loi du 29 juillet 1998, art. 1er)
Il est pratiquement impossible de circonscrire le champ de l’action publique contre l’exclusion à partir d’une telle définition – mais n’est-ce pas là l’ambition même d’une loi qui vise à mobiliser l’ensemble des institutions et des acteurs autour d’une « cause nationale » ?
L’entreprise est à peine plus simple lorsque l’on considère l’ensemble des actions menées au nom de la lutte contre la précarité sociale, tant du point de vue des autorités qui les conduisent, de leur contenu ou de leur public – pour reprendre la grille de lecture proposée par Yves Meny et Jean-Claude Thoenig. La lutte contre la précarité sociale n’est le domaine réservé d’aucune institution. Le transfert au département de la compétence de l’action sociale par les lois de décentralisation de 1982-1983 ne doit pas occulter le rôle joué par les communes – notamment à travers les centres communaux d’action sociale (CCAS) –, ni celui de l’Etat, garant de la solidarité nationale, ni d’institutions comme les caisses d’allocations familiales (CAF) ni, encore, celui des associations. Définir l’action publique contre la précarité à partir des dispositifs mis en place – autrement dit de leur contenu – constituerait un véritable défi, tant ces dispositifs sont nombreux. Dans son Guide de l’action sociale contre les exclusions, Jean-Pierre Hardy (1999) consacre près de 200 pages à leur recensement… Ces dispositifs peuvent s’incarner dans des structures, telles les missions locales à destination des jeunes en difficultés d’insertion professionnelle. Ils peuvent prendre la forme de mesures particulières, tels les emplois aidés – qui ont connu différentes formules, depuis les travaux d’utilité collective (TUC) en 1984, jusqu’aux emplois-jeunes en 1997, en passant par les contrats emploi-solidarité (CES) en 1987 – ou telles les opérations « ville, vie, vacances » qui visent à la fois à prévenir la délinquance dans les quartiers urbains et à participer à l’insertion des jeunes les plus marginalisés, ou encore tel le classement de certains établissements scolaires en « zones d’éducation prioritaires » (ZEP), créées en 1982. Enfin, les dispositifs mis en place pour lutter contre la précarité peuvent revêtir la forme d’aides financières, soit ponctuelles – aides au paiement des factures d’électricité –, soit relevant des minima sociaux – au premier rang desquels le RMI. On l’aura compris, ces dispositifs multiformes s’intègrent dans des secteurs très variés de l’action publique, renvoyant en cela à un ensemble de « droits sociaux », progressivement reconnus par le législateur : droit au travail, droit à la santé (présents dans la constitution de la Cinquième République), droit à l’insertion (loi du 1er décembre 1988 relative au RMI), droit au logement ( loi du 31 mai 1990 relative au logement des plus démunis, dite loi Besson), droit à la ville ( loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville)…, mais aussi droits aux communications téléphoniques ou encore à un compte bancaire prévus dans la loi relative aux luttes contre les exclusions (loi du 29 juillet 1998). Comme le souligne Jean-Pierre Hardy, « le problème est beaucoup moins la reconnaissance de droits que leur effectivité » (1999, p. 186)3. De ce point de vue, l’ensemble des politiques publiques est bien concerné par la lutte contre la précarité sociale, même si, pour la plupart, elles ne se réduisent pas à cette seule dimension.
Enfin, chercher à circonscrire le champ de l’action publique contre la précarité par le public visé conduit tout autant à une aporie, en renvoyant aux formes multiples de la précarité sociale – que nous aurons l’occasion de développer dans le chapitre 3.
Doit-on conclure de ce qui précède que les deux politiques publiques sur lesquelles se concentre ce travail ne sont que des politiques parmi d’autres, dans un ensemble sans unité ? Bien au contraire. Ces deux politiques, chacune à leur manière, occupent une position centrale dans le champ de l’action publique contre la précarité. Tout d’abord, la lutte contre la précarité sociale est au cœur même des objectifs des services départementaux d’action sociale ainsi que de la politique de la ville – ce qui n’est pas le cas de l’ensemble des politiques publiques mobilisées, comme nous l’avons souligné4. Ensuite, c’est sur l’action sociale départementale que repose la mise en œuvre d’une grande part de l’aide sociale légale, et c’est de la politique de la ville que l’on attend les réponses aux difficultés des quartiers sensibles », sur lesquels s’est cristallisée la question de la précarité sociale en milieu urbain. En outre, de par leur contenu, l’action sociale départementale et la politique de la ville se situent à la confluence d’un grand nombre de politiques sectorielles. Les assistants sociaux départementaux sont ainsi des acteurs essentiels de l’accès aux droits sociaux évoqués plus haut, même s’ils ne sont pas les seuls ; la politique de la ville est explicitement définie comme une politique transversale.
Avant de présenter ces deux politiques publiques en détail, il convient de rappeler quelques éléments du contexte sociétal et institutionnel dans lequel elles ont été conçues puis mises en œuvre.
Les mutations de l’action publique
Il n’est pas question ici de faire le point sur l’ensemble des mutations qui ont affecté la conception et la conduite des politiques publiques au cours de ces trente dernières années, une telle entreprise dépassant largement le cadre de ce travail. Toutefois, pour comprendre la conception des politiques publiques contre la précarité sociale, leurs objectifs, leur fonctionnement, leur mise en œuvre et leur articulation, il est indispensable de considérer deux aspects au moins de ces mutations. Le premier tient à la remise en cause du système de protection sociale construit au cours des Trente Glorieuses ; le deuxième découle du mouvement de décentralisation qui a modifié les cadres institutionnels de la mise en œuvre de l’action publique.
En matière d’action publique contre la précarité sociale, la décentralisation a conduit à deux mutations majeures. La première est de faire du département, auquel l’essentiel de l’action sociale « légale » a été transféré, un acteur incontournable dans ce domaine ; la deuxième est d’autoriser la conduite de politiques publiques « multi-niveaux », dans lesquelles les différentes collectivités territoriales et l’Etat se trouvent en situation de coopérer.
La remise en cause de l’Etat providence
On désigne communément sous le terme d’Etat providence l’ensemble des politiques publiques élaborées pour protéger les individus des risques sociaux encourus dans le cadre du marché du travail – en premier lieu les accidents du travail, la maladie, le chômage, la vieillesse – auquel on peut ajouter les politiques à destination des familles. Le système français de protection sociale, amorcé à la fin du XIXe siècle (EWALD F., 1986) et progressivement consolidé au cours des Trente Glorieuses, a été profondément ébranlé par la montée en masse des situations de « nouvelles pauvreté » et par la variété de leurs déclinaisons. Pierre Rosanvallon publie dès 1981 un ouvrage intitulé La crise de l’Etat providence (ROSANVALLON P., 1981), tandis que la même année l’OCDE établit un diagnostic semblable à l’échelle internationale dans son rapport Crisis of Welfare State (cité in GAUDIN J.-P., 2004)5.
Les caractéristiques de ce système de protection sociale et les raisons de sa remise en cause sont aujourd’hui bien identifiées, grâce aux travaux des sociologues et historiens sur la question – on retiendra en particulier ceux de Robert Castel (1995) et de Pierre Rosanvallon précédemment cité (1990, 1995). Pour les résumer rapidement, on rappelle que le modèle français d’Etat providence, redistributif et financé par un système de cotisations, s’est construit en étroite relation avec la diffusion du salariat ; ce faisant, dans ce modèle, l’accès aux droits sociaux et l’insertion dans le marché du travail sont étroitement liés. Lorsque la condition salariale se précarise, que certains des « risques » encourus par les travailleurs, en particulier le chômage mais aussi la vieillesse, s’installent dans la durée et que des « normaux devenus inutiles » se voient mis à l’écart du monde du travail, le système de protection sociale se fragilise et devient, au moins en partie, inaccessible à certains individus. L’Etat providence est alors remis en cause sur plusieurs fronts. D’une part, l’équilibre financier du système de protection sociale reposant sur les cotisations des actifs se trouve inévitablement mis à mal par l’allongement de la durée de vie, la réduction du temps de travail des actifs et l’augmentation du nombre de ceux d’entre eux qui ne travaillent pas – et ne participent donc pas à remplir les caisses. D’autre part, ce sont la pertinence et la légitimité même de l’intervention de l’Etat qui sont remises en cause. Les prélèvements obligatoires sur les salaires sont accusés de freiner la reprise économique ; la garantie d’accès aux droits sociaux, en particulier à un revenu minimum, déconnectée d’une activité professionnelle engendrerait des situations d’assistanat ; enfin l’Etat providence se révélerait incapable de répondre aux nouvelles formes de pauvreté.
Les enquêtes barométriques, telles que celles conduites pour la DREES6 ou par la Commission européenne, permettent d’observer les représentations associées au système de protection sociale et à l’intervention des pouvoirs publics en faveur des plus pauvres. Outre les variations de l’opinion suivant la conjoncture économique et politique (GALLIE D., PAUGAM S., 2002), l’analyse de ces enquêtes montre une tendance à la croissance des interrogations des Français sur les effets des aides sociales (DAMON J., 2002b). Ce n’est pas tant le principe de solidarité envers les plus pauvres qui semble être en cause, que les modalités selon lesquelles l’action publique en mise en œuvre. En particulier, le sentiment que des dispositifs tel que le RMI puissent désinciter à travailler progresse de façon significative au cours de la période récente7. L’idée d’une « crise » de l’Etat providence apparaît fermement ancrée dans l’opinion publique.
Quelles conséquences a eu l’effritement du système de protection sociale sur l’action publique en faveur des plus démunis ? La première conséquence directe a été sans aucun doute l’augmentation du nombre de personnes s’adressant aux services sociaux, jointe à une diversification de leurs profils. Aux « familles difficiles » et aux « inadaptés sociaux » qui constituaient le public traditionnel des assistantes sociales, se sont ajoutés les surnuméraires » tenus, parfois durablement, à l’écart du marché de l’emploi et nécessitant des aides financières pour subvenir à leurs besoins. Une autre conséquence tient à l’élaboration, au fil des ans, de nouveaux dispositifs, soit sous la forme de mesures isolées, s’ajoutant les unes aux autres pour former un outillage extraordinairement compliqué ; soit DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
En 1999, 45 % des personnes interrogées considèrent que le RMI est de nature à dissuader les bénéficiaires à travailler, la proportion est de 52% en 2002. Parallèlement, 74% des personnes interrogées estiment que le montant du RMI n’est pas assez élevé (DAMON J., 2002b) sous la forme de nouvelles politiques publiques, de large portée. Parmi celles-ci on peut citer les missions locales, mise en place en 1981 suite au rapport de Bertrand Schwartz sur l’insertion professionnelles des jeunes ; le revenu minimum d’insertion (RMI) en 1988 ; la couverture maladie universelle (CMU) en 1998. La politique de la ville peut également être intégrée dans ces nouvelles politiques publiques. Ces dispositifs engagés par l’Etat mobilisent, dans leur application, un grand nombre d’acteurs institutionnels : les collectivités territoriales – communes, départements, régions dans certains cas – mais aussi les caisses d’allocations familiales (CAF) et le secteur associatif. Ils engagent des professionnels nouveaux venus dans le monde de l’action sociale, notamment ceux intervenants dans les champs de la politique de la ville et de l’insertion professionnelles.
Ces deux éléments – augmentation et diversification du public de l’action sociale ; multiplication des dispositifs et des acteurs – participent à la remise en cause des méthodes d’action traditionnelles des travailleurs sociaux et à privilégier de nouveaux mots d’ordres. L’action publique envers les plus démunis doit être transversale, de manière à coordonner les actions conduites par les différentes institutions ; elle doit être territoriale, pour mieux s’adapter à la demande et pour prendre en compte les ressources locales ; elle doit s’appuyer sur la participation des habitants pour mieux prendre en compte leurs besoins et raviver le sentiment de « vivre ensemble » ; elle doit s’émanciper d’une approche strictement individuelle ou familiale pour intégrer l’environnement des situations individuelles dans l’élaboration des réponses. Les politiques publiques traditionnelles, telles que l’action sociale départementale, sont sommées d’évoluer dans ce sens ; quant aux nouvelles politiques, telles que la politique de la ville, elles sont élaborées en fonction de ces objectifs.
Enfin, c’est le sens même de l’action publique à l’adresse des plus démunis qui se trouve réorienté. Elle ne vise plus seulement à la réduction des inégalités sociales, mais plus largement, à l’insertion d’une frange de la population menacée de marginalisation. La notion d’insertion est ici entendue non seulement dans sa dimension professionnelle, mais également dans un sens beaucoup plus large d’intégration au corps social, comme l’exprime très clairement Serge Paugam lorsqu’il participe à l’évaluation du dispositif du RMI, au début des années 90 :
Lorsque l’emploi ne joue plus son rôle intégrateur pour une part croissante de la population, l’enjeu des politiques de lutte contre la pauvreté est surtout de recréer le lien social et de remobiliser collectivement les individus et les ménages en imaginant, pour compenser l’augmentation du chômage et la « désacralisation » des grandes institutions – Eglise, partis politiques, syndicats, etc. –, d’autres instruments de socialisation en dehors de la sphère des rapports professionnels. » (PAUGAM S., 1993, p.75).
La décentralisation de l’action sociale
Les lois de décentralisation de 1982-1983, complétées par celle du 13 août 2004 reconnaissent les communes, les départements et les régions comme des collectivités territoriales, c’est-à-dire des centres de pouvoir responsables de la mise en œuvre et du financement des compétences qui leur sont confiées et autonomes dans leur administration. C’est donc au département qu’est revenue la compétence de l’action sociale, à l’exception de certaines prestations qui restent du domaine de l’Etat – en particulier celles qui s’adressent aux personnes sans-domicile. Plus précisément, les départements ont précisément en charge le service public d’action sociale – c’est ce service qui nous intéresse en particulier – mais aussi l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la protection maternelle et infantile (PMI). On trouvera dans l’encadré I. 1 une définition officielle de ces missions.
L’ensemble de ces services (service social, ASE et PMI) existait avant la décentralisation. Du point de vue des travailleurs sociaux, une conséquence majeure de la décentralisation a donc été le changement d’employeur. Cette perspective a soulevé bien des réticences, que l’on ne saurait réduire à une simple appréhension face au changement. Les enjeux, réels, sont bien résumés par Nathalie Blanchard qui a étudié la décentralisation de l’action sociale dans le département de l’Hérault :
Ce qui fondait le travail social, une certaine éthique de l’humain, pourra-t-il être préservé s’il ne relève plus de l’Etat universaliste et égalitaire, mais d’une collectivité locale prise dans des enjeux locaux ? demandent les assistantes sociales fonctionnaires des DDASS, qui craignent à la fois un contrôle accru sur les pratiques et le glissement d’une logique administrative-égalitaire à une logique politique clientéliste. » (BLANCHARD N., 2004, p. 10).
Du point de vue des assistants sociaux, la décentralisation ne signifie rien de moins que le passage d’une profession largement appréhendée selon un mode de fonctionnement libéral, dont la légitimité des modes d’intervention est définie par un code déontologique, à une profession qui met en œuvre la politique de son employeur, en l’occurrence le conseil général, responsable des compétences qui lui ont été confiées par l’Etat. Autrement dit, l’assistant social n’est plus seul à définir les actions à mettre en œuvre dans son secteur d’intervention ; il doit également tenir compte des priorités et des orientations définies par les élus du conseil général. Ce conflit de légitimité est souvent souligné comme une évolution majeure du corps professionnel des travailleurs sociaux (THAURIALE T., 2002 ; BIGOT F., RIVARD T., 2001a).
Cette dernière observation nous conduit à aborder une autre question, de portée plus générale, posée par la décentralisation. Dans quelle mesure les conseils généraux s’investissent-ils effectivement dans la définition de l’action sociale à conduire sur leur territoire ? Dans le cadre d’une décentralisation dite « administrative », telle qu’elle a été menée en France, seules les compétences d’administration ont été transférées aux collectivités territoriales, le pouvoir de légiférer restant du domaine de l’Etat. Les départements sont donc responsables du financement et de l’organisation des actions et des prestations dont ils ont la charge, définies par des lois nationales. Concrètement, que signifie ce transfert de compétences ? S’agit-il simplement pour les départements de mettre en œuvre et de gérer des dispositifs conçus par le législateur, à l’échelon de l’Etat ? Ou bien s’agit-il d’élaborer une politique propre, construite en fonction des choix politiques du conseil général et des caractéristiques et spécificités du territoire de compétence ? Interrogé sur la question, un représentant de la direction de l’action sociale d’un conseil général nous a répondu que « la décentralisation, c’était ce qu’en font les élus ». Ainsi, que le département se cantonne à gérer des dispositifs nationaux, où qu’il s’attache à définir et mettre en oeuvre des orientations propres, sont deux orientations possibles dans le cadre de la décentralisation.
La décentralisation autorise donc un investissement inégal des départements dans le champ de l’action sociale et également, dans les choix d’orientations et les modalités de la mise en œuvre des dispositifs. Ce fait a souvent été relevé à propos du RMI. Une récente étude a ainsi montré que les inégalités de traitement des bénéficiaires du RMI étaient non seulement liés au contexte socio-économique local et aux caractéristiques propres des bénéficiaires, mais également aux modalités différenciées de mise en œuvre du contrat d’insertion, les auteurs soulignant la cohérence départementale de cette dernière variable (BOUCHOUX J. et al., 2004). Au risque de la caricature, on peut rappeler en Ile-de-France le cas du département de la Seine-Saint-Denis, qui s’est longtemps largement abstenu de mettre en place le volet contractuel du RMI, option s’opposant à celle retenue dans les Hauts-de-Seine, où l’insertion professionnelle constitue l’objectif premier du dispositif. Ces différentes options sont bien sûr sous-tendues par les débats relatifs à la mise en œuvre du RMI. Les uns ont perçu ce dernier comme un renoncement à offrir à chacun un emploi réel et ils ont fait le choix de ne considérer que le volet revenu minimum ; les autres ont vu dans ce revenu minimum un risque d’assistanat s’il n’est pas assorti d’un retour à l’emploi à court terme.
La loi de décentralisation de 2004 – « l’acte II de la décentralisation » – a transféré aux départements la gestion de l’ensemble du dispositif du RMI et ce faisant, a ravivé le débat. Le juriste Michel Borgetto en explicite ainsi les termes :
La décentralisation du dispositif ravive les tensions entre le principe d’égalité, qui est censé régir l’attribution de prestations de solidarité, et celui de libre administration des collectivités territoriales. » (Le Monde, 26 juillet 2005)
Derrière la question de l’investissement des conseils généraux dans la conception de l’action publique en faveur des plus démunis, se profile effectivement la question des différences autorisées ou occasionnées par la décentralisation dans l’action des départements et ce faisant, de l’égalité de traitement des citoyens. Ces différences sont certes liées aux orientations et priorités définies localement, mais également aux besoins spécifiques des populations et enfin aux ressources propres de chaque département. En tant que collectivités territoriales, les départements disposent effectivement de ressources propres, qui proviennent pour l’essentiel des recettes des impôts et des taxes payées par les entreprises et les administrés, que complètent les dotations de l’Etat accompagnant les différents transferts de compétences. Ressources et besoins des populations se combinent pour créer des situations fort variables selon les départements, que d’aucuns dénoncent comme des inégalités potentielles ou effectives. Ce type de lecture n’est pas seulement adopté par les adversaires d’une décentralisation trop poussée, mais également par les défenseurs d’une péréquation garantissant davantage d’égalité entre les départements. Si l’on retient le potentiel fiscal par habitant8 comme indicateur de la richesse, les départements franciliens figurent parmi les plus favorisés de France, voire les plus favorisés : Paris, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, l’Essonne, le Val-de-Marne, et la Seine-Saint-Denis occupent les six premiers rangs, le Val-d’Oise et la Seine-et-Marne figurant dans le premier quart. Ce sont moins les ressources, que les besoins des populations qui différencient les départements franciliens en matière d’action sociale. La comparaison de la part de la population concernée par le RMI donne une idée des écarts intra-franciliens : en 2004, 1,6% des Yvelinois vivent dans un ménage bénéficiant du RMI, contre 6,8 % de la population de la Seine-Saint-Denis (INSEE Ile-de-France, 2005). La tendance à l’augmentation des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance pourrait introduire un nouveau facteur de différenciation des orientations des départements en matière d’action sociale, mettant éventuellement en concurrence deux publics : ceux touchés par la précarité sociale d’une part et ceux touchés par la problématique de dépendance d’autre part. Les départements les plus riches pourront faire face aux deux postes de dépenses ; face au « défi du vieillissement » de leur administrés, d’autres départements se verront peut-être contraints d’arbitrer entre les deux types de publics ; tandis que dans d’autres départements, ces deux publics se confondent déjà.
La loi de décentralisation du 13 août 2004 a ainsi conforté le département dans la conception et la mise en œuvre de l’action sociale. Les débats précédant la loi et les rapports publiés à cette occasion avaient un temps remis en cause ce niveau d’administration territoriale. En particulier, des propositions avaient alors été formulées allant dans le sens d’un renforcement du niveau des groupements intercommunaux à fiscalité propre (communautés de communes et communautés d’agglomération), appuyé entre autres par une élection au suffrage universel des représentants de ces groupements – le rapport de Pierre Mauroy (2000) en constitue une bonne illustration. Ces propositions n’ont finalement pas été retenues, mais elles n’ont pas manqué d’ébranler les élus et le personnel administratif des conseils généraux, comme nous avons pu le vérifier au cours des entretiens.
Au total, les compétences du département en matière d’action sociale ont été renforcées sur deux fronts. Premièrement, les conseils généraux se sont vus transférer l’intégralité de la compétence de dispositifs auparavant gérés ou co-gérés avec l’Etat – en premier lieu le RMI. Deuxièmement, le département a été défini comme « chef de file » de l’action sociale (LAFORE R., 2004). Par cette notion de « chef de file », le législateur tente d’organiser l’action des différents intervenants dans le domaine de l’action sociale. Ce point mérite explication. En effet, si les lois de 1982-1983 ont certes transféré au département l’essentiel de l’action sociale légale, elles n’ont pas pour autant fait du champ de l’action sociale son domaine réservé. Nous avons déjà souligné que d’autres acteurs s’y investissaient activement – Etat, communes, institutions diverses, associations. Ces acteurs interviennent à différents niveaux, depuis la gestion des dispositifs nationaux jusqu’à la mise en œuvre d’actions au plus près des populations touchées par la précarité. Chacun est en mesure de définir ses propres orientations et priorités. Ce foisonnement est plus souvent abordé en termes d’enchevêtrement de compétences, voire de concurrence ou de doublons, que de complémentarité. La loi institue alors le département comme le « chef de file » de l’action sociale, qui « définit et met en œuvre » l’action sociale et « coordonne » l’action des différents intervenants sur son territoire (loi du 13 août 2004). Ainsi définie, sa mission est double. Elle ne se cantonne pas à mettre en œuvre les dispositifs dont le conseil général a la charge, ni même à définir une politique d’action sociale adaptée à son territoire, mais consiste également à coordonner l’action des différents acteurs, autrement dit à organiser les partenariats.
La coopération entre collectivités territoriales et la mise en œuvre de politique « multi-niveaux »
Une conséquence pratique de la décentralisation a été de mettre les collectivités territoriales et l’Etat en situation d’être des partenaires. Cela peut paraître contradictoire avec la logique du partage des compétences en « blocs » homogènes entre les collectivités territoriales, logique selon laquelle a été pensée la décentralisation. Dans cette perspective, chaque domaine d’action est conduit par la collectivité territoriale qui en a reçu la compétence. Or, on a vu que dans le domaine de l’action publique contre la précarité sociale – comme dans d’autres domaines – l’attribution de la compétence de l’action sociale aux conseils généraux n’a pas annulé les compétences en la matière ni des communes, ni des autres institutions. Ensuite, les multiples facettes de la « nouvelle pauvreté » ont progressivement conduit à promouvoir des modes d’action publique intégrant et coordonnant différentes politiques sectorielles. Enfin, devant l’ampleur de cette « nouvelle pauvreté », l’Etat s’est progressivement réinvesti dans le champ de l’action sociale, en impulsant de nouvelles politiques publiques et en participant à leur mise en œuvre. Cette participation peut prendre la forme d’une cogestion avec les collectivités territoriales – c’est le cas du RMI – ou encore, celle d’un contrat d’action publique, passé avec une ou plusieurs collectivités territoriales directement concernées – la politique de la ville est l’exemple même de cette démarche.
La formule du contrat autorise une négociation entre les partenaires sur les objectifs de l’action publique et sur les moyens que chacun y engage. La définition que donne Jean-Pierre Gaudin de cette forme d’action publique, sur laquelle il s’est particulièrement penché, est éclairante :
Les modalités générales des politiques publiques sont posées sur le plan national dans des lois et des décrets d’ensemble, tandis que leur mise en œuvre est renvoyée à des dispositifs territoriaux contractuels, négociés à des échelons régionaux, départementaux et urbains, ou encore, à des « périmètres de projet » intercommunaux. » (2004, p. 52)
Dans cette coopération entre collectivités territoriales et Etat, il faut effectivement intégrer les « nouveaux territoires » nés de l’intercommunalité, ainsi que les associations qui peuvent mettre en œuvre concrètement les dispositifs en jeu, voire des partenaires privés dans le domaine du développement économique. Appliqué à la politique de la ville, le modèle d’action publique décrit plus haut prend la forme suivante :
(…) la politique de la ville est une politique nationale, initiée et portée par l’Etat, mais qui cherche en même temps à aller à la rencontre d’initiatives locales, de préoccupations portées par les élus. D’où le recours systématique à des procédures contractuelles multi-niveaux (Etat, villes, mais aussi départements et Union européenne parfois), avec des négociations portant sur les objectifs d’action, sur les moyens et les calendriers de réalisation. » (2004, p. 63)
Parce qu’elles visent à s’appuyer sur des initiatives locales et à mettre en œuvre des projets d’action définis localement, ces politiques multi-niveaux sont souvent qualifiées de territoriales », ce terme les démarquant ainsi, souvent de façon volontariste, des politiques territorialisées » qui consistent pour leur part en une déclinaison des politiques nationales sur l’ensemble du territoire, suivant une logique de déconcentration ou de décentralisation.
Les grandes lignes du contexte sociétal et institutionnel étant posées, nous pouvons définir les deux politiques publiques sur lesquelles porte ce travail, à savoir l’action sociale départementale et la politique de la ville.
L’action sociale départementale
Après avoir défini l’action sociale départementale, nous nous attarderons sur les interrogations et les évolutions qui traversent le corps professionnel des travailleurs sociaux. Les révisions et les transformations des cadres territoriaux de l’action sociale départementale, qui seront analysées dans la deuxième partie de cette thèse, peuvent effectivement être saisis tout à la fois comme une expression et comme une dimension de ces évolutions.
Définition
Nous avons vu plus haut que les lois de décentralisation de 1982-1983 avaient donné aux départements la compétence de « l’action sociale légale ». Cette notion d’action sociale mérite d’être précisée. Elle n’inclut pas ici les dispositifs de protection sociale, tels que les prestations de Sécurité sociale, l’assurance chômage ou encore les prestations familiales, qui pourraient relever de l’action sociale dans une définition extensive de la notion (JOIN-LAMBERT M.-T., 1994). Elle se rapproche davantage de celle « d’aide sociale ». Les deux termes sont d’ailleurs utilisés dans la loi de 1983 qui définit les compétences du département en la matière : la section concernée est ainsi intitulée « De l’action sociale et de la santé », tandis que le premier article de cette section précise que : « Le département prend en charge l’ensemble des prestations légales d’aide sociale (…)» (loi du 22 juillet 1983)9. Concrètement, le transfert de l’action sociale concerne quatre grands services, qui rassemblent plusieurs catégories de professionnels – parmi lesquelles les trois professions « canoniques » du travail social, que sont les assistants de service social, les éducateurs spécialisés et les conseillères en économie sociale et familiale. On peut définir les missions de chaque service à partir du Code de l’action sociale et des familles, qui constitue le cadre légal général de l’action sociale et, le cas échéant, à partir du Code de la santé publique (cf. encadré I.1).
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
Partie 1 – Etudier les territoires de l’action publique contre la précarité
Chapitre 1. L’action sociale départementale et la politique de la ville, deux politiques publiques contre la précarité sociale
Chapitre 2. Approche spatiale et choix méthodologiques
Partie 2 – Précarité sociale : formes sociales, formes spatiales
Chapitre 3. Caractéristiques de la précarité dans la société française contemporaine
Chapitre 4. La division sociale de l’espace francilien du point de vue des inégalités de richesse des ménages
Chapitre 5. Les contextes locaux de la précarité sociale
Partie 3 – Les découpages de l’action sociale départementale, entre territoires professionnels, territoires de gestion et territoires politiques
Chapitre 6. A chaque département, ses logiques de découpages
Chapitre 7. Le dessin des « circonscriptions d’action sociale »
Chapitre 8. La mise en oeuvre de l’action sociale dans les maillages
Partie 4 – Les découpages de la politique de la ville, au-delà de la discrimination territoriale positive ?
Chapitre 9. Les cadres locaux de la mise en œuvre de la politique de la ville
Chapitre 10. Les contrats de ville franciliens
Chapitre 11. Positions et usages des quartiers prioritaires
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES FIGURES
TABLE DES TABLEAUX
TABLE DES MATIERES
CARTE DE LOCALISATION DES 626 COMMUNES URBAINES FRANCILIENNES (HORS TEXTE)
INTRODUCTION GENERALE