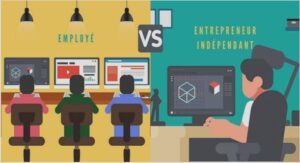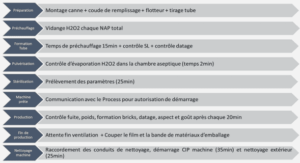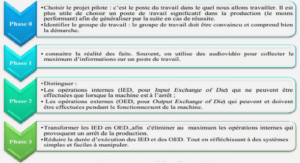Primauté de l’épargne
Du temps de la 1ère République, l’on pensait déjà à la création de la banque agricole pour aider les paysans à épargner et à recourir au crédit. Mais avec le contexte économique qui a prévalu, elle n’a pas eu la chance d’être réalisée. On signale quand même que des banques existaient depuis : la Banque Nationale Malgache devenu aujourd’hui Banque of Africa, la Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie devenue Banque du Développement du Commerce (BFV SG) et Banque Nationale pour l’industrie (BNI ÇA). Elles étaient pour la plupart, installées dans les centres urbains où le secteur tertiaire est plus développé.
Il n’y avait que la Caisse d’Epargne de Madagascar spécialisée, comme son nom l’indique, dans l’épargne. C’est une branche de service rattachée au Ministère des Postes et des Télécommunications. C’est tout simplement une caisse de dépôt dont les conditions sont fixées comme suit. Les membres effectuent des dépôts inscrits dans les livrets. Ils ne peuvent faire des retraits d’argent qu’après 15 jours suivant la date du dépôt. Et ainsi de suite. Les CEM sont implantées dans plusieurs localités de Madagascar.
Rôle des capitaux privés face à l’épargne
Les hommes sont les catalyseurs et les bénéficiaires du développement, alors que le capital constitue le deuxième intrant matériel du processus de croissance, l’épargne et les investissements compris.
Il existe depuis un certain temps la thèse selon laquelle le capital était la clé du développement, baptisé fondamentalisme du capital. De là, on s’imagine que le problème du développement apparaît essentiellement comme celui de la mobilisation d’un certain montant, d’un investissement qui suffirait à susciter la croissance du revenu national au rythme que l’on s’est fixé comme objectif. Dans les pays en voie de développement, le capital productif est fort limité qu’il faudrait d’autres sources de financement pour mobiliser les ressources humaines et investir dans les secteurs porteurs de l’économie. Et ce afin de trouver l’équilibre des rapports production-investissement et production-consommation. «Pour tout pays, l’un des choix fondamentaux porte sur la répartition des ressources entre la consommation immédiate et la consommation future ou l’épargne. ». La première vise à satisfaire les besoins réels des individus, qu’ils soient producteurs directs, financiers ou simples consommateurs ; la seconde prévoit ce que doit être entrepris dans le futur par le truchement d’une accumulation de capital qui sera investi dans les secteurs productifs. Dans le secteur strictement privé, cette accumulation de capital regroupe l’épargne intérieure réalisée qui peut provenir de deux sources :
L’épargne des entreprises (des personnes morales) qui se définit comme les bénéfices non distribués des sociétés, c’est-à-dire le revenu des sociétés après paiement d’impôts et la répartition des dividendes versés aux actionnaires.
L’épargne des ménages ruraux et urbains constituée par la part non consommée des revenus ou du surplus monétaire mobilisable dans le futur. Quatre explications possibles du comportement des ménages en matière d’épargne peuvent être avancées.
Aménagement de l’espace géographique et essor du commerce
L’urbanisation croissante du commerce a modifié le paysage géographique. Un nouveau plan d’occupation du sol s’avère nécessaire pour éviter des constructions anarchiques.
La politique de l’habitat adoptée actuellement par la mairie a donné un nouvel élan à l’architecture. La modernisation des pavillons du marché est un début de l’aménagement de la ville. Un projet de construction d’une cité communale est aujourd’hui en gestation. Il constitue un investissement important que la mairie compte réaliser dans le cadre du PIP.
En ce qui concerne l’espace agricole, des séries d’aménagements ont été effectués, en particulier les routes, digues et des canaux pour contenir les inondations et pour protéger les rizières. Des projets de construction de barrage sur la rivière Imamba sont prévus pour rentabiliser les surfaces exploitables et développer la riziculture. En un sens, l’agriculture ne constitue qu’un secteur d’activité parmi de nombreuses autres, mais c’est un secteur spécifique.
Elle se distingue également par une autre caractéristique : l’importance majeure du sol en tant que facteur de production.
La terre sert aux autres secteurs, auxquelles elle est indispensable, mais dans chacun de ceux-ci, elle joue un rôle aussi central. L’existence des terres cultivables définit fondamentalement le type de techniques agricoles utilisables.
Le commerce des produits agricoles connait un essor considérable ces dernières années. Le nombre de marchands de légumes augmente de jour en jour. On ignore encore pour le moment l’effectif exact des commerçants en attendant le recensement après l’installation du nouveau centre fiscal. Encore moins pour le capital commercial qui circule dans la commune. Comme toutes les communes périphériques de la capitale, elle assure l’approvisionnement en légumes du marché municipal d’Andravoahangy.
La notion de relations Ville-Campagne trouve ici toute sa valeur, traduite par les flux et reflux des personnes, des capitaux et des marchandises.
Commerce et transport
Le commerce est une activité florissante dans la commune. Le nombre des épiciers et des vendeurs de boissons alcooliques ne cesse de croitre dans tous les coins et recoins. A défaut d’une statistique précise, nous nous intéressons seulement à l’arrondissement d’Atsinanantsena.
Sans compter les marchands quotidiens sur la place du marché allant des légumiers aux fripiers en passant par les bouchers, les poissonniers et les gargotes, quelque 250 commerçants détaillant sont été recensés. Ce qui est bien loin de la réalité actuelle. Une grande partie des recettes de la commune provient des taxes journalières collectées auprès de ces commerçants.
Le transport suburbain a contribué au développement de la commune. Deux coopératives assurent régulièrement la liaison entre la capitale et les trois arrondissements. Un nouveau stationnement a été construit pour les voitures et les passagers. Les coopératives FAFIAVA regroupe 50 adhérents et celle de KOFIAVA 60 adhérents. En tout, on compte quelque 150 cars pour le transport des passagers. Les camions assurent le transport des marchandises et briques.
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
Généralités
Cadre théorique
Motif du thème et du terrain
Problématique
Hypothèses
PARTIE I : ETAT DES LIEUX DE LA COMMUNE
1-1 Localisation géographique
1-2 Particularités historiques
1-3 Les données démographiques
1-4 L’habitat
1-5 Economie
1-6 Commerce et transport
1-7 Santé et scolarisation
1-8 Sécurité
1-9 Routes
PARTIE II :MUTUELLES D’EPARGNE ET DE CREDIT ET POPULATION LOCALE
2-1- Primauté de l’épargne
2-2- Rôle des capitaux privés face à l’épargne
PARTIE III : IMPACTS DE L’ESPACE FINANCIER DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
3-1 Situation financière et projets communaux
3-2 Aménagement de l’espace géographique et essor du commerce
CONCLUSION
ANNEXES